L’IEO-06 PRESENTA
Lo premier tèxto que legiguèri de Miquèl de Carabatta siguèt Lo barròco funeral de paure Mèstre Simon-Pèire Sartre que l’autor presentèt au concors literari dei « Amics de Mesclum », lo segond tèxto que descurbèri d’eu, siguèt Augustinha, au concors literari dei « Pays de Paillon ». Per cas, èri present en li doi juradas e capissèri qu’eravam faça a un autor dei grans, d’aquelu que pòrtan la lenga occitana mai luenh, que la fan evoluar en dignitat e qu’aviavam en tant qu’associacion lo dever de publicar li nòvas de Miquèl. La lenga emplegada es bèla, druda, gaireben poetica.
Ancuei avèm decidat de recampar toi lu tèxtes esparpalhats d’eu sus lo nòstre site per fin de vos donar encara mai envuèia de descurbir l’autor. Estent que siam d’estiu e qu’es lo temps dei vacanças si pensam qu’aurètz mai de temps a consacrar a la lectura doncas vequí recampats 3 autres tèxtes de Miquèl seguit dai 3 traduccions :
– BARBA JOUAN
– LO BARÒCO FUNERAL DE PAURE MÈSTRE SIMON-PEIRE SARTRE
Per aquelu qu’aurian mancat lu premiers tèxtes : http://ieo06.free.fr/spip.php?article4017
http://ieo06.free.fr/spip.php?article4018
(da sègre….)
BARBA JOAN
« Oblidarem los camaradas. Nos sovendrem pas mai de la sabor canina del pan negre de l’amistat, del pan que s’atalhona coma lo còs de Dieu.»
Joan Bodon ; La Grava sul camin
L’i son de demandas que si fèm, coma aquò, sensa aver jamai minga respòsta ; sensa manco cercar, que tant – mas o sabèm pi ?– de respòsta n’i a ren : coma es diaul possible que Jean Giono augue poscut si traborsar tota la guèrra dau quatòrze e se’n sigue revengut viu – e entier – escriure Le grand troupeau ? Coma mon rèire-barba Veran a ben poscut bofar dintre la trombeta dau XVème Còrs, de Dieuze fins a Verdun e sobreviure pi a la gran maceleria au soleu de l’ofensiva Nivelle ? Coma a ben poscut contuniar a córrer darrier lu promiers carres d’assaut, a encambalar lo Rhin – sempre bofant, coma Galibardi en la cançon ? Qu l’a laissat se’n tornar au Caup Dalh, cardar la lana e liurar lu matalàs, estirassant lo sieu carreton jaune, fins a tant qu’acabesse de racar de tròç dei sieu lèus, marchs de l’iperita ? Perqué Barba Angelin es revengut dau Rif, que son paire s’èra estat posc en la Marne ; e perqué lo sieu enfant non s’estaguet en l’arena dau costat de Bizerte ?
Barba Joan, finda eu, es revengut de luenh. E eu lo saup lo perqué ; bessai perqué la demanda non la si fa pus. Estent qu’es prèire, l’i a bèu temps qu’a capit que li vias dau Sinhor son impenetrabli. Dau resta, seria mancar de respècte de contuniar de lo sonar Barba Joan. Aquò es bòn per lu bossòtos dau dimènegue, ren per un brave capelan que tant, non capisseria la menchonada, ja qu’es francés de lenga d’oil ! En la familha li dion Tonton Jean.
Naissut en lo mil nòu cent-doze, coma ma mairgran Elvira, es lo segond mascle, lo sieisen dei vuèch enfants Levesque, de Cherbourg. Lo paire èra un arquitecta renomat d’aquela ciutat, que l’escapolet dau gran chaple encausa dau sieu atge ja maduret e de la carga de familha. Tot aquela joventura sieua cortivava lu bèlhs arts e la beutat : qu pintava, qu tocava lo violon ò lo piano ; cadun pilhava la pauva davant de la cambra fotogràfica de Papà que s’èra encapriciat de l’extraordinària modernitat tècnica dau sieu temps. Ai poscut vèire lu positius sèpias e li placas de vèire que fan testimònis d’aqueu gaug passat.
Quora, a vint ans, moret Pèire, son fraire lo màger, Joan chausisset d’intrar au seminari. Après dei sieu estudis, foguet ordonat prèire e nomenat vicari pi curat en quauque luèc de la sieu Normandia natala ; l’i estaguet tota la sieu vida, en Normandia. Non l’i es augut que la segonda guèrra mondiala per lo destraïnar.
* * *
Embe Jaume, son fraire lo mendre, que Joan li volia tant de ben, avian costuma de virolar d’a motò. Faïan lo torn de Bretanha quora veguèron li promieri afichas de mobilizacion, a Saint Pol de Léon : la República sonava ja, en aquela fin de l’estiu dau trenta-nòu, lu destacaments precursors denant de la mobilizacion generala. Lu doi fraires s’entornèron a Saint Lô, que Joan l’i èra vicari – e que la requisicion li devia fa petar la sieu Monet-Goyon. Sus lo còup foguet incorporat au 6 / 208, batalhon independent formant còrs, embé lo grado de sargent, en una seccion d’ingenhe : en l’ocurrença, de mortairets Brandt de vuetanta-un e de canons anticarres de trenta-set.
D’efècte, en lu mil nòu cent trenta-doi, trenta-très, quora avia fach lo sieu servici, avia seguit lo peloton d’escolan gradat. Au Havre et à Cherbourg pi, avia emparat a manejar li armas, a lièger li taulas de tir e a si carcular li trajectòrias balístiqui. Estent qu’èra ren nhòco, e ben istruch, èra sortit sargent.
Tot un, en lo trenta-nòu, doncas, quora foguet mobilizat, lo sieu commandant de batalhon s’atrovet bioc de très caps de seccion, ajudants ò tenents. En la seccion de Joan, lo libre èra marcat : « Chef de section : lieutenant N… »… Lu aspèran encara aüra, lo tenent « N, très ponchs » e lu sieu sòcis ! Emb aquò, en plaça sieua, lo commandant li fiquet de sota oficiers adjonts. Joan – lo cap-sargent Levesque – si pilhet lo command d’una seccion ; l’òbra dau pastre màger e lo saldo dau gafet…
Vautres que lo conoissètz l’antifòni dau quaranta, auretz endevinat que l’arnescament dau batalhon s’èra perdut, embé lu caps de seccions e que, de canon de 37, de mortairet de 81, ne’n veguet jamai minga. Tot bèu just s’en plaça dei Brandt de 81, que lu estimava pron, Joan toquet lo rabuganhe dei provistas, d’entrics arcàïcos dau 1917, que lu calia amirar emb un nivèu a bòfa e un fiu a plomb !
En tant que cap de seccion, lo cap-sargent Jean Levesque reçaupet pura, per faire la sieu guèrra, un rabatin espanhòu – provedit de sièis cartochas – rabalhat, bessai dau costat de Rivesaltas, sus de quauque refugiat estravirat. Aqueu chopet derisòri augurava ja lo sòrt de la República – vòli dire la nòstra.
De l’autom dau trenta-nòu fins a la prima dau quaranta, asperèron – coma cadun – tra caserna desobrada a Cherbourg e vani manòbras au Vast, en lo Val de Saire. Au mès de mai, foguèron mandats sus la linha de defensa avançadi de Cherbourg, au levant dei palums dau Cotentin. De lòng de la Douve, lo 6 / 208 tenia lu quatre pònts : Pont Douve, Beuzeville-la-Bastille, Pont l’Abbé, La Sensurière. Joan gardava un sector vesin dau Pòst de Command dau batalhon, a la sortida Nòrd de Sainte-Mère-Eglise, sus lo camin de Cherbourg. En de mai dei mortairets dau 1917 que jovavan pus en gran cauva per aquela òbra, li donèron quatre mitralhusas Hotchkiss. Èran de peças ipomobili, que lo sieu carreton camalava l’arma, l’afust e li municions. N’aluguet doi per defendre lo camin de Cherbourg e doi per asperar cen que podia s’adurre de Chef-du-Pont. Joan, que s’atrovet ensin encargat de tenir doi camins, avia apostat armas e servients en lu fossons, reparat de lòng dei bondas de cada encaladat.
Tonton Jean nen cuntava la sieu guèrra l’autre estiu, qu’aviavan trabossat Var e traversat França a l’esquirpa, e en familha, per l’anar vesitar a Quinéville. Curat d’aqueu paisòt, aüra retirat, viu despí d’ans e d’ans sus d’aquela còla ventoa, en lo sieu presbitari agrumicelat còntra d’un vièlh cloquier roman. Despí mila ans, en aqueu pichin bastion de Dieu, que fa tèsta ai mars e ai plàias dau Cotentin, la glèia e lo Camp-Sant s’apontelan còntra dau vent. Lo logís dau curat l’i es cench dei fenieras, estabi, cela, claus qu’asseguravan lo cada-jorn dei curats d’un temps. L’i a gaire d’aquò, Tonton Jean agregava encara l’òrt e cobeava la frucha dau plantier. D’aquela vida rústega a pura conservat la costuma de si bèure, cada an, una bota de vin de pom de doi cent litres que li provedisse un paisan dei sieu amics.
De fach, es davant d’una d’aqueli botilhas tiradi de la bota que charam, una vesprada, en lo frescor de la coïna. Avèm acabat lo past, pòrta duberta sus lo bèu borrin dau prat, dau temps que França si desseca en la caumassa. Tonton Jean es d’aquelu òmes que lo gaug de faire sautar la súvera en compànha es mai fòrt qu’aqueu de si tapar li botilhas d’a solet. Es anat en la cela, pilhar encara un amorin d’aquela buvanda abocanta, prefumada, viva d’aqueli bòfas laugieri, e pura encara àspera e fosca de la frucha caucada. Nen cuenta li sieu fachendas embé la sieu votz pàia, l’esquina arrambada a l’espalièra de la cadièra, li mans pauvadi sus lo taulier, la tèsta laugierament clinada en arrié, per mieus refestonar en la sieu memòria.
Entra ieu, mi fau la demanda de saupre cen qu’a ben poscut bolear lo ment d’un prèire crestian, catòlico, cap de seccion en l’armada de la República francesa, en carga de quatre mitralhusas e dei sieu servients, a l’apròch dau nemic. En cu calia obedir ? Coma si destrigar tra lu commands de Nòstre Sinhor e aquelu dau sieu capitani ? Si tractava ben aquí d’amaçar de creaturas de Dieu, de si faire tuar, de resistre – ò non – a l’ataca d’una armada forastiera, e de si pilhar en aquelu events la responsabilitat de la vida e de la mòrt dei òmes. Siguem ben d’accòrdi que non charam aquí de coratge o de viliacaria, d’aquela retòrica borfa dei nacionalismes, mas de la consciença d’un èstre pais e beninhós, benvolent dau sieu pròximo, e que dèu far tèsta au sieu destin.
Remandi pura la demanda a mai tardi… qu’en aqueu moment – lo dètz-e-vuèch de junh dau quaranta – lu tedèscos atacan au Pont Douve et à la Sensurière. Emb aquò, lu carres passan de l’autre costat dei palums e dau cap-sargent Levesque, au ponent dau Cotentin, aquí dont que degun l’i s’aspera.
Per nen far acapir la manòbra, Tonton Jean dessenha una mapa de la batalha sus dau taulier, embé de gótos, de posadas, de botilhas e de sietons. Per nautres que conoissèm gaire ben Cotentin, es un pauc dificultós de l’i si reconóisser sensa esplegacion…
Lo dètz-e-vuèch de junh dau quaranta, doncas, a Saint-Sauveur-de-Pierrepont, doi oficiers de la Panzer Division venguèron emb una bandièra blanca per provar de faire baròli sensa tròp de dam. L’ingenhur de marina que commandava lu doi canons dau sector, faguet virar la ceguinhòla dau sieu tirafòne. A Cherbourg, l’amiral diguet que calia resistre. « D’aquí dètz minutas, farai fuèc ! » respondet lo marinier ai doi pacifistas de la Wehrmacht. Lu carres tuèron l’ingenhur de marina e toi lu sieu òmes qu’avian provat, de bada, de li bandir lo camin de Cherbourg.
Ensinda, la poncha dau Cotentin èra ja infessida e d’aquí en avant, Tonton Jean avia lu Prussians en l’esquina ! Sensa mai landear, au sieu command, li sieu mitralhusas virèron de cent vuetanta gràdos e asperèron que lo nemic se’n tornesse d’aqueu pòrt qu’èran censadi ne’n bandir l’achès… En lo sieu pòrta-vista, Joan aluchet doncas aquela campanha que lo dich nemic auria jamai deugut ne’n venir per faire d’eu – qu saup – un eròe.
Non auguet gaire d’a asperar. Lo matin dau dètz-e-nòu, a l’entorn dètz oras, esboquèron doi camions d’a la crotz negra. S’apressavan lentament dei carretas e tombarèus entraversats en lo camin, segond la gran tradicion de la barricada a la francesa, que Joan li avia soscrich espontaneament, quora si deuguet despegoïr a l’emprovista d’aquela fachenda estrambalada… Cadun, au sieu pòst, sentia s’escolar li darrieri segondas que lo desseparavan encara dau tarabastast e dau fuèc de la guèrra.
Es aquí pura que, d’un camin de traversa, s’abrivet la veitura d’un pacan dau país petoirat de si levar dau semenat, vist que lu events viravan aigre. Foguet arrestat d’a la barricada. Lo baudo ateset la martinica à l’enrabiada, emb una esparancanha e un grinhament de pneu . Sortet coma un esposc de la sieu fanfòrnia, embilat, bracejant, ganassant que lo laissèsson passar. Joan que tenia lu Allemands d’a ment embé lo sieu pòrta-vista, lu veguet s’arrestar.
– Aplatatz-vos ! que li bramet au paisan ; e commandet lo tir. Sensa si far pregar de mai, l’autre arleri faguet lo chume en lo fosson. Tot un, la sieu veitura, arrestada en mitan dau camin, empedissia lo tir d’una dei doai mitralhusas. De l’autre costat, lu Feldgrau gisclèron dei camions e repliquèron a rage, embé de garçadas de granadas e un tir de fusiu-mitralhur. Virèron pi l’esquina e, sensa insistre de mai, s’entornèron devers Montebourg. Gaug pron que lu Tedèscos non avian cercat mai garolha : la soleta mitralhusa qu’avia lo camp líbero èra estada encantada !
A la barricada, durbèron pi lo ridèu de carretas e lo paisan se’n anet en autre luèc jugar embau sieu destin. En tant, calia anar inspectar lo terren e verificar que non l’i sobravan mòrt ò ferit. Joan si pilhet ensems emb eu Dogon, un baudo de Carentan, per li faire d’a cubertura. Sortet lo rabatin espanhòu de la badòca e, l’arma au ponh, se’n anet verificar la resulta dau sieu tir. Non l’i èra ren ni degun… Embé aquò, si posquet espranhar li sièis cartochas per acabar la guèrra.
Tornar mai, mi fau la demanda de saupre cen qu’auria fach Joan, si siguèsson trovats amenaçats de quauque manièra, eu ò lo brave Dogon… Mas alora, arriba l’armier dau batalhon qu’avian mandat querre per adobar la mitralhusa encantada ; Tonton Jean va pi cuntant lo sieu racònt, tant quiet coma l’òli en la jara. Lo saup eu, cen qu’auria fach…
A l’entorn una ora, una ora-mièja, èra au pòst de command, a doi cent metres de la sieu posicion. Faïa lo sieu rapòrt au commandant, quora audet petar la ràfega d’una mitralhusa sieua. S’entornet dau P.C., a pet-bòt sus de la bicicleta de ligason.
Lu sieu òmes avian vist arribar una veitura tedesca, soleta, que s’èra fermada davant de la baricada e avia entamenat un mièg-torn. Esprovedit dau sieu cap-sargent, lu servients, qu’avian lo veïculo en dressura, non sabian tròup cen que si faire : « Bruta petan, que fau, tiri ò non tiri ? avia demandat lo tirur au sieu cargaire – Vai te’n en galera, vetz ! cen que mi demandas a ieu ? as vorgut faire lo caporal, destrigue-ti aüra, lo sabes cen que deves faire »…
Emb aquò, èsto còup, la veitura l’i estaguet, davant de la barricada ; non acabet lo sieu mièg-torn. Minga diaul non èra sortit de la sieu boita, la mitralhusa èra pas estada encantada, l’amira èra justa, lo tir avia portat. Sempre embe Dogon, d’a cubertura, un sargent clavaire dau P.C. en cerca dau trem, e lo sieu famós rabatin spanhòu, Jon anet torna s’entrevar. En la caissa, dai vitres espeçats e dai tòlas pertusadi de picadas de bala, l’i èran doi baudos : « Camarade français, ne me fais aucun mal ; je n’ai fait de mal à personne ! li diguet, lu uèlhs espalancats, un oficier dau pieg sanguinós – Non ! on va vous soigner ! li respondet Joan ». Ai capit sus lo còup, au relais de la sieu votz, a la sieu cara, que Tonton Jean avia viscut, despí, emb aquèla luchada e aqueli sentenças engravadi en lo sieu ment.
Aqueu tedèsco, que charava un francés leterari en escupissent lo sang, èra un oficier-pagador de vint ò vint-a-cinc ans. Basta quauqui minutas pus lèu, se’n sortia de l’òste, à Montebourg, que l’i avia pilhat lo past de miègjorn, coma un bòn borgés : « Je cherchais mes troupes pour les payer et je me suis trompé de chemin. »… De costat d’eu, lo sieu conductor avia lo braç espotilhat. Joan sonet l’ambulança e lu faguet menar ‘tai doi a l’ospitau de Valognes. Non sabi coma ni quora, mas Jon emparet que lo jove Zahlmeister tant ben creat l’i moret l’endeman.
Perqué aquelu doi que faïan lu toristas en arrié dau frònt, que portavan dam en degun, que fugian davant de quauqui carretas entraversadi s’èran fach clavelar aquí, per ren, sensa glòria, coma doi pàntols ? Perqué aquelu doi aplatats devian estar aquí a s’escompissar dau siéu sang, escagassat sus de la banqueta d’una conduite intérieure repintada per la guèrra, quora doi camions de tropas d’assaut, lo matin, avian manco chapat un balin ? Mai que segur que, denant de se’n partir, de prima, lo Zahlmeister avia rassegurat sa maire ; cen qu’arriscava un clavaire, un aministratiu, un drac de carta pista, un frusta belicre… Perqué minga patriòta francés non avia tapat lo camp de tir ? Perqué la mitralhusa non èra estada encantada èsto còup ? Perqué lo caporal avia dubert lo fuèc sensa òrdre ? E aquel òrdre, Joan, li siguesse estat, l’auria donat ?…
Mas dau súbito, Joan deuguet quitar de si faire de demanda que jovavan pus de ren. Se’n anavan ja très oras e lo sieu pòrta vista confirmava cen que li semblava d’aver vist. Delà, au luenh, sus dau camin gran, pareissian lu carres nemics. Aquelu que lo paure pichon lu cercava bel adès per li pagar lu sieu quatre piés, aquelu qu’avian donat lo relais a Saint-Sauveur-de-Pierrepont, aquelu qu’anavan sempre tròup lèu per si pilhar lo temps de faire la guèrra coma l’amiral l’avia emparada : lu Panzer de Rommel se’n tornavan ja de Cherbourg e se’n calavan devers Bretanha. Per anar mai vito, filavan sus la nacionala de vila en vila, Valognes, Montebourg, Carentan e anavan tirant, fins a Brest. L’innocent e pais Zahlmeister escoratava lo Blitz – e lo pagava.
Joan faguet rason au capitani… Que volètz qu’auguesson fach embe lu sieu doi chopet còntra la vintena de carres qu’arribavan, de mai que de si fa escardassar coma lu paures cristos de Saint-Sauveur-de-Pierrepont embe lu sieu doi canon ? Que eroïsme l’i seria estat a finir, en la minuta, espantegat a tròç rossenhe en la verdura de la prima normanda ? « Non l’i podèm far ren », diguet lo capitani. Plantèron tot aquí e se’n anèron a un trentenau de metre dau camin gran, en aqueu camin campèstre que la veitura dau paisan n’avia botat, una man d’oras pus lèu.
Lu Panzer li passèron davant, coma se ren non fossa. Embé un gaub requist, s’èran dubert camin e avian abutat li carretas d’en mitan, sensa li degalhar. Pedonalha e tankista si regarjèron sensa bricar. Lu oficiers de carre anavan drechs, patanuts, lo pieg escompassant dau sieu torrilhon, bèlhs, blonds, vinchitors, cagats coma en lu sants de la propaganda tedesca. Delà, davant dau sieu P.C., lo commandant èra sus lo marchapen, mut, coet, sòdol coma lu autres. Lu Panzer li passèron davant, coma se ren non fossa ; non s’arrestèron mànco per agantar aquel oficier superior. Aquò èra l’òbra de la fanteria que s’asseguissia, mièja-ora darrier ; Rommel avia la sieu guèrra d’a faire, lèu.
Ah ! coquin de bòn lèi ! Li auguesson donat lu sieu 37 anticarres en plaça dei chopets encantat ò dei vièlhi bombardelas dau 17 ! Minga dubi que Dom Levesque auria fach petar lo tròn de l’acident ! Sainte-Mère-église auria arrestat Rommel coma Poitiers lu mòros ; « lo reinard dau desert » seria estat un desconoissut taisson dau Merderet e lo bari de l’atlàntico, l’aberge d’un claus dau bocage norman. Bessai que jamai minga parachutista non seria vengut l’i si pendolar en lo cloquier e que la sieu renomada, la glèia de Sainte-Mère, la deuria en un enfant dau país !
Per faire bòn pés, s’acapisse que Tonton Jean, Dogon e companha bèla l’i serian toi mòrt eròe, « Pour la France ». Serian marcat sus dau monument, emb aquelu dau quatòrze, « la darirèra dei darrièri », emb aquelu de tot aqueli que s’enseguèron, en asperant aquelu d’aqueli d’a venir. Si canteria la gesta dau prèire guerrier, lo beat Joan de Cherbor, enfant – manièra de dire – de la piucela d’Orlean e de Carlo Martel… Segur que non si beuria lo vin de pom ensems emb eu davant d’una pòrta dubèrta sus lu prats mas, Tonton Jean seria un patrimòni de familha, una testificatòria de glòria ereditària.
Tot un, en plaça de si reçaupre la crotz de guèrra embé pàumolas a títolo pòstumo, ò de s’esprefondar en la denembrança dei tombs de l’istòria – embé lu cent mile mòrts dau quaranta, que cadun s’en bate, coma si saup – en plaça doncas, reçaupèron de l’amiral l’òrdre de rendre li armas. Estirassèron doncas mitralhusas, fusius, mosquetons, rabatins de tota raça, en la « Sala dei Festas » de Sainte-Mère, sensa que si saupe jamai cu, dei tedèscos o dei francés, avia augut l’idea d’aquela ironia crudèla. Lo commandant, qu’èra un òme onest e drech, non oblidet de restituir la cartela de Reichmark de l’oficier pagador ai sieu legítimos destinataris, paures, que si podian manco pus pagar un gòto… Si pòu pensar que presentet finda condolianças e excusas per aquela bruta malentenduda dau jove Zahlmeister !
***
Tra la pòrta de la coïna dubèrta sus lo prat, si vetz aüra una bèla nuèch estelada, fonga, pàia. Denant de s’escapar, lu pichoi an desbarassat la « mapa » de la batalha e « Saint-Sauveur, Beuzeville, La Sensurière » son a muèlh en l’aiguier, embé li sietas e li posadas. Estèm tra màgers, Tonton, la frema e ieu. Acabam en silenci lo nòstre góto de vin de pom. Tonton es sempre ben acarat en la sieu cadièra, li sieu mans issugan plan planin la noguièra dau taulier. N’a cuntat lu fachs, n’a donat una cronologia prechisa, mas non ditz ren de l’estat d’esperit dei sieu cambaradas, dei sieu pensiers. Darrier dei sieu belicres, lu sieu uèlhs blu, trasparents, mi regarjan ; veon pura, luenh en delà de ieu, denant de la mieu naisséncia, la cara dei sieu companhs que tamisa sempre sus dei garbins de la sieu memòria.
Tot en un prompt, la sieu boca entra-dubèrta mi menta una expression de sa sòrre Teresa e, per lo promier còup, m’enavisi que si semblan, qu’an creissut ensems, que si son creats en la maion bèla de Mestre Levesque, à Cherbourg, dau temps dei fotòs sèpia… Augi pus far parlar Tonton Jean, augi pus li faire de demanda. Charam encar’n pauc dau moument present, dau frescor ben agradiu, s’alestissèm a si dire bòna nuèch. Carpe diem…
Lu pòdi pura imaginar, lu defensors de Sainte-Mère, en aqueu sera dau dètz-e-nòu de junh dau quaranta, la « fèsta » acabada, encocardats coma s’auguèsson tròup beugut. Toi presoniers, caminavan desarmats de lòng dau camin, capòta dubèrta, correa desganchada, li espalas pèugi d’aquelu braç que jovavan pus de ren e pendolavan, coma de batalhs de picons muts de tant de vergonha. Lu piegs si cavavan, acaurats d’au pés dei balas qu’avian manco poscut provar d’arrestar ; li esquinas si clinavan au pensier de l’agach incrèdulo, velat de làgrimas e d’angois, que de familhas e d’amics luènchs devian portar sus d’autres vincuts, estirassats coma elu en la mauparada. En un autre monde, en una autra vida, en un temps de confiança e de segurança, avian caminat au pas ; aüra, li sieu grolas anavan a bodre, sensa ritmo, trapejant en la bolinada de la Nacion, sensa saupre quora, ni dont, toquerian lo font de la degolada dei Democracias.
Entra lo revirament inversemblable dau frònt, la vigília, e la folia sobre-realista d’aquela jornada, s’acapisse que degun avia manco audit parlar de l’apèl de Barba Carlo. Auguesson pura audit quauquaren que li aurian bessai ren capit, a muelh en lo sieu desper, bòrnis au monde, rampinats a la soleta segurança d’estre pura fortunats, encara vius, embe toi lu sieu sòcis de davant dau delubi ; ensems, coma d’enfants perduts en lo bòsc.
Una bòna part de la nuèch – vòli dire la mieua de nuèch, aquela qu’a seguit lo racònt de Tonton – lo cruci de laissar s’esvanir aquela memòria mi va guinhonar… Un còup de mai m’arretròvi a voler arrecampar d’aiga en un cavanhòu. La vida e lo saber dei èstres son doncas pi destinats a s’escórrer coma lu rieus e lu flumes en una mar de denembrança ? Un còup de mai, mi sembla d’aver tocat dau det la gran tardoqueria de la guèrra, aquela absurdità totala, que l’avii ren viscuda mas acapida pura, a la lectura dau principi dau Voyage au bout de la nuit ò de La Chartreuse de Parme, en La Guèrra e la Patz ò en Le Grand Tropeau. Mi cau notar, faire conóisser l’incredibla fachenda de Dom Levesque e dei sieu cambaradas ; mi cau tornar faire lo passagin. Mas, en la coïna d’a la pòrta duberta sus lu prats, au moment qu’anavam si dire bòna nuèch, un maron de sovenirs es mai vengut espelir sus li bocas de Tonton Jean.
Maugrat que lu jorns foguèsson lòngs en lo mès de Sant Joan, lu paures vincuts non faguèron pus ren d’èsto vespre de despieg. L’endeman de matin, vint de junh, lu alemands lu endralhèron a pen devers Saint Lô e lu s’escortèron, baïonnette au canon. Non faguèron pura gaire de camin ; toi lu pònts de Dove avian petat. Lu Prussians lu fermèron à Beuzeville-la-Bastille, lo temps per lu vinchitors de mentar la vastitat de la sieu victòria e d’organizar, a la sieu moda redrissoa e germana, aqueu desbandament latin.
Durmèron ramencs, en un prat ben claus que costejava la departamentala. Tonton Jean s’enavisa encara – si pòu dire emb una sòrta d’esmoguda, de gratituda – dau Feldwebel que lu norrisset en aqueu calabrun despiechós. Toi non pleguèron parpela, guinhonats de pensiers que li verunavan la consciéncia. D’unu, au contrari, escagassats, còrs e ànima anequelits d’aquela fachenda, faguèron lo chum en lo sòm coma de bambins, boca dubèrta, sensa pus bolegar per ren ; coma lu mòrts dau prat batalher.
L’endeman, Dogon traverset lo sieu Carentan un darrier còup per una temporanha. Non auguet manco l’idea de la s’esbinhar, d’intrar en un mazaguin, de s’estremar en una escalinada, un canton, un pòrtegue… e ganta sòla, líbero ! Manco ! Ni eu ni degun… Calia beure lo calici de la fala e sudurar lo castic ; e pi, lo cap-sargent-Dom Levesque avia fach cautela, sus la sieu persona, de l’integritat dau gropa ; alora… Lo sera, après d’una jornada de caminada en la tufa de la debuta d’aquel estiu desgraciat, arribèron a Saint Lô, caserna Bellevue. Per cu conoisse la vida de caserna, li jónher encara aquela de presoniers constituisse magara la secadura màger. Gaug pron per eu, Joan l’escapolet.
De fach, quora lo curat de Saint Lô emparet que lo sieu vicari s’èra entornat de la guèrra, faguet l’assedi de la Kommandantur per lo s’arrecampar. Un oficier, magara quauque luterian – socitós de l’edificacion d’aquelu pòbles d’aquí en là sotomés a l’autoritat dau Tèrço Reich – consentisset a laissar Dom Levesque se’n sortir lo matin per anar complir la sieu jornada. Calia contuniar d’emparar la doctrina ai pichoi e anar tirant embe tot aqueli cauvas que fan una vida de vicari. Lo sera s’entornava durmir a la caserna.
D’aqueu privilegi, d’aquela libertat d’anar e venir, naisset en eu, estranhament, ben mai que l’achetacion, la volontat e lo sentiment d’un dever per eu d’estar presonier. Ensinda, lo sieu portament per li annadas negri que s’enseguèron, seria inspirat d’a la necessitat dau servici materiau e espirituau dei sieu cambaradas de mauparada. Partisseria lo sieu patiment. Pòrgeria lo solàs ; sensa s’entrigar de tirar quauque benefici personau de la sieu posicion, sensa provar de milhorar tant si pòu lo sieu destin individuau. Partisseria lo destin dau gropa, sensa provar de fúger la companha d’aquelu embe cu si talhonava aqueu pan negre de la guèrra, pan negre de l’amistat, Pan de l’eucaristia. Seria, coma diguessiam, lo Bertomieu de Joan Bodon e pura, ren lo pantais d’un òme solet mas, un Bertomieu de carn e d’òs, un crestian tra lu sieu semblables.
Emb aquò, sus lo còup que lu òmes emparèron que lo cap-sargent podia anar e venir au defòra, li confidèron de comissions, li demandèron de faire passar de corriers au travers de la censura. Li familhas s’organizèron per espòrger un pauc de piés, quauqui provistas, manièra de milhorar l’ordinari dei presoniers. Lo vicari èra en l’emplec que s’èra chausit, en lo sieu ròtle secolier ; acabada la sieu òbra pastorala, s’entrigava d’aqueli pichini cauvas qu’ajudan lu embarrats a sudurar l’absurditat de la desobrança e a contunhar de mestrejar quauquaren en la sieu vida de mariòta.
Ben segur, s’atrovet lèu un pàntol per far trabucar aquel adobament convenient dei convencions internacionali. A la fin d’octobre, lu tedèscos menèron una refestonada generala. Coma si saup, cu cèrca tròva… Liegèron embe totplen d’interrés lo corrier qu’un baudo dau país èra a man de far partir. Li diïa a la familha : « Contunhatz de mi mandar de nòvas e d’argent per via dau sergent-chef Levesque… » Tabalòri ! En un biais, encara pron que tot aquò faguet gran bacan en la caserna e fin a la Kommandantur… Ensinda, un jove marinier de Cherbourg, que lu alemands emplegavan coma interpreta, posquet avisar Joan de pas portar ren a la caserna aquesto vèspre.
De retorn Quartier Bellevue, man en borsa e pluma au vent, Joan que faïa bus, foguet aculhit a la sala de garda. L’adusèron en un oficier que, après dau sieu numerò d’espatof reglementari, l’aviasset en la rega de la prochedura admenistrativa. Mandat a la Kommandantur, comparisset davant dau promier Gerichtsoffizier de la sieu vida de Kriegsgefangener. Respondet a l’interrogatòri… Cau dire qu’en lo quaranta lu Prussians èran pas encara alenats en aquel exercici. Bessai tanben que d’unu, credenciós, la si creïan sempre « Eric von Stroheim en La Grande illusion ». Si pensavan encara de poder conjugar Nazisme e tradicion de l’Alemanha eterna, Wehrmacht e convencion de Ginèbra, guèrra e Judici Universal, consciéncia individuala, patin e cofin… Emb aquò, Dom Levesque respondet embe una bèla mótria au sieu oficier de justícia e finda, la si posquet gòdre de si menchonar dei sieu custòdes.
Ne’n ri encara aüra, aussant lo sieu gòto de vin de pom, coma se portesse lo brinde en aquelu patalocs ! e lu si regaunha…
– Konoizèm lu noms d’akelu k’avetz atjudat !
– Siatz fortunats, ieu lu conoissi ren !
Cercavon de ne’n saupre de mai, mas lo capelan èra pas cascat embe la darrièra raissa. Contunhet de faire nhassi e lu Prussians auguèron ni pròva ni confession. Marquèron pura sus de la siéu carta de Kriegsgefangener : « A portat ajuda ai fugidas, provedissent viure e argent ai sieu sòcis ». Ben segur, li faguèron petar la sieu permission de sortida e Joan si deuguet acostumar a la vida de presonier. Lo curat de Saint Lô eu, s’atrovet confrontat ai duri realitats de la guèrra e per fòrça, si destriguet embe lu sieu paroquians, sensa vicari.
Tant tot un, aquela vida non èra per durar de temps. Lo vint-un de novembre a miegjorn s’atrovèron sus lo quèi de la gara. Foguèron cargats en de vagons dau bestiari, tau coma èra marcat sus li pòrtas : quaranta baudos ò vuèch cavaus per veitura. Tot aquò èra carculat, m’esplegava Tonton Jean, que lu quaranta baudos posquesson tenir just just d’arrelongat. Aquí mai, si pòu mentar qu’en lo quaranta, si respectava encara lo reglament… Es aquí tanben, que lu cambaradas de Sainte-Mère foguèron desseparats. Segond un òrdre alfabètico, Joan puet en lo vagon dei « L » coma Levesque. Deuguet tralaissar Dogon e lu autres, cadun la sieu iniciala, en aquèu marca-mau de pichin tren abecedari.
Èran doncas entraïnats, embe d’aiga en li bidòlas, un pan per un, quauque pauc de saucisson, sensa manco un cendreiròl de palha espantegat sus lo sòl, devers l’insaupuda d’una destinacion de vincut ; dont ? quora ? quant de temps ? Lo vint-a-cinq, après d’aver traborsat Belgica, Olanda e Alemanha dau Nòrd, èran en Vesfalia, quora enfin si durbèron li pòrtas. Faïa très jorns que toi aquelu bèlhs masclons, conceuputs en la glòria dau repaus dau guerrier e l’abriva victorioa dau dètz-e-vuèch, rebulhian en l’odor de covat d’aquela umanitat umiliada e claustrada en lo sieu porquier. Lu mai fortunats tra elu se’n valèron de tenir li sieu bràias fins au promier boisson. Auguèron una ora mièja per tirar l’alen, escambetar un pauc e, sortent de la nuèch dei vagons, s’embarlugar dau barlum fosc dau setentrion.
L’endeman de matin, vint-a-sièis de novembre, èran sus lo flum Oder, a Furstenberg. A pen, en la nèu, jonhèron un gran camp dau Stalag drei B. Mau norrits, mau tapats, semblavan lu « gronhards pichoi » dau Soterrament de Verlaine, qu’anavan tussent, escupissent, esparant sus de la glaça. De fach, aqueu traïn pietós soterrava metaforicament l’esperança e lu combats de doï generacions sacrificadi.
***
Siam toi radunats en lo salon de Tonton Jean, charram torna d’aquela conversa de la vigília au sera en coïna e acabam, manièra d’aperitiu, la botilha de Bordèu que sobra dau darrier past. Vòli ragantar lo fiu e entraïni mai Tonton sus de la sieu posicion – objectivament afroa – de prèire-sordat. Sembla pura que siáu ben lo solet guinhonat per aquest afaire… « Ai jonch l’armada coma toi lu ciutadins francés » ; non sauprai ren de mai de la consciéncia de Dom Levesque. Tot un, ruèissi una bèla avançada : es d’acòrdi que repilhessiam tot aquò ensems, dau principi, que pilhessi nòta dei sieu paraulas ; sembla finda esmogut de l’interrés que pòrta un òme jove a la sieu vida, a la sieu modesta persona. Siáu esmogut parier, d’a la sieu confiança, d’a l’idea que tòca a ieu aüra d’espòrger lo sieu racònt. Lo farai a la mieu mòda, sensa tradir l’òme, sensa manco tradir la realitat, mi pantaiant pura una veritat nòva. Mi senti laugier ; lo vin jonhe un plesir físico au gaug de l’òbra que m’aspera. Cresi que partissèm ‘tai doi aqueu sentiment de comunion tra de vidas, d’èpocas, de generacions diferenti. Siáu urós de mai esprovar aquò.
Jugam en un decòro d’un autre temps. Ai parets, lo papier es ros coma la rauba dau Cardinal de Richelieu. La taca de la cheminuèia de màrmor blanc menta la dentela dau còl de Son Eminéncia. Dessobre son pauvats lu portrets dei antenats e, estranhe entric d’a Mossur lo curat, un parèu de duèlhas d’aram de la darrièra guèrra, lusenti e asticadi coma li guingalhas de paura ma mairgran… Siáu acochairat d’a la problemàtica dau sabre e de l’aspersòri !
Sobrias de l’ostau de mèstre a Cherbourg, quauqu mubles rococò son constrechs en aqueu pichin presbitari. En un canton, una pendula rustica està muta despí d’un vièlh escombulh. Dau temps dau desbarcament, vesin d’Omaha ò d’Utah Beach, sabi pus, la maion s’es esprefondada tot a l’entorn d’aqueu muble. Lo relòri es estat drech, au mitan dei gipàs ; l’avia escapolada dau destruci, ti sabi coma ; mas parèisse que si veon soventi fes de cauva ensinda en temps de guèrra. Tonton mi fa vèire la marca que la pluèia a pairat laissar sus de la fusta, en tant que pòsque venir tra li roinas, arrecampar aqueu solet sovenir de sa rèire-tanta. Mi fa vèire tanben l’adobament rústegue que li a fach lo fustier de Quinéville. Charram, escolam lo nòstre gòto, siam pactis ; deman repilherem tot aquò, a l’escrich, en lo burèu que Tonton Jean li travalha cada jorn que lo Bòn Dieu fa.
Genoier dau quarant’un, Nach Berlin ! Mas, èsto còup, ren per « anar talhar lu barbís a Guilhèrmo »… Vint sota zèro ; e mai lu vagons dau bestiari per un jorn e una nuèch de galeròto, fins en una estacion de borgada dau ponent de la ciutat. E mai a pen sus de la glaça, a s’acipar coma de palhassos, fins au camp de Lichterfelde ; un, tra lo centenau de camp dau Gran-Berlin. Verunat dau frèi, brut, magagnat, li semblet ben bòn lo marrit bròdo de cafè que li donèron en arribant, a quatre oras dau matin. Es aquí, a Lichterfelde, que foguèron pi decorat dau « triangle negre ». Tau èra lo privilegi requist dei Kriegsgefangene de la capitala, que l’escapolavan ensinda dau mau-vistós « KG » pintat en l’esquina de toi lu autre presoniers de guèrra dau Reich.
Ach ! Berlin. Joan avia d’a l’i estar encar una temporanha, fins a tant que li bòtas dei russos venguesson tirar de cauç e revirar la carònha brostolida de Barba Dòrfo. Per lo còup, l’i èran pas encara, lu rùssos, aqueu predinar de la mitan de febrier dau quarant’un, que lu sòcis avian organizat un tornès de carta per devagar la nòia que s’enraisava en li cambrada. Un gàrdia venguet cercà Dom Levesque e destraïnar la sieu partida : « V’enkaminaz ! ». Se’n anet doncas embe lu sieu atràs, escortat d’una sentinela en arma que devia conóisser la ciutat tant coma lo sieu presonier. Prenguèron lo metrò, lo trambalan, anèron en çà, en là, m’aqueu tardòc dau càscol que, a cada moment, demandava lo sieu camin. Acabèron li sieu viroluènhas au calabrun, au camp de Malchow.
Èra un kommando « agricole ». Lu presoniers travalhavan, per la màger part, en un gran teniment de la vila de Berlin e d’unu en li fermas de propietari de l’environ. Dei vuetanta òmes que cuntava lo camp, sessanta avian demandat a poder vèire un prèire !
Es pura dificultós de si crèire que lo setanta-cinc per cent d’aquelu baudos èran pi catòlicos e practicants après la Revolucion russa e lo Front Populari. Per tant que foguèsson toi estats paisans, inhorantàs, credenciós, respetuós dei institucion, dei capelans, estacats à la religion, ai sieu cloquiers, ai sieu capelas, si badant au mistèri dau latin, rebulhits en devocions, embarlugats d’ai daurura e d’ai faus-màrmors d’un barròco de gíngeri, estubats e domestegats a l’encensier coma d’abelhas en lo brusc, garis de glèia, arnas de sotana, mofa d’incens… per tant doncas, tot aquò non auria poscut esplegar aquela fòga repentina de pregar. Calia ben pura si rassegurar, coma lu naufragats sus dau radèu ; si radunar, far nàisser un esper e lo reparar, lo faire crèisser ; crèire, en la Providéncia, en lo sieu Destin, en un Avenir en delà dau revèrs. Coma lo di simplament Roqueta : « I caliá Dieu per poder sofrir aquel mond ».
Lo predinar, Joan si pilhava lo sieu pichin autar camalable que tenia en un taül e se’n anava dire la Messa en un autre pichin camp esprovist de prèire. Au principi, èra escortat d’una sentinela, mas lèu lèu, lo laissèron anar d’a solet portar la paraula divina a’n aquelu desgraciats que l’asperavan, per ben dire, coma lo messia. Lu tedèscos avian vito capit que jovava de ren de bregalhar lo temps d’un sordat a passejar emb aqueu capelan pasi coma l’Anhèu de Dieu e que refudava per principi de la s’esbinhar.
Aquela vida anet tirant quinze mès. Auria poscut durar ben mai, l’onestat e la drechura nativa de Tonton Jean non l’auguesson descontunhada. D’estiu dau quaranta-doi, lu sieu « paroquians » l’informèron dei furts que devian sudurar d’a part d’un caporal que s’èra mandronejat emb una coïnièra dau camp, e avia armanescat un tràfegue embe lu còlis que reçaupian lu presoniers. Finda en Alemanha, lo bòn manjar si faïa quist… Joan, que non crenhia ren, levada l’ira de Dieu, faguet tant d’anar cercar garolha en aqueu Gefreiter ! Es coma aquò que s’atrovet per lo segond còup de la sieu vida davant d’un oficier de justícia. Emparet ensinda que la sieu ficha l’avia seguit, despí de la Kommandantur de Carentan. Dau bòn ! aquò, si qu’èra d’organizacion ! En lo burèu dau Stalag, Lo Gerichtsoffizier prenguet nòta de tot.
Per cen qu’es dau Gefreiter, lo judici èra ja bèu que lest : Ostfront ! Se’n anet doncas vèire au levant, dau costat de Stalingrad, se lu còlis arribavan ben… D’aquí fins au quaranta-cinc, bessai que pairet reçaupre un d’aquelu « còlis » que lu rùssos li mandavan a breti ai tèstas-mati de la crosada anti-comunista e ai marrits ciutadins dau Reich. Si porria ben que lu sieu tòtos l’i siguesson sempre, en la tondrà !
Lo rigor de la justícia tedesca non foguet tant ert embé lo capelan. Si contentet de lo relevar dei sieu fonccions d’armonier. Per un mes de peniténcia, lo mandèron travalhar en riba d’un lauç, en lo pichin camp de Falkensee. Ancuei, embe lo recul, si saup qu’Alemanha avia entraïnat e planificat lo pilhatge d’Euròpa. L’aflús de presoniers faïa d’a manòbra a jaba per lo formidable esfòrç industriau de l’economia de guèrra, mas finda per tota raça de ravarias ò de mostruositats. Cu si pantaiava quauque estrapàs avia que d’a picar en aquela mana inombrabla e que costava ren.
Es ensin que Dom Levesque s’atrovet engatjat en aquela òbra tardòca de s’anar talhar de pichins cadres de gerps en riba dau lauç. Lu si trasplantava pi a l’environ dei barracas dau camp per li embelir d’una corona de verdura campestra ! Lu mèstres de l’empresa li devian pura gaire trovar lo sieu ganh, que Joan non li s’afarava tant. Per oltre, si saup que lo rendiment de l’òbra forçada es sempre gravat dau trateniment dau custòde.
Joan non s’enavisa dau sieu nom. Èra pura un bòn bàudo lo custòde, petoirós ; Faïa tant de li repepilhar « los ! los ! » cada còup que Joan si pilhava un bòn banh en l’aiga fresca dau lauç – segur qu’aquò èra bandit ! Si devagava, si polinava en li vetas d’aiga gelada coma un animau en la sanha, chumava sota la pèu de la surfàcia, s’esguilhava en aqueu monde silent e apagat, laissava ‘namont guèrra, òdi, folesc ; quora remontava si pilhar l’alen, saludava, bofant d’esposcs d’aiga, coma una cavala a l’abeuratge. D’aqueu temps, l’autre patalòc trapejava, s’encaïnava, sudava dau caud e dau timor, en lo sieu unifòrme e la tufa d’aquel estiu dau quaranta-doi. Època de gran tabaloria ! Lo custòde arriscava mai que lo sieu presonier : l’espaventalh dau front dau levant bletassava lo zèlo d’un poble entier, entraïnat en una ravaria que non l’avia vorguda empedir, e per ben dire, la s’èra un pau cercada… Lo sudor dau garda èra la revenja de Barba Joan.
Emb aquò, au principi de setembre, peniténcia complida, abasanit coma un congé payé, Joan s’entornet a la sieu òbra d’armonier. La kommandantur decidet d’una nòva afectacion : Kommando 712, Spandau. Jonhet doncas lo Nòrd-Oest de Berlin, coma de costuma, mièg perdut tra metrò e trambalan, escortat d’una sentinela que la s’estirassava, mai que la si seguia.
Lo Kommando 712 èra un camp pichinet, ben adobat, poblat de presoniers francés partit en doi baracaments e que lo mètge l’i avia lo sieu cambron personau. Divina sorpresa, lo parier cambron, provedit d’un pichin autar, asperava Dom Levesque. Embe lu autres camps dei environs, lo 712 assegurava una manòbra a breti e a jaba, doi cent metres pus luenh, per la Märkichekabelwerke, usina de fustaria e de fiu elètrico. Gaire luenh de l’usina, manco, l’i èra un autre camp qu’assostava de joves Ukranians – mascles e fumèus – deportats dau travalh ; una raça de STO dau front dau levant, mai brutelos e racista, estent que si tractava de far ruscar la sota-umanitat eslava, de fòrça e a jaba.
En aquela fin dau quaranta-doi, la Royal Air Force se’n valia quauque pauc de trapassar li defensas antiaeriani allemandi. La Luftwafe començava de s’atrovar delubida sota lu marons sembre mai numerós de bombardiers que s’avaravan sus dau Reich, sensa autra proteccion qu’aquela dau Bòn Dieu : lu Spitfire podian pas escortar lu Lancaster en de là de la Mar dau Nord. Tot un, lu nòstres amics englés metian en plaça la sieu famosa estrategia de l’Area bombing ò dau Moral bombing, sus de bressalh civil. Tanta Chiqueta segava dur, tant sus tèrra coma au ciel. Li ciutats si garbavan de sostas conceupudi per reçaupre de milanta de gents, li cròtas s’adobavan en cambradas ; l’umanitat regaunhava lo tarpon.
En aquel autom, la nuèch alemanda repetinava ja dau tir de la Flak e dei eschuèps dei òubus anti-aerians que faïan esplandir en lo cièl negre de centenaus de nebletas blanqui. Au sòl, la scena èra candeirada dai ulhauç de partença dei bòtas, que lo sieu trelutz arrutat cascalhava lu actors coma un estroboscòpo. En l’ària lu projectors balavan, en cerca dei avions. Li filanhas de fornigas dei balas traçanti li venian darrier e lu sieu picotats dessenhavan de parabòlas. De tant en tant, un d’aquelu corpatàs estramassat quilava, rolhat de flaras grassi, e cogia devers lo sòl l’arc de fum que l’escochava ; cada en tant, n’eschuepava un ‘namont en lo cièl, fuèc d’artifici joiós de toi aquelu que, ‘navau, avian estentat per l’abrandar. L’aucelàs saludava cadun, semenant lu sieu tròç que cascavan en virolant e s’escricençavan, d’aquí d’alhà, sus li maions ò per carrièra.
Es aquò que, en lo camp dei Ukranians, la barraca dei fremas, tocada d’a una bomba incendiària, flambejet coma un fenier. Lu Francés foguèron pregats de si radunar en un solet bastiment e de laissar lo segond en aqueli pauri pichonas qu’avian tot perdut dau pauc que li sobrava encara. En borbotant, lu sordats s’esquissèron coma li amploas de la cançon. Aqueu tórbol sirvia pura una causa justa, nobla, generosa. En mai d’aquò, la vesinança feminina non èra per esprefondre lo moral dei nòstre valents Piou-Piou ! Aquela fachenda deuguet mandar de gisclanhas d’imaginacion, de rires, e de fantasmas a ofa… Segurament, siguet una fònt d’esper, de volonat d’èstre, d’estar fièrs e vius, druds en la mauparada e l’absurditat.
Maugrat tota la misèria dau temps, lu gaugs e lu goais estent relatius, lu presoniers de guèrra francés èran « ben » norrit. De fach, calia qu’aquelu que travalhavan per Groß Deutschland auguèsson la fòrça d’obrar sensa petar coma li moscas au promier freium. Per oltre, aparat dai convencions de Ginèbra, podian encara reçaupre aquelu famós còlis que faïan bavassear finda lu tedèscos. Emb aquò, en un gran varasc de generositat – inspirat d’ai valors eterni dau país de La Carmagnole e de Maréchal nous voilà – lu sota-oficier estabilissèron l’usança de convidar ai sieu merendas quauqu’uni d’aqueli Ukraniana mesquini. Joan e lu sieu sòcis si pilhèron doncas lu past dau dimènegue de sera en companha d’Olga, Maria, Anna, Natasha « e encar’ una autra ».
Toca pas a nautres de clarejar lo sens d’aquela « autra » en lu esgàrros de la memòria de Tonton Jean.Tant tot un, m’asseguret que tot aquò si passava « ben coma si deu », e o mi cresi. Mas sabètz pura coma es, si pòu ren empedir la gent de pensar a mau, finda en Ukrània. Un sera que la nòstra acampada franco-soviètica pastrolhava paisament e mastegava d’apetit, una dei cinc pichonas chumet tot en un còup sota lo taulier ! Non vos faire d’ideas estòrti, s’èra esconduda perqué davant de la fenestra avia vist passar lo sieu calinhaire ukranian, que eu auria poscut pensar a mau…
La vida de Joan s’estirassava coma aquò, per ben dire, encara pron líbera e desobrada per una vida de presonier. Destacat dei vanitats d’aquèsto monde, esprovist dei sentiments d’òdi e de rancor que la majorança dei sieu companhs remuavan a l’encòntra dau pòble dei sieu custòdes, Dom Levesque entraïnet d’emparar l’alemand embe lo metòdo Assimil. Aquela platina e la sieu curiositat naturala li permetèron de mestrear convenientament la conversa correnta e d’entratenir de bòni relacions embe li autoritats e la populacion.
Aquelu estudis non menèron pura Tonton Jean ni a la lectura dei filòsofos, manco a’n aquela dei poetas tedèscos. L’aviacion aliada descontunhava sempre de mai l’aprendissatge d’Assimil e de la bèla lenga de Goethe ; en lo quaranta-très, es a viure sota li bombas que cauguet emparar. Cadun avia un sacon, sempre lest, embe un pichin necessari, quauqu viestits, quauqui relíquias e a cada alerta, un filava ai sostas. Que fastidi, a cada còup de sirena de s’anar entanar coma de garis en l’espussa e l’escurcina estofanti d’aquela fòga de gents escombulhada, despoderada, tralaissada au sòrt dei picadas de bomba, espranhada, aclapada viua ò escanada, segond li volontats sorni de dieus estravirats.
En lo quaranta-très, lu bombardiers englés auguèron mai d’aisetat a venir croassear sobre dau Reich. D’aquí en avant, èran escortat d’ai chassurs Mustang, qu’èran provedits de tinas largabli e avian ensinda pron d’autonomia per reparar lu Lancaster tot au lòng dei sieu missions. Ailàs, cadun avia pas mentat aquela novitat e encara manco emparat a viure sota li bombas. D’unu ajudavan finda lo sòrt – ò lu dieus – a faire la destria tra tuats e sobrevivents. Lo seze de genoier, un gran red aerian amacet cinquanta-sièis presoniers francés e ne’n destropiet quaranta-cinc : cent un baudos, alassats bessai d’aqueu bolum perpetuau, d’aquela ravaria de forniguier, alassats de si sentir denembrats, remplaçats d’una man de Rin, collabos de l’autre, alassat d’estre lu pàntols de toti li propagandas, de s’atrovar despossedats dau sieu destin d’eròes, de manco pus poder jugar embe la mòrt, alassats, emb aquò, d’aquela vida de palhasso e qu’asperavan que li bomba aliadi li vorguèsson liberar d’aqueu folesc ; cent un baudos, alassats e pas mai magara ; simplament flacos de s’estirassar fins a la sosta, e qu’estaguèron en li barracas de bòsc, espòsts au semenar de la mòrt cascat dau cièl.
Mas la guèrra es la guèrra, destimborlada e sempre un pauc sobre-realista. A jamai empedit la vida de faire tirar contunha. Aquelu que seguian li consinhas de segurtat pairavan la si gòdre d’un pauc de bòn temp : Joan e lu sieu sòcis la si pilhavan bòna embe lo reglament e, n’aquel estiu dau quaranta très, s’anavan banhar en lo Havel. « Lu Francés si van banhar, que lu nòstres òmes son en Russia », borbotavan aquelu qu’avian votat Barba Dòrfo…
De fach, Russia començava de si surbir lo sang d’Alemagna e lu sordats se’n partian sempre mai nombrós femar lu gerps de Barba Jousè. Non si podia pus tratenir de custòdes a breti per tenir d’a ment aquelu porcàs – Schwein ! – de Francés. L’aministracion, sempre furba, si carculet un tor de guinharòta ben finàs : lu presonier nen fan mestier perqué travalhan ; s’avèm de presoniers, lu cau gardar. S’avèm pus de presonier, avèm pus d’a besonh dei custòdes…
L’autom vengut, lo seze d’octobre, Joan venguet « presonier de guèrra en congiet de captivitat sus plaça » : toi aquelu qu’avian achetat un pòst de travalh èran mudats en « civil » e avian tota libertat d’anar e venir en lo Gran Berlin, en defòra dei oraris obrats, s’acapisse. Aquelu qu’avian refudat aquel estatut foguèron clavats en de camps embe miradors e barbelats, aisats d’a gardar, sensa tant de custòdes…
Joan èra armonier dei sieu sòcis a la Märkiche. Deuguet, per l’i estar e l’escapolar dai camps e dai barbelats, tenir un pòst aministratiu a la direccion de l’usina. Lo baile de l’empresa, Herr Doktor Schneider, l’avia fach assetar en lo sieu burèu e, en un francés embibit de l’esperit dei Lumières, li avia acordat très quart d’ora de matin e de sera, sus dau sieu orari obrat, per assegurar lu Servici Divin. De retorn en lo sieu sècolo despiechós, Dom Levesque faïa fonccion de clavaire dau servici de manteniment e d’adobament dei machina-outís. Alestissia lo programa e la ficha de travalh de cadun ; de fach, èra segretari dau còntramestre, Herr Kolibaba.
Era pas una marrida pèu aqueu Kolibaba. Era finda un bòn baudo. Travalhava en bòna amistat embe Dom Levesque ; devia estre catòlico finda eu e aquò li fa per adobar lu afaires. Si podia fidar en un segretari onest e durmir pasi, l’òbra èra facha e ben facha. En aquelu temps, èra un pauc coma una segurança còntra l’Ostfront, ò lo viatge en Polònha…
Era una vèra benediccion aqueu curat, non si tractava de li cercar de nièras ! Joan, eu, èra aquí coma un póchol, si faïa la conversa en alemand, avia torna pilhat l’estudi d’Assimil e mancava de ren. Lo sieu pauc d’òbra acabada, pairava exerçar la sieu mission de prèire, aquela que riegia la sieu vida. Lo matin diïa la Messa, lo predinar vesitava lu ospitaus, lu malauts dau STO, lu ferits dei bombardament ; lu soterraments finda. Lu grans reds aerians dau vint-a-doi au vint-a-sièi de novembre, per exemple, li donèron pron òbra.
Ensida, la vida de presonier s’estirasset tot l’an dau quaranta-quatre, tra Herr Kolibaba, lo pichin burèu de la Märkichekabelwerke, li Messas, lu bombardaments, l’ajuda ai cambaradas, lu ferits, lu cadabres, la desperacion o l’esper, la ravaria dau temps. Devers la mitan dau mès de decembre, Joan foguet convocat a la direccion dau stalag Drei D, Belle Alliance Stasse, que bailejava un centenau de kommando. Deuguet s’entornà dire adieu au sieu amic Kolibaba e ai sieu cambaradas de camp e de travalh ; a Olga, Maria, Anna, Natacha e a « l’autra » finda : Lo gran jugaire de dàdols de l’aministracion avia arrecampat doze confraires prèires, cascalhat lo sieu gòto e espantegat lu capelans sus dau tapís dau Gran Berlin. Cadun se’n partet mai coma en lo quaranta un, arnesc sus l’esquina e s’estirassant la sentinela reglamentària.
***
En lo burèu dau presbitari de Quineville, ai ja escribachat quatre pàginas d’aqueu papier jaunastre e estopós, arrancadi d’un vièlh caièr cordurat, que Tonton Jean li m’a donadi per pilhar li mieu nòtas. Tau lu vinatiers, estramudam la memòria. Joan a dubert lo luquet de la tina : doi pichins libretons, d’aquelu que tenon en una borsa, e que durmian ensems, ligats emb una elastica, en la cròta escura dau tirador dau burèu. L’ària frèsca de la votz de Tonton Jean, dau sieu comentari, torna donar vida au vin vièlh que ràia, l’oxigena espelisse lu sieu prefums, fa belugonear la sieu rauba rossa, cremesina coma lo sang ; sang dau Crist, sang versat d’a toi lu mòrts d’aqueu raconte, d’a toi lu mòrts de la guèrra. Siáu aquí, embe lo mieu tortairòu, quauqu degots m’escapan dau segur, mas la miéu bota si iemplisse a pauc a pauc. Mi porterai pi aqueu vin a maion. Lo caurà laissar pauvar, s’arremontar après li maganhas e lu repompèus dau viatge. Quauque jorn, quora serà madur, lo mi caurà tirar en botilha. Lo tasteretz, e me’n diretz de nòvas…
Dom Levesque e ieu fèm una pausa. L’oudor de la cròta n’a fach un pau virar la tèsta… Manièra de charrar d’autra cauva, manejam lo « Stereoscòpo de Brewster ». Es un bèu pichin istrument optíco, fustejat de bòsc de periera, coma li escaires dei arquitectas. Un binoculari es ficat au bot d’un reglet. Sus d’aqueu reglet, un sabaton, que pòu anar e venir, pòrta una placa fotogràfica de vèire. La placa, retangulària, mòstra doï vistas parièri, una de costat de l’autra. Se regarjatz en lo binoculari, basta de menar lo sabaton a la bòna distància dei uèlhs per aver una vista en relèu ! Amiram lo monde d’avant dau quatòrze, d’avant lu grans chaples, lo monde de Papà Levesque. Lu pichoi son viestits d’a marinier, li pichonas pòrtan de grans capèls de palha redons ; bèu temps passat.
Tonton Jean a repilhat la lectura dau sieu jornal de guèrra – e ieu lo lapi. Li datas s’assegon, una après de l’autra, coma lu grums dau rosari, embe sempre li quauqui senténcias d’un òme qu’avia pas tròup de temps a bregalhar en l’escritura ; de senténcias coma de sùplicas que tot aquò non recomence… Vira encara una pàgina. Quant fa de temps qu’an pus vist lo jorn, aqueli pàginas ? Quant fa de temps que Joan non a tornat lièger la sieu istòria ? Perqué la drevilhar per ieu, que veni d’en galera, que parli una lenga estranha ?
– Mil neuf cent quarante-cinq !
Va ben, veirem tot aquò pus tardi…
Dom Levesque avia donca laissat lo sieu amic Kolibaba, lu sieu cambaradas, Olga, Maria, Anna, Natacha e « l’autra » a la Märkichekabelwerke ; entamenet Lo quaranta-cinc en un pichin camp de trenta presoniers, embaranhat de barbelats, vesin dau metrò Zehlendorf. Joan travalhava sempre, segond li sieu qualificacions conoissudi e provadi, en una grana basa de l’intendéncia militària tedesca. S’entrigava de gerir lo materiau de burèu : lapi, reglet, fuelh e companha bèla… A la guèrra, coma a l’escòla, tot aquò li fa mestier ! En aqueu novèl emplec manco, lo mestre non petoirava tant Dom Levesque. Joan pairava jugar au fot embe lu sòcis, embe la gent dau quartier, embe lu gardas, un jove sobretot, un pichon, engimbrat dau lo verd d’aram de l’unifòrme e avanat en lo brandi macabre de la guerra. Lu demònis de l’òdi estentavan, de bada pura, per s’empadronir de l’ànima de Joan.
Lo quaranta cinc ; toplen de pertús en lo jornal de Tonton Jean. Alerta esquasi contunha ; jorn e nuèch, cada en tant « Ai sostas ! » ; es mai qu’una armada – finda tedesca – ne’n pòu sudurar : d’a lo mès d’abriu, lu militaris an ben capit que per elu, tot es finit, acabat. Lo Reich a fach tòpica, Alemanha s’esprefonda, la Wehrmacht consuma coma la nèu au mès d’abriu, tot bèu just. Non si tracta manco pus de sauvar lu mubles mas de si levar dei arpas d’una mòrt anonciada, de botar coma de lingostàs au passatge dau dalh de Tanta Chiqueta, que belugonea coma l’ala d’un avion. Emb aquò, ganta sòla, dau general au segonda classa ; e devers Ponent ! Tant qu’a si rendre, tant qu’a recomençar una autra vida, vau mai de si destrigar per si chausir lo bòn vinchitor ; laissan cascar Barba Dòrfo, es pas per s’anar picar en lu braç de Barba Jousè ; « E viva la Libertat ! » coma di Barba Sam. Aquelu que volian morir, avian que d’a si far tuar…
Presoniers – e populacions – s’atrovèron doncas tralaissats aquí, tra balas perdudi e eschuèps de bomba. Toplen paguèron de la sieu vida la ràbia dei darniers defensors, l’òdi de revenja de l’Armada Rossa, l’ embourniment de l’area bombing.
Lo racònt de Tonton Jean mi fa mentar un episodi que l’avii esquasi denembrat, mas que lo sieu pes dramàtico m’avia marcat. Èri encara un escolan e una vièlha frema m’avia cuntat aqueli cinc annadas que li avia passadi a asperar lo sieu òme presonier en Alemanha. Es just en aquesta prima dau quaranta cinc que lo paire dei sieu enfants, lo tenent-coronèl Lair, moret sota li bombas dei sieu aliats. Après cinc ans de captivitat, veïa enfin venir lo temps de la libertat e la fin de l’umiliacion. La siéu vèdola doncas, mi donet lo sieu càscol, qu’au sieu cadun se’n batia coma de l’an quaranta… Pòrta lu quatre galons argentats, pintat a man, sota lo blason que mòstra una alegoria emberida de la República, embe la precision « R.F », per aquelu que capisson pas ben li figuras d’estile. Aqueu càscol, lo mi tèni en maion, emb aqueu dau rèire-barba Veran, ornat eu d’a la tromba de caça.
Mas, per s’entornar ai nòstri feas – e sensa si cercar de menchonadas aisadi – estaguèron basta très colhons per li gardar. Mi cau pura jontar qu’aquelu que non segon l’aissòrt, per estar en la metafòra pastorala, non son jamai de palhasso complet : lo feldwebel qu’avia ja resistat, embe doi sordats, au maron repentin dau desbandament, non si laissava gassilhar dai rasons e sùplicas dei sieu presoniers que lo volian far fúger a tota fòrça ! Joan li espleguet que si garderian ben d’a solet, que non farian d’estranhessa, que jovava de ren d’asperar aquí lu russo, la mòrt ò la captivitat…Degne, l’autre respondet :
– « Siéu estat presonier dei englés en lo dètz-e-set, lo serai aüra dei russos. » ; e pas mai !
Estoïcisme, fatalisme, sentiment de la corpabilitat collectiua d’una Nacion fàcia ai sieu crime – ò fàcia au sieu revèrs – cerca dau castic, de l’expiacion, ò saviessa de l’òme ja madur, las de la vanitat dei boleadas umani ? Vai ti saupre ! Tant tot un, Joan se’n valet de convíncher un dei doi sordats, lo mai jove, que la s’esbinhet denant que siguesse tròup tardi.
De fach, lo vint-a-cinc d’abriu, si veguèron arribar una dozena de carres T.34 russo – carres liberators esto còup – embe una automitralhusa de command e la tropa darrier. Sus lo còup, lu sovieticas faguèron presoniers lu doi pàntols de la glòria perduda. Era escrich ; e aquí s’acaba tot cen que sabèm dau sieu brut karmà.
Dau súbito, lu rùssos donèron òrdre ai presoniers francés, qu’embarassavan aquí en mitan, de levar banc. Levar banc, va ben, mas per anar dont ? L’òbra de Joan non s’èra acabada embe la « liberacion » dau sieu camp e avia d’a s’entrigar dau destin dei sieu cambaradas. Calia anar discutre embe lo capitani russo que comandava la bateria. Dom Levesque, que devia aver un gust cinematogràfico per li eroinas oprimadi, si pilhet ensems emb eu una d’aqueli pichonas dau STO ukranian per li faire d’a interpreta. S’èra estada embe lu francés estent qu’èra la calinhera d’un dei sòcis dau camp, « tot ben coma si deu ». Tra elu charravan alemand ; la lenga dau bòia s’atrovava qu’èra aquela que segilava l’unitat, la comunion dei víctimas, e negociava la sieu liberacion. Emb aquò, lo capitani sovietica – sensible au frecum de la sieu compatriota e, lo cau ben dire, a l’autoritat de la religion – li permetet d’estar en li sostas, per asperar la fin dei combats. A’n aqueu moment, si tuavan lu cavaus per aver quauquaren d’a manjar.
Lo doi de mai s’emparet la capitulacion de Berlin. Lo vuèch, lu presoniers reçaupèron l’òdre de partir, dau bòn. Joan trovet una bicicleta per anar ai burèus de la municipalitat demandar de bòn de pan, e n’auguet, sensa problema. Si paguet finda un pichin plesir ; eu, lo Kriegsgefangener, passet davant de la coa de toi lu Berlinencs… La vendeta de Tonton Jean lu laisset necs ! L’endeman, lu presoniers liberats crompèron de pan, raubèron un carreton e la chorma de Zehlendorf se’n partet au sieu torn, embe doi ò très centenaus d’autres presoniers, devers ponent.
Après très jorns de caminada, lu simpàticos Rùssos que lu escortavan lu laissèron per quauqu jorns en un camp qu’arrecampava lo monde en partença per cen que si sonava pas encara Le Monde libre. Foguèron pi menats en camion fins a Wittenberg, la ciutat de Martin Luther, dont estaguèron vuèch jorns. Dimènegue lo dètz de junh, après d’una darrièra jornada de caminada, lu Russos lu liurèron ai Americans, sus d’un pònt, un d’aquelu quists que sobravan practicables per passar lo flume Mülde. Estaguèron aquí quauqu jorns de mai, norrit mièg-mièg, que lu liberators sabian pus don far testa embe lo reflús de toi aquelu « occidentaus » que lu sovieticas se’n desbarassavan lo mai vito que podian…
Lo dètz-e-vuèch de junh dau quaranta-cinc, cinc ans jorn per jorn après d’aver aujat revirar li sieu mitralhusas còntra lu carres de Rommel e d’aver mancat l’apèl de Barba Càrlo, Dom Levesque prenguet lo tren per París.
Gaug que, en aqueu sens, lu trens dau bestiari si tenian li pòrtas duberti ! A Nancy, passèron quaranta-vuèch oras a far de papeirons e, arribats en Paris, siguet mai lo parier. Après d’una darriera nuèch en caserna, lu larguèron emb un sac sus l’esquina, e fai tirà Mariús ! Fortuna, Joan avia de familha en París. D’a sa sòrre Teresa, trovet Jaume, son fraire lo mendre, que li volia tant de ben, e que l’avia laissat à Saint Lô, lo jorn de la mobilizacion, lo jo que la requisicion li avia fach petar la Monet-Goyon. Ensems posquèron blocar la bloca d’aquelu cinc ans de guerra.
Jaume èra aquí en permission. Eu, lo fuèlh de mobilizacion l’avia mandat en Argeria. Après dau revèrs, lo sieu batalhon de chassurs alpins avia refudat d’estar en l’armada marechalista de Darlan… Bessai qu’alhà lo s’èran escotat l’apèl de Barba Càrlo ? Emb aquò, si pilhèron lo maquís, coma si di e, au desbarcament aliat en Barbaria, jonhèron l’armada de De Lattre. Jaume faguet ensin toti li campanhas d’Àfrica, d’Itàlia, de França, fins au Rin. Lu eveniments avian fach d’eu un sordat ; aüra èra sota-tenent.
Lu doi fraires avian seguit doï vias. Un avia achetat la fatalitat dau revèrs, avia pausat la sieu Hotchkiss en la sala dei festas e seguit sensa discutre lo flume dei presoniers. Lo sieu combat èra estat un combat d’umanitat, de fraternitat, de comunion, un combat còntra de l’òdi. L’autre avia refudat la fatalitat dau revèrs, s’èra gardat li sieu arma, avia luchat fisicament e – mai que segur a l’encòntra de la sieu consciéncia – avia tuat. ‘Tai doi, cadun a la sieu mòda, avian seguit li vias de la degnitat e de l’òunor.
Mas coma se’n podian pi revenir, ‘tai doi, vius e entiers, après d’aver traborsat tota la guèrra dau quaranta, coma d’un temps Gionò, coma Barba Veran, coma Barba Angelin e lo sieu enfant ? Coma Tonton Jean avia poscut acceptar cinc ans de deportacion, de galèra, sudurar lu bombardaments màgers dau sècolo vint, sensa manco un judici sus d’aqueu pòble responsable de tant de dam ? Coma avia poscut sudurar tot aquò sensa revouta, sensa dubi ò blastèma, sensa refudar lo destin, la fatalitat de la mòrt, lo chaple, lo terror perpetuau ? Coma avia poscut emparar l’alemand embe lo metòdo Assimil, faire la conversa au còntramestre e obrar embe consciéncia ? Bessai que Tonton Jean es una raça de monge bodista zen ; ò simplament crestian vèro ?… segurament un èstre Uman.
Mas, perqué si faire tant de demanda, que tant – o sabèm pron – de respòsta n’i a ren. La soleta segurtat aicí bas, es aquela d’aquelu que son pas revenguts elu, coma lo tenent-coronèl Lair. La soleta segurtat es aquela que bramava Super-Truchi de Ribassièra, lu seras de choca : « Tot un di, d’aquesta vita, se’n sortirem pas vius ! ».
O sabia pron, Herr Kolibaba, que fins a la sieu mòrt pura, pron d’annadas mai tardi, mandet cada an à Tonton Jean, una cartolina de vot per l’an nòu.
Miqueu de Carabatta, Nissa, decembre dau 2005
Ajustament gràfic de Steu Lombard
Nòtas Barba Joan
1 Per cen que si tracta de Dieuze e dau Xvème còrs, si consorterà particulierament Lou Sourgentin, n° 140 ; Nice Historique 1988, p. 135 ; Histoire d’Occitanie, Armengaud e Lafont
2 Galibardi a bicicleta / coma lo di la cançon / Bofant dintre la trompeta / S’estirassa lo canon »
E viva Galibardi ; in D’una Làupia ; Janluc Sauvaigo ; Lu Segurans, Niça, 1984, C.D. Anita Anita, Silex, 1986
3 De tant en tant m’escapa una paraula dau patois de Ribassièra ; vos demandi excusa. Es pura, soventi fetz, perqué aquesta paraula mi fa defècte en niçard e que s’es conservada en montanha – que si saup que l’ària l’i es mai sanica. De fach, l’i s’atròvan encara manti formas de l’ancian provençau, d’aqueu dei trobadors.
En lo Petit Dictionnaire, Emil Levy marca « bioc » : « s.m. Dépareillé, Quercy ; étym.anc. occ. » A Ribassièra, «bioc » es un adjectiu que denòta la nocion de mancança.
4 Si saup que la paraula pneu es imprononciabla per un occitan de la còsta plena e qu’es estada espontaneament adaptada foneticament en « peu-neu ».
5 Max Roqueta ; La casa di Dante, in Lo Corpatàs Roge ; Trabucaire
« Sus de l’ària de Ma tonkinoise : « L’i a de gens que fan la coa / Si fan ‘squissar, si fan ‘squissar coma d’amploas / L’i a de gens dins lo quartier / Que son pròpi de fumiers. » Si cantava a Niça n’aqueli annadas de carestia.
Seria bessai nechessari de jontar agregar & cobear : plantar e culhir.
BARBA JOUAN
« Oblidarem los camaradas. Nos sovendrem pas mai de la sabor canina del pan negre de l’amistat, del pan que s’atalhona coma lo còs de Dieu.»
Joan Bodon ; La Grava sul camin
Il est des questions que nous nous posons, comme ça, sans jamais avoir de réponse ; sans même en chercher car, de toute façon – mais le savons-nous vraiment – il n’y a pas de réponse : comment diable est-il possible que Jean Giono ait pu traverser toute la guerre de quatorze et soit revenu vivant – et entier – écrire « Le Grand troupeau » ? Comment mon grand-oncle Véran a-t-il pu souffler dans la trompette du XVème corps, de Dieuze à Verdun et survivre ensuite à la grande boucherie au soleil de l’offensive Nivelle ? comment a-t-il bien pu continuer à courir derrière les premiers chars d’assaut, à enjamber le Rhin – toujours soufflant, comme Garibaldi dans la chanson ? Qui l’a laissé retourner au Cap d’Ail, carder la laine et livrer les matelas, tirant son charreton jaune, jusqu’à ce qu’il finisse de vomir des morceaux de ses poumons, pourris par l’ypérite? Pourquoi Barb’Angelin est-il revenu du Rif, alors que son père était resté poussière dans la Marne ; et pourquoi son fils ne resta-t-il pas dans les sables de Bizerte ?
Barba Jouan lui aussi est revenu de loin. Et lui, il sait pourquoi ; sans doute parce qu’il ne se pose plus la question. En tant que prêtre, il y a longtemps qu’il a compris que les voies du Seigneur sont impénétrables. D’ailleurs, ce serait manquer de respect que de continuer à l’appeler Barba Jouan. Ça, c’est bon pour les rissoles du dimanche, pas pour un brave curé qui, de toute façon, ne comprendrait pas la plaisanterie, étant donné qu’il est français de langue d’oïl ! Dans la famille, on l’appelle Tonton Jean.
Né en mil neuf cent-douze, comme ma grand-mère Elvire, il est le second garçon, le sixième des huit enfants Levesque, de Cherbourg. Le père était un architecte renommé de cette ville, qui échappa au grand massacre à cause de son âge déjà mûr et de la charge de famille. Toute sa descendance cultivait les arts et la beauté : qui peignait, qui jouait du violon ou du piano ; tout le monde prenait la pose devant la chambre photographique de Papa qui s’était entiché de l’extraordinaire modernité technique de son temps. J’ai pu voir les positifs sépia et les plaques de verre qui témoignent de ce bonheur passé.
Quand, à vingt ans, mourut Pierre, son frère aîné, Jean choisit d’entrer au séminaire. Après ses études, il fut ordonné prêtre et nommé vicaire puis curé en quelque endroit de sa Normandie natale ; il y resta toute sa vie, en Normandie. Seule la seconde guerre mondiale put le perturber.
* * *
Avec Jacques, son frère cadet, pour lequel Jean avait tant d’affection, il avait l’habitude de randonner à moto. Ils faisaient le tour de la Bretagne lorsqu’ils virent les premières affiches de mobilisation à Saint Pol de Léon : la république appelait déjà, en cette fin de l’été trente-neuf, les détachements précurseurs, avant la mobilisation générale. Les deux frères retournèrent à Saint Lô, où Jean était vicaire – et où la réquisition devait lui sucrer sa Monet-Goyon. Il fut de suite incorporé au 6 / 208, bataillon indépendant formant corps, avec le grade de sergent, dans une section d’engins, en l’occurrence des mortiers Brandt de 81 et des canons antichars de 37.
En effet, en trente-deux trente-trois, quand il avait fait son service, il avait suivi le peloton d’élèves gradés. Au Havre, puis à Cherbourg, il avait appris à manier les armes, à lire les tables de tir et à calculer les trajectoires balistiques. Comme il n’était pas bête, et bien instruit, il était sorti sergent.
Toujours est-il qu’en trente-neuf donc, lorsqu’il fut mobilisé, son commandant de bataillon se trouva à court de trois chefs de sections, adjudants ou lieutenants. Dans la section de Jean, le registre indiquait : « Chef de section : lieutenant N… »… Ils les attendent encore maintenant, le lieutenant « N, points de suspension » et ses collègues ! C’est ainsi qu’à leur place, le commandant casa des sous-officiers adjoints. Jean – le sergent-chef Levesque – prit le commandement d’une section, le travail du maître berger et la solde du pastoureau.
Vous qui connaissez la musique de 1940, vous aurez deviné que l’équipement du bataillon s’était perdu, avec les chefs de section, et que des canons de 37, des mortiers de 81, personne n’en vit jamais aucun. Tout juste si, à la place des Brandt de 81, qu’il appréciait beaucoup, Jean toucha le rebut des stocks, des machins archaïques de 1917, qu’il fallait pointer avec un niveau à bulle et un fil à plomb !
En tant que chef de section, le sergent-chef Jean Levesque reçut cependant, pour faire sa guerre, un revolver espagnol – approvisionné de six cartouches – récupéré sur quelque réfugié hagard, sans doute du côté de Rivesaltes. Cette sarbacane dérisoire augurait déjà du sort de la république – je veux parler de la nôtre.
De l’automne trente-neuf au printemps quarante, ils attendirent – comme tout le monde – entre désœuvrement de caserne à Cherbourg et vaines manœuvres au Vast, en val de Saire. Au mois de mai, ils furent envoyés sur la ligne de défense avancée de Cherbourg, à l’Est des marais du Cotentin. Le long de la Douve, le 6 / 208 tenait les quatre ponts : Pont Douve, Beuzeville-la-Bastille, Pont l’Abbé, La Sensurière. Jean gardait un secteur proche du poste de commandement du bataillon, à la sortie Nord de Sainte-Mère-Eglise, sur la route de Cherbourg. Outre les mortiers de 1917 qui ne servaient plus à grand-chose pour ce travail, on lui donna quatre mitrailleuses Hotchkiss. C’étaient des pièces hippomobiles dont la voiturette transportait l’arme, l’affût et les munitions. Il en plaça deux pour défendre la route de Cherbourg et deux pour attendre ce qui pouvait s’amener de Chef-du-Pont. Jean, qui se trouvait ainsi chargé de tenir deux routes, avait posté armes et servants dans les fossés, abrités le long des talus de chacune des chaussées.
Tonton Jean nous racontait sa guerre l’autre été. Nous avions franchi le Var et traversé la France en diagonale et en famille pour aller lui rendre visite à Quinéville. Curé de ce village maintenant retraité, il vit depuis des années sur cette colline ventée, dans son presbytère pelotonné contre un vieux clocher roman. Depuis mille ans, dans ce petit bastion de Dieu, qui fait face à l’océan et aux plages du Cotentin, l’église et le cimetière sont appuyés contre le vent. Le logis du curé y est ceint des granges, étables, celliers, clos qui assuraient le quotidien des curé d’autrefois. Il y a peu, Tonton Jean plantait encore le potager et cueillait les fruits du verger. De cette vie rustique, il a conservé l’habitude de boire, chaque année, un tonneau de cidre de deux cents litres que lui fournit un paysan de ses amis.
C’est donc devant une de ces bouteilles tirées de la futaille que nous parlons, un soir, dans la fraîcheur de la cuisine. Nous avons terminé le repas, porte ouverte sur la belle herbe verte du pré, pendant que la France se dessèche dans la canicule. Tonton Jean est de ces hommes pour qui la joie de faire sauter le liège en compagnie est plus grande que celle de bouchonner les bouteilles tout seul. Il est allé dans le cellier prendre un autre flacon de cette boisson fruitée, parfumée, vive de ces bulles légères et cependant encore âpre et trouble, comme le fruit foulé. Il nous raconte ses aventures de sa voix tranquille, le dos appuyé au dossier de la chaise, les mains posées sur la table, la tête légèrement penchée en arrière, pour mieux fouiller dans sa mémoire.
Je me demande ce qui a bien pu agiter l’esprit d’un prêtre chrétien, catholique, chef de section dans l’armée de la république française, en charge de quatre mitrailleuses et de leurs servants, à l’approche de l’ennemi. A qui fallait-il obéir ? Comment s’était-il débrouillé entre les commandements de Notre Seigneur et ceux de son capitaine ? Il s’agissait bien là de tuer des créatures de Dieu, de se faire tuer, de résister – ou pas – à l’attaque d’une armée étrangère, et de prendre dans ces événements la responsabilité de la vie et de la mort des hommes. Soyons bien d’accord, nous ne parlons pas ici de courage ou de lâcheté, de cette rhétorique ampoulée des nationalismes, mais de la conscience d’un être paisible et bienveillant, aimant son prochain et qui doit faire face à son destin.
Je renvoie pourtant la question à plus tard… car à ce moment-là – le dix-huit juin quarante – les allemands attaquent au Pont Douve et à la Sensurière. Ainsi, les chars passent de l’autre côté des marais et du sergent-chef Levesque, à l’Ouest du Cotentin, là où personne ne s’y attend.
Pour nous faire comprendre la manœuvre, Tonton Jean dessine une carte de la bataille sur la table, à l’aide de verres, de couverts, de bouteilles et de soucoupes. Pour nous qui ne connaissons pas bien le Cotentin, il est un peu difficile de nous y retrouver sans explication…
Le dix-huit juin quarante, donc, à Saint-Sauveur-de-Pierrepont, deux officiers de la Panzer Division vinrent avec un drapeau blanc pour essayer de traiter sans trop de dégâts. L’ingénieur de marine qui commandait les deux canons du secteur fit tourner la manivelle de son téléphone. A Cherbourg, l’amiral dit qu’il fallait résister. « Dans dix minutes, j’ouvrirai le feu ! » répondit le marin aux deux pacifistes de la Wehrmacht. Les chars tuèrent l’ingénieur de marine et tous ses hommes qui avaient tenté, en vain, de leur interdire la route de Cherbourg.
La pointe du Cotentin était donc déjà envahie et désormais, Tonton Jean avait les Prussiens dans le dos ! Sans plus tergiverser, à son commandement, ses mitrailleuses tournèrent à cent quatre-vingt degrés et attendirent que l’ennemi s’en retourne de ce port dont elles étaient censées interdire l’accès… Dans ses jumelles, Jean observa cette campagne d’où ledit ennemi n’aurait jamais dû venir faire de lui – peut-être – un héros.
Il n’eut pas longtemps à attendre. Au matin du dix-neuf, vers dix heures, débouchèrent deux camions à la croix noire. Ils s’approchaient lentement des charrettes et tombereaux placés en travers de la route, selon la grande tradition de la barricade à la française, à laquelle Jean avait souscrit spontanément, quand il dut se dépêtrer à l’improviste de cette affaire insensée… chacun à son poste sentait s’écouler les dernières minutes qui le séparaient encore du fracas et du feu de la guerre.
C’est à ce moment que, d’un chemin de traverse, surgit la voiture d’un paysan du coin pressé de s’enlever du milieu, vu que les événements tournaient au vinaigre. Il fut arrêté par la barricade. Le type serra rageusement le frein à main, avec dérapage et crissement de pneus. Il jaillit en colère de sa guimbarde, gesticulant, vociférant qu’on le laisse passer. Jean, qui surveillait les allemands dans ses jumelles, les vit s’arrêter.
– Planquez-vous ! cria-t-il au paysan ; et il ordonna le tir. Sans plus se faire prier, l’autre mariole plongea dans le fossé. Cependant, sa voiture, arrêtée au milieu de la route, empêchait le tir d’une des deux mitrailleuses. De l’autre côté, les Feldgrau giclèrent des camions et répliquèrent dans la confusion par des lancés de grenades et un tir de fusil-mitrailleur. Ils tournèrent casaque et, sans plus insister, retournèrent vers Montebourg. Heureusement que les allemands n’avaient pas cherché querelle : la seule mitrailleuse qui avait le champ libre s’était enrayée !
A la barricade, on ouvrit le rideau de charrettes et le paysan s’en alla ailleurs jouer son destin. Il fallait toutefois aller inspecter le terrain et vérifier qu’il n’y restait pas de mort ou de blessé. Jean prit avec lui Dogon, un type de Carentan, en couverture. Il sortit le revolver espagnol de l’étui et, l’arme au poing, alla vérifier le résultat de son tir. Il n’y avait rien ni personne… Il put ainsi conserver les six cartouches pour finir la guerre.
De nouveau, je me pose la question de savoir ce que Jean aurait fait, s’ils s’étaient trouvés menacés, lui ou le brave Dogon… Mais c’est là qu’arrive l’armurier du bataillon qu’on avait fait quérir pour réparer la mitrailleuse enrayée ; Tonton Jean continue son récit, tranquille comme l’huile dans la jarre. Il sait, lui, ce qu’il aurait fait.
Vers une heure, une heure et demie, il était au poste de commandement, à deux cent mètres de sa position. Il faisait son rapport au commandant, lorsqu’il entendit claquer la rafale d’une de ses mitrailleuses. Il s’en retourna du P.C., à toute allure, sur la bicyclette de liaison.
Ses hommes avaient vu arriver une voiture allemande, toute seule, qui s’était arrêtée devant la barricade et avait entamé un demi-tour. Privés de leur sergent-chef, les servants, qui avaient le véhicule en ligne de mire, ne savaient trop que faire : « Putain de merde, qu’est-ce que je fais, je tire ou je tire pas ? avait demandé le tireur à son chargeur – Va te faire voir, qu’est-ce que tu me demandes à moi ? t’as voulu être caporal, débrouille-toi maintenant, tu sais ce que tu dois faire »…
Et donc, cette fois, la voiture y resta, devant la barricade ; elle n’acheva pas son demi-tour. Aucun diable n’était sorti de sa boîte, la mitrailleuse ne s’était pas enrayée, la visée était juste, le tir avait porté. Toujours avec Dogon en couverture, un sergent comptable du P.C. en recherche de frisson et son fameux revolver espagnol, Jean alla de nouveau se rendre compte. Dans la caisse, aux vitres brisées et aux tôles percées d’impacts de balles, il y avait deux types : « Camarade français, ne me fais aucun mal ; je n’ai fait de mal à personne ! lui dit, les yeux effarés, un officier à la poitrine sanglante – Non ! on va vous soigner ! lui répondit Jean ». J’ai de suite compris, au ton de sa voix, à son visage, que Tonton Jean avait vécu, depuis, avec ce regard et ces phrases gravées dans son esprit.
Cet allemand qui parlait un français littéraire en crachant le sang était un officier payeur de vingt ou vingt-cinq ans. Quelques minutes plus tôt à peine, il sortait du restaurant à Montebourg, où il avait déjeuné comme un bon bourgeois : « Je cherchais mes troupes pour les payer et je me suis trompé de chemin »… A côté de lui, son chauffeur avait le bras fracassé. Jean appela l’ambulance et les fit emmener tous deux à l’hôpital de Valognes. Je ne sais ni quand ni comment, mais Jean apprit que le jeune Zahlmeister si bien éduqué y mourut le lendemain.
Pourquoi ces deux-là, qui faisaient les touristes en arrière du front, qui ne faisaient de mal à personne, qui fuyaient devant quelques charrettes en travers de la route, s’étaient fait ramasser là, pour rien, sans gloire, comme deux idiots ? Pourquoi ces deux planqués devaient-ils rester là à se souiller de leur sang, effondrés sur la banquette d’une conduite intérieure repeinte pour la guerre, alors que deux camions de troupes d’assaut, le matin même, n’avaient même pas pris un plomb ? Avant de partir, au printemps, le zahlmeister avait certainement rassuré sa mère ; que risquait un comptable, un administratif, un tigre de papier, un rond de cuir… Pourquoi aucun patriote français n’avait-il bouché le champ de tir ? Pourquoi la mitrailleuse n’était-elle pas restée enrayée ? Pourquoi le caporal avait-il ouvert le feu sans ordre ? Et cet ordre, Jean, s’il avait été là, l’aurait-il donné ?…
Mais très vite, Jean dut cesser de se poser des questions qui ne servaient plus à rien. Il était environ trois heures et ses jumelles confirmaient ce qu’il lui semblait avoir vu. Là-bas, au loin, sur la grand-route, apparaissaient les chars ennemis. Ceux que le pauvre petit cherchait tout à l’heure pour leur payer leurs quatre sous, ceux qui avaient donné le ton à Saint-Sauveur-de-Pierrepont, ceux qui allaient toujours trop vite pour prendre le temps de faire la guerre comme l’amiral l’avait apprise : les Panzer de Rommel s’en retournaient déjà de Cherbourg et descendaient vers la Bretagne. Pour aller plus vite, ils filaient sur la nationale, de ville en ville, Valognes, Montebourg, Carentan et ils continuaient, jusqu’à Brest. L’innocent et paisible Zahlmeister courait derrière le Blitz – et il le payait.
Jean rendit compte au capitaine…Que voulez-vous qu’ils aient fait avec leurs deux pétoires contre la vingtaine de chars qui arrivaient, sinon se faire déchiqueter comme les malheureux de Saint-Sauveur-de-Pierrepont avec leurs deux canons ? Quel héroïsme y aurait-il eu à finir, dans la minute, éparpillés en morceaux rougeâtres dans la verdure du printemps normand ? « On peut rien faire », dit le capitaine. Ils laissèrent tout en plan et s’en allèrent à une trentaine de mètres de la route, dans ce chemin de campagne d’où avait surgi la voiture du paysan, quelques heures plus tôt.
Les Panzer leur passèrent devant comme si de rien n’était. Avec une adresse délicate, ils s’étaient ouvert la route et avaient poussé les charrettes du milieu, sans les abîmer. Piétaille et tankistes se regardèrent sans broncher. Les officiers de chars étaient debout, torse nu dépassant de leur tourelle, beaux, blonds, vainqueurs, tout comme sur les images de la propagande allemande. Là-bas, devant son P.C., le commandant était sur le trottoir, muet, penaud, amorphe comme les autres. Les Panzer lui passèrent devant comme si de rien n’était ; ils ne s’arrêtèrent même pas pour capturer cet officier supérieur. C’était le travail de l’infanterie qui suivait, une demi-heure derrière ; Rommel avait sa guerre à faire, vite.
Ah ! non d’un chien! lui eussent-ils donné ses 37 antichars au lieu des pétoires enrayées ou des vieilles bombardes de 1917 ! Sans aucun doute, l’abbé Levesque aurait fait retentir le tonnerre de Dieu ! Sainte-Mère-Eglise aurait arrêté Rommel comme Poitiers les arabes ; le « renard du désert » serait resté un anonyme « blaireau du Merderet » et le mur de l’Atlantique, l’enceinte de pierre sèche d’un enclos du bocage normand. Peut-être que jamais aucun parachutiste ne serait venu se pendre au clocher et que sa renommée, l’église de Sainte-Mère la devrait à un enfant du pays !
Pour faire bonne mesure, il est certain que Tonton Jean, Dogon et compagnie y seraient tous morts en héros, « Pour la France ». Ils seraient inscrits sur le monument, avec ceux de quatorze, « la der des der », avec ceux de toutes celles qui s’ensuivirent, en attendant ceux de celles à venir. On chanterait la geste du prêtre guerrier, le bienheureux Jean de Cherbourg, enfant – si l’on peut dire – de la Pucelle d’Orléans et de Charles Martel… Bien sûr, on ne boirait pas le cidre avec lui, devant une porte ouverte sur les prés mais, Tonton Jean serait un patrimoine familial, une attestation de gloire héréditaire.
Bref, au lieu de recevoir la croix de guerre avec palmes à titre posthume, ou de sombrer dans l’oubli des gouffres de l’histoire – avec les cent mille morts de quarante, dont tout le monde se fiche, comme on sait – au lieu de cela donc, ils reçurent de l’amiral l’ordre de rendre les armes. Ils traînèrent donc mitrailleuses, fusils, mousquetons, revolvers de toutes sortes, dans la « Salle des Fêtes » de Sainte-Mère, sans qu’on sache jamais qui, des allemands ou des français, avait eu l’idée de cette ironie cruelle. Le commandant, qui était un homme honnête et droit, n’oublia pas de restituer la mallette de Reichmark de l’officier payeur à ses légitimes destinataires, les pauvres, qui ne pouvaient même plus se payer un verre… On peut penser qu’il présenta même condoléances et excuses pour le regrettable malentendu du jeune Zahlmeister !
***
Par la porte de la cuisine ouverte sur le pré, on voit maintenant une belle nuit étoilée, profonde, paisible. Avant de s’échapper, les enfants ont débarrassé la « carte » de la bataille et, « Saint-Sauveur, Beuzeville, La Sensurière » trempent dans l’évier avec les assiettes et les couverts. Nous restons entre aînés, Tonton, ma femme et moi. Nous finissons en silence notre verre de cidre. Tonton est toujours bien calé dans sa chaise, ses mains essuient doucement le noyer de la table. Il nous a conté les faits, donné une chronologie précise, mais il ne dit rien de l’état d’esprit de ses camarades, de ses pensées. Derrière ses lunettes, ses yeux bleus, transparents, me regardent ; mais ils voient, bien au delà de moi, bien avant ma naissance, le visage de ses compagnons qui flotte toujours sur les brumes de sa mémoire.
D’un coup, sa bouche entrouverte me rappelle une expression de sa sœur Thérèse et, pour la première fois, je réalise qu’ils se ressemblent, qu’ils ont grandi ensemble, qu’ils ont été élevés dans la belle maison de Monsieur Levesque, à Cherbourg, du temps des photos sépia. Je n’ose plus faire parler Tonton Jean, je n’ose plus lui poser de question. Nous parlons encore un peu de l’instant présent, de la fraîcheur bien agréable, nous nous apprêtons à nous dire bonne nuit. Carpe diem…
Je peux cependant les imaginer, les défenseurs de Sainte-Mère, en ce soir du dix-huit juin quarante, la « fête » achevée, nauséeux comme s’ils avaient trop bu. Tous prisonniers, ils marchaient désarmés, le long de la route, capote ouverte, ceinturon décroché, les épaules lourdes de ces bras qui ne servaient plus à rien et pendaient, comme des battants de sonnailles muets de tant de honte. Les poitrines se creusaient, écrasées par le poids des balles qu’elles n’avaient même pas pu essayer d’arrêter ; les dos s’inclinaient à la pensée du regard incrédule, voilé de larmes et d’angoisse, que des familles et des amis lointains devaient porter sur d’autres vaincus, entraînés comme eux dans la catastrophe. Dans un autre monde, dans une autre vie, dans un temps de confiance et de certitudes, ils avaient marché au pas ; maintenant, leurs grolles allaient en désordre, sans rythme, pataugeant dans l’écroulement de la Nation, sans savoir quand, ni où ils toucheraient le fond de la dégringolade des Démocraties.
Entre l’invraisemblable retournement du front, la veille, et la folie surréaliste de cette journée, personne, bien sûr, n’avait entendu parler de l’appel du « Grand Charles ». Quand bien même auraient-ils entendu quelque chose, ils n’y auraient rien compris, noyés dans leur désespoir, aveugles au monde, cramponnés à la seule certitude d’être au moins vivants, avec tous leurs copains d’avant le déluge ; ensemble, comme des enfants perdus dans les bois.
Une bonne partie de la nuit – je veux dire ma nuit, celle qui a suivi le récit de Tonton – le souci de laisser s’évanouir cette mémoire va me tracasser… Une fois de plus, je me trouve à vouloir recueillir de l’eau dans un panier. La vie et le savoir des êtres sont-ils donc destinés à glisser comme les ruisseaux et les fleuves dans une mer d’oubli ? Une fois de plus, il me semble avoir touché du doigt la bêtise absolue de la guerre, cette absurdité totale, que je n’avais pas vécue mais comprise, à la lecture du début du Voyage au bout de la nuit ou de La Chartreuse de Parme, dans La Guerre et la Paix ou dans Le Grand Troupeau. Je dois noter, faire connaître l’incroyable aventure de l’abbé Levesque et de ses camarades ; de nouveau, je dois faire le passeur. Mais, dans la cuisine à la porte ouverte sur les prés, au moment où nous allions nous dire bonne nuit, une vague de souvenirs est revenue s’épanouir sur les lèvres de Tonton Jean.
Bien que les jours fussent longs au mois de Saint Jean, les pauvres vaincus ne firent rien de plus en ce soir d’avanie. Le lendemain matin, vingt juin, les allemands les acheminèrent à pied vers Saint Lô et les escortèrent, « baïonnette au canon ». Toutefois, ils ne firent que peu de chemin ; tous les ponts de Douve avaient sauté. Les Prussiens les arrêtèrent à Beuzeville-la-Bastille, le temps pour les vainqueurs de réaliser l’étendue de leur victoire et d’organiser, à leur façon bien ordonnée et germaine, cette débandade latine.
Ils dormirent dehors, dans un pré bien enclos qui côtoyait la départementale. Tonton Jean se souvient encore – on peut dire avec une sorte d’émotion, de gratitude – du Feldwebel qui les nourrit en ce crépuscule désastreux. Tous ne fermèrent pas les paupières, tourmentés par des pensées qui leur vrillaient la conscience. Certains, au contraire, effondrés, corps et âme épuisés par cette aventure, plongèrent dans le sommeil comme des bébés, bouche ouverte, sans plus le moindre mouvement, comme les morts du champ de bataille.
Le lendemain, Dogon traversa son Carentan une dernière fois avant longtemps. Il n’eut même pas l’idée de se défiler, d’entrer dans un magasin, de se cacher dans un escalier, un recoin, un porche… et de prendre les jambes à son cou, libre ! Pas même ! ni lui, ni personne… Il fallait boire le calice de la faute et endurer le châtiment ; et puis, le sergent-chef-abbé Levesque était garant sur sa personne de l’intégrité du groupe ; alors… Le soir, après une journée de marche dans la moiteur de cet été de disgrâce, ils arrivèrent à Saint Lô, caserne Bellevue. Pour qui connaît la vie de caserne, y ajouter encore celle de prisonnier constitue sans doute le comble de la mélasse. Heureusement pour lui, Jean y échappa.
En effet, quand le curé de Saint Lô apprit que son vicaire était revenu de la guerre, il fit le siège de la Kommandantur pour le récupérer. Un officier, sans doute quelque luthérien – soucieux de l’édification de ces peuples désormais soumis à l’autorité du troisième Reich – consentit à laisser l’abbé Levesque sortir le matin pour aller accomplir sa journée. Il fallait continuer à apprendre le catéchisme aux enfants et reprendre le cours de toutes ces choses qui font une vie de vicaire. Le soir, il retournait dormir à la caserne. De ce privilège, de cette liberté d’aller et venir, naquit en lui, étrangement, bien plus que l’acceptation, la volonté et le sentiment du devoir pour lui de rester prisonnier. Ainsi, son comportement pour les années noires qui suivirent, serait inspiré par la nécessité du service matériel et spirituel de ses camarades d’infortune. Il partagerait leur souffrance. Il apporterait le réconfort ; sans se préoccuper de tirer quelque bénéfice personnel de sa position, sans essayer d’améliorer tant soit peu son destin individuel. Il partagerait le destin du groupe, sans tenter de fuir la compagnie de ceux avec qui il rompait ce pain noir de la guerre, pain noir de l’amitié, Pain de l’eucharistie. Il serait, pour ainsi dire, le Bertomieu de Joan Bodon et, non pas le rêve d’un homme seul, mais un Bertomieu en chair et en os, un chrétien parmi ses semblables.
Dès que les hommes apprirent que le sergent-chef pouvait aller et venir à l’extérieur, ils lui confièrent des commissions, ils lui demandèrent de passer du courrier au travers de la censure. Les familles s’organisèrent pour faire parvenir un peu d’argent, quelques provisions, histoire d’améliorer l’ordinaire des prisonniers. Le vicaire était dans l’emploi qu’il s’était choisi, dans son rôle séculier ; son travail pastoral accompli, il s’occupait de ces petites choses qui aident les enfermés à supporter l’absurdité du désœuvrement et à continuer à maîtriser quelque chose dans leur vie de marionnettes.
Bien sûr, il se trouva vite un imbécile pour faire trébucher cet arrangement convenable des conventions internationales. Fin octobre, les allemands menèrent une fouille générale. Comme chacun sait, qui cherche trouve… Ils lurent avec beaucoup d’intérêt le courrier qu’un type du pays était sur le point de faire partir. Il disait à sa famille : « Continuez de m’envoyer des nouvelles et de l’argent par l’intermédiaire du sergent-chef Levesque… » Crétin ! D’une certaine façon, heureusement que cela fit grand bruit dans la caserne et jusqu’à la Kommandantur… Ainsi, un jeune marin de Cherbourg, que les allemands employaient comme interprète, put prévenir Jean de ne rien rapporter à la caserne ce soir-là.
De retour Quartier Bellevue, mains dans les poches et plume au vent, Jean qui faisait semblant de rien, fut accueilli à la salle de garde. On l’amena à un officier qui, après son numéro d’esbroufe réglementaire, le lança dans le sillon de la procédure administrative. Envoyé à la Kommandantur, il comparut devant le premier Gerichtsoffizier de sa vie de kriegsgefangener. Il répondit à l’interrogatoire… Il faut dire qu’en quarante, les Prussiens n’étaient pas encore entraînés à cet exercice. Peut-être aussi que certains, naïfs, se la jouaient toujours « Eric von Stroheim dans La Grande Illusion ». Ils pensaient pouvoir encore conjuguer Nazisme et traditions de l’Allemagne éternelle, Wehrmacht et conventions de Genève, guerre et jugement dernier, conscience individuelle, patati et patata… Ainsi, l’abbé Levesque répondit avec un bel aplomb à son officier de justice et même, il put s’offrir le plaisir de se moquer de ses gardiens.
Il en rit encore maintenant, levant son verre de cidre, comme s’il portait un toast à ces balourds ! et il les imite…
– Nous konnaizons les noms de zeux ke fous zafez zaidé !
– Vous avez de la chance, moi, je ne les connais pas !
Ils cherchaient à en savoir plus, mais le prêtre n’était pas tombé de la dernière averse. Il continua à faire l’idiot et les Prussiens n’eurent ni preuve, ni aveux. Ils inscrivirent cependant sur sa carte de kriegsgefangener : « A aidé aux évasions en fournissant vivres et argent à ses camarades ». Bien entendu, ils lui supprimèrent sa permission de sortie et Jean dut s’habituer à la condition de prisonnier. Le curé de Saint Lô, quant à lui, se trouva confronté aux dures réalités de la guerre et par force, se débrouilla avec ses paroissiens, sans vicaire.
Toutefois, cette vie n’était pas faite pour durer longtemps. Le vingt et un novembre à midi, ils se retrouvèrent sur le quai de la gare. Ils furent chargés dans des wagons à bestiaux, selon ce qui était inscrit sur les portes : quarante hommes ou huit chevaux par voiture. Tout cela était calculé, m’expliquait Tonton Jean, de façon à ce que les quarante types puissent tenir tout juste allongés. Une fois de plus, on peut noter qu’en quarante, on respectait encore le règlement…c’est aussi à ce moment que les camarades de Sainte-Mère furent séparés. Selon un ordre alphabétique, Jean monta dans le wagon des « L » comme Levesque. Il dut abandonner Dogon et les autres, chacun à son initiale, dans ce funeste petit train abécédaire.
Ils étaient donc embarqués, avec de l’eau dans les bidons, un pain chacun, un peu de saucisson, sans même un ballot de paille répandu sur le sol, vers l’inconnu d’une destination de vaincus ; où ? quand ? combien de temps ? Le vingt-cinq, après avoir traversé la Belgique, la Hollande et l’Allemagne du Nord, ils étaient en Westphalie, quand enfin les portes s’ouvrirent. Cela faisait trois jours que ces beaux jeunes mâles, conçus dans la gloire du repos du guerrier et l’élan victorieux de mil neuf cent-dix-huit, fermentaient dans l’odeur de renfermé de cette humanité humiliée et emprisonnée dans sa propre soue. Les plus chanceux d’entre eux parvinrent à tenir leurs pantalons jusqu’au premier buisson. Ils eurent une demi-heure pour respirer, se dégourdir les jambes et, sortant de la nuit des wagons, s’éblouir à la lueur trouble du septentrion.
Le lendemain matin, vingt-six novembre, ils étaient sur le fleuve Oder, à Furstenberg. A pied, dans la nuit, ils rejoignirent un grand camp du Stalag drei B. Mal nourris, mal couverts, ils ressemblaient aux « grognards petits » de L’Enterrement de Verlaine, qui allaient, toussant, crachant, glissant sur le verglas. De fait, ce pitoyable convoi enterrait métaphoriquement l’espérance et les combats de deux générations sacrifiées.
***
Nous sommes tous réunis dans le salon de Tonton Jean, nous reparlons de cette conversation de la veille au soir dans la cuisine et finissons, en guise d’apéritif, la bouteille de Bordeaux qui reste du dernier repas. Je veux renouer le fil et j’entreprends de nouveau Tonton sur sa position – objectivement scabreuse – de prêtre-soldat. Il semble bien pourtant que je sois le seul tracassé par cette affaire… « J’ai rejoint l’armée comme tous les citoyens français » ; je ne saurai rien de plus de la conscience de l’abbé Levesque. Je réussis cependant une belle avancée : il est d’accord pour que nous reprenions tout ça ensemble, depuis le début, que je prenne note de ses paroles ; il semble même ému de l’intérêt que porte un homme jeune à sa vie, à sa modeste personne. Moi aussi, je suis ému par sa confiance, par l’idée qu’il m’appartient maintenant de transmettre son récit. Je le ferai à ma façon, sans trahir l’homme, sans non plus trahir la réalité, en imaginant toutefois une vérité nouvelle. Je me sens léger ; le vin ajoute un plaisir physique à la joie du travail qui m’attend. Je crois que nous partageons tous deux ce sentiment de communion entre des vies, des époques, des générations différentes. Je suis heureux d’éprouver cela de nouveau.
Nous jouons dans un décor d’un autre temps. Aux murs, le papier est rouge comme la robe du Cardinal de Richelieu. La tâche de la cheminée de marbre blanc rappelle le col de dentelle de Son Eminence. Dessus sont posés les portraits des ancêtres et, étranges objets chez Monsieur le curé, une paire de douilles de cuivre de la dernière guerre, luisantes et astiquées comme les bibelots de ma regrettée grand-mère… Je suis poursuivi par la problématique du sabre et du goupillon !
Vestiges de la maison de maître à Cherbourg, quelques meubles rococo sont à l’étroit dans ce petit presbytère. Dans un angle, une pendule rustique est muette depuis une vieille frayeur. A l’époque du débarquement, près d’Omaha ou d’Utah Beach, je ne sais plus, la bâtisse s’est effondrée autour du meuble. L’horloge est restée droite, au milieu des gravats ; elle avait échappé à la destruction, allez savoir comment ; mais il paraît qu’on voit souvent ce genre de chose en temps de guerre. Tonton me montre les marques que la pluie a eu le temps de laisser sur l’ébénisterie, en attendant qu’il puisse venir, parmi les ruines, récupérer cet unique souvenir de sa grand-tante. Il me fait voir aussi la réparation frustre que lui a faite le menuisier de Quinéville. Nous parlons, nous finissons notre verre, nous sommes d’accord : demain nous reprendrons tout cela à l’écrit, dans le bureau où Tonton Jean travaille tous les jours que Dieu fait.
Janvier quarante-et-un, Nach Berlin ! Mais cette fois, pas pour « aller couper les moustaches à Guillaume »… Moins vingt degrés ; et de nouveau les wagons à bestiaux pour une nuit et un jour de forçats, jusqu’à une gare de banlieue de l’Est de la ville. Et de nouveau à pied sur le verglas, à s’étaler comme des pantins, jusqu’au camp de Lichterfelde ; un camp, parmi la centaine de camps du Grand-Berlin. Tenaillés par le froid, sales, rompus, le mauvais jus de café qu’on leur donna en arrivant, à quatre heures du matin, leur sembla bien bon. C’est là, à Lichterfelde qu’ils furent décorés du « triangle noir ». Tel était le délicat privilège des Kriegsgefangener de la capitale qui échappaient ainsi au disgracieux « KG » peint dans le dos de tous les autres prisonniers de guerre du Reich.
Ach ! Berlin. Jean devait y rester encore longtemps, jusqu’à ce que les bottes des russes viennent retourner à coups de pieds la charogne grillée de l’oncle Adolphe. Pour le moment, ils n’y étaient pas encore, les russes, cet après-midi de la mi-février quarante-et-un où les copains avaient organisé un tournoi de cartes pour distraire l’ennui qui se traînait dans les chambrées. Un garde vint chercher l’abbé Levesque et interrompre sa partie : « Vous partez ! ». Il partit donc, avec son barda, escorté par une sentinelle qui devait connaître la ville aussi bien que son prisonnier. Ils prirent le métro, le tramway, ils divaguèrent, avec cet idiot casqué qui, à tout moment, demandait son chemin. Leurs errances s’achevèrent au crépuscule, au camp de Malchow.
C’était un Kommando « agricole ». Les prisonniers travaillaient, pour la plupart d’entre eux, dans un grand domaine de la ville de Berlin et, pour certains autres, dans les fermes de propriétaires des environs. Des quatre-vingt hommes que comptait le camp, soixante avaient demandé à pouvoir rencontrer un prêtre !
Il est pourtant difficile de croire que soixante-quinze pour cent de ces types étaient catholiques et pratiquants, après la Révolution russe et le Front Populaire. Pour autant qu’ils aient tous été paysans, ignorants, crédules, respectueux des institutions, des curés, attachés à la religion, à leurs clochers, à leurs chapelles, ébaubis au mystère du latin, confits en dévotion, éblouis par les dorures et les faux marbres d’un baroque de pacotille, enfumés et domestiqués à l’encensoir comme des abeilles dans la ruche, rats d’églises, mites à soutanes, moisissure d’encens… pour autant donc, tout cela n’aurait pu expliquer cette soudaine fougue de prière. Il fallait bien pourtant se rassurer, comme les naufragés sur le radeau ; se rassembler, faire naître un espoir et le protéger ; croire en la Providence, en son Destin, en un Avenir au delà de la défaite. Comme le dit simplement Roqueta : « I caliá Dieu per poder sofrir aquel mond ».
L’après-midi, Jean prenait le petit autel portable qui tenait dans une valise, et s’en allait dire la messe dans un autre petit camp dépourvu de prêtre. Au début, il était escorté par une sentinelle, mais très vite on le laissa aller seul porter la parole de Dieu à ces déshérités qui l’attendaient, pour ainsi dire, comme le messie. Les allemands avaient compris qu’il ne servait à rien de gaspiller le temps d’un soldat à promener avec ce paisible curé qui refusait par principe de s’évader.
Cette vie dura quinze mois. Elle aurait pu durer plus encore si elle n’avait été interrompue par l’honnêteté et la droiture native de Tonton Jean. Pendant l’été quarante-deux, ses « paroissiens » l’informèrent des vols qu’ils devaient subir de la part d’un caporal qui s’était acoquiné avec une cuisinière du camp et avait organisé un trafic avec les colis que recevaient les prisonniers. Même en Allemagne, la bonne nourriture se faisait rare… Jean, qui n’avait peur de rien, si ce n’est de la colère de Dieu, alla chercher querelle au Gefreiter ! C’est comme cela qu’il se retrouva pour la seconde fois devant un officier de justice. Il apprit ainsi que sa fiche l’avait suivi depuis la Kommandantur de Carentan. Ça, c’était de l’organisation ! Dans le bureau du Stalag, le Gerichtsoffizier prit note de tout.
Pour ce qui est du Gefreiter, le jugement était déjà prêt : Ostfront ! Il alla donc voir à l’Est, du côté de Stalingrad, si les colis arrivaient bien… de ce moment-là jusqu’en quarante-cinq, il eut peut-être loisir de recevoir un de ces « colis » que les russes envoyaient en nombre aux têtes brûlées de la croisade anti-communiste et aux mauvais citoyens du Reich. Il se pourrait bien que ses os y soient encore, dans la toundra !
La rigueur de la justice allemande ne fut pas aussi intraitable avec le curé. Elle se contenta de le relever de ses fonctions d’aumônier. Pour un mois de pénitence, on l’envoya travailler au bord d’un lac, dans le petit camp de Falkenzee. Aujourd’hui, avec le recul, on sait que l’Allemagne avait entrepris le pillage de l’Europe. L’afflux de prisonniers fournissait une main d’œuvre gratuite pour le formidable effort industriel de l’économie de Guerre, mais aussi pour toutes sortes de délires ou de monstruosités. Quiconque imaginait une ineptie quelconque n’avait qu’à taper dans cette manne innombrable et qui ne coûtait rien.
C’est ainsi que l’abbé Levesque se trouva engagé dans le travail imbécile d’aller découper des petits carrés de pelouse en bordure du lac. Il les transplantait ensuite autour des baraques du camp pour les agrémenter d’une couronne de verdure champêtre ! Les patrons de l’entreprise ne devaient toutefois pas y trouver leur compte, car Jean ne s’y épuisait pas vraiment. De plus, on sait que le rendement du travail forcé est grevé par l’entretien du geôlier.
Jean ne se souvient pas de son nom. Mais c’était un brave type le garde, trouillard ; il n’avait de cesse de lui répéter « los ! los ! » chaque fois que Jean prenait un bon bain dans l’eau fraîche du lac – bien sûr, c’était interdit ! Il se délassait, se roulait dans les courants d’eau froide comme un animal à la souille, plongeait sous la peau de la surface, se glissait dans ce monde silencieux et apaisé, laissait en haut guerre, haine, folie ; quand il remontait prendre son souffle, il saluait, soufflant des éclaboussures d’eau, comme une jument à l’abreuvoir. Pendant ce temps, l’autre lourdeau piétinait, s’énervait, suait de chaleur et de trouille, dans son uniforme et la chaleur de cet été quarante-deux. Epoque de grande folie ! Le garde risquait plus que son prisonnier : l’épouvantail du front de l’Est aiguillonnait le zèle de tout un peuple, entraîné dans un délire qu’il n’avait pas voulu empêcher, et pour tout dire, qu’il s’était un peu cherché… La sueur du garde, c’était la revanche de Tonton Jean.
Ainsi, début septembre, pénitence accomplie, bronzé comme un congé payé, Jean retourna à son travail d’aumônier. La kommandantur décida d’une nouvelle affectation : kommando 712, Spandau. Il rejoignit donc le Nord-Ouest de Berlin, comme d’habitude, moitié perdu entre métro et tramway, escorté d’une sentinelle qu’il se traînait plus qu’il ne la suivait.
Le kommando 712 était un petit camp, bien aménagé, peuplé de prisonniers français répartis dans deux baraquements, et où le médecin avait sa chambre personnelle. Divine surprise, la même chambre, pourvue d’un petit autel, attendait l’abbé Levesque. Avec les autres camps des environs, le 712 assurait une main d’œuvre nombreuse et gratuite, deux cents mètres plus loin, à la Märkichekabelwerke, usine de menuiserie et de fil électrique. Non loin de l’usine, un autre camp abritait de jeunes Ukrainiens – garçons et filles – déportés du travail ; une sorte de STO du front de l’Est, mais plus dégueulasse et raciste, puisqu’il s’agissait de faire trimer la sous-humanité slave, de force et à l’œil.
En cette fin quarante-deux, la Royal Air Force parvenait quelque peu à traverser les défenses antiaériennes allemandes. La Luftwafe commençait à se trouver submergée par les vagues toujours plus nombreuses de bombardiers qui s’élançaient sur le Reich, sans autre protection que celle du Bon Dieu : les Spitfire ne pouvaient pas escorter les Lancaster au delà de la Mer du Nord. Quoi qu’il en soit, nos amis anglais mettaient en place leur fameuse stratégie de l’Area bombing ou du Moral bombing, sur des objectifs civils. La Camarde fauchait dur, sur la terre comme au ciel. Les villes se creusaient d’abris conçus pour recevoir des milliers de personnes, les caves s’aménageaient en chambrées ; l’humanité contrefaisait la taupe.
Cet automne-là, la nuit allemande crépitait déjà du tir de la Flak et des explosions des obus antiaériens qui faisaient fleurir dans le ciel noir des centaines de petits nuages blancs. Au sol, la scène était illuminée par les éclairs de départ des coups, dont la fulgurance heurtée secouait les acteurs comme un stroboscope. En l’air, les projecteurs dansaient, à la recherche des avions. Les lignes de fourmis des balles traçantes les suivaient et leurs pointillés dessinaient des paraboles. De temps en temps, un de ces corbeaux abattu hurlait, rongé de flammes grasses, et pliait vers le sol l’arc de fumée qui le pourchassait ; parfois, l’un d’entre eux explosait, là-haut dans le ciel, joyeux feu d’artifice de tous ceux qui, en bas, s’étaient efforcés de l’allumer. Le grand oiseau saluait tout le monde, semant ses morceaux qui tombaient en tourbillonnant et s’écrasaient, de ci de là, sur les maisons ou dans les rues.
Ainsi, dans le camp des Ukrainiens, la baraque des femmes, touchée par une bombe incendiaire, flamba comme une meule de foin. Les Français furent priés de se rassembler dans un seul bâtiment et de laisser le second à ces pauvres petites qui avaient tout perdu du peu qui leur restait encore. En ronchonnant, les soldats s’entassèrent comme les anchois de la chanson . Ce dérangement servait cependant une cause juste, noble, généreuse. De plus, le voisinage féminin n’était pas pour plomber le moral de nos valeureux Piou-Pious ! Cette affaire dut susciter des jaillissements d’imagination, de rires, et de fantasmes à foison… sans doute cela fut-il une source d’espoir, de volonté d’exister, de demeurer fier et vivant dans l’adversité et l’absurde.
Malgré toute la misère du temps, les joies et les malheurs étant relatifs, les prisonniers de guerre français étaient « bien » nourris. En effet, il fallait que ceux qui travaillaient pour Gross Deutchland aient la force de travailler sans crever comme les mouches à la première froidure. De plus, protégés par les conventions de Genève, ils pouvaient encore recevoir ces fameux colis qui faisaient baver même les Allemands. C’est donc dans un grand élan de générosité – inspiré par les valeurs éternelles du pays de « La Carmagnole » et de « Maréchal nous voilà » – que les sous-officiers établirent l’usage d’inviter à leurs casse-croûtes quelques-unes de ces pauvres Ukrainiennes. Jean et ses copains prirent donc leurs repas du dimanche soir en compagnie d’Olga, Maria, Anna, Natacha et « une autre encore ».
Il ne nous appartient pas d’éclairer le sens de cette « autre » dans les failles de la mémoire de Tonton Jean. Quoi qu’il en soit, il m’assura que tout cela se passait « en tout bien tout honneur », et je le crois. Mais on sait ce qu’il en est, on ne peut pas empêcher les gens de penser à mal, même en Ukraine. Un soir que notre réunion franco-soviétique discutait et mangeait avec appétit, l’une des cinq filles plongea soudainement sous la table ! Ne vous faites pas d’idées fausses, elle s’était cachée car, devant la fenêtre, elle avait vu passer son « fiancé » ukrainien, qui lui, aurait pu s’en faire, des idées fausses…
La vie de Jean s’écoulait ainsi, en définitive encore assez libre et désoeuvrée pour une vie de prisonnier. Détaché des vanités de ce monde, dépourvu des sentiments de haine et de rancœur que la majorité de ses compagnons ruminaient à l’encontre du peuple de ses geôliers, l’abbé Levesque entreprit l’étude de l’allemand avec la méthode Assimil. Ce flegme et sa curiosité naturelle lui permirent de maîtriser convenablement la conversation courante et d’entretenir de bonnes relations avec les autorités et la population.
Ces études ne menèrent Tonton Jean ni à la lecture des philosophes, ni à celle des poètes allemands. L’aviation alliée interrompait de plus en plus souvent l’apprentissage d’Assimil et de la belle langue de Goethe ; en quarante-trois, c’est à vivre sous les bombes qu’il fallut apprendre. Tout le monde avait un sac, toujours prêt, avec un petit nécessaire, quelques vêtements, quelques reliques et à chaque alerte, on filait aux abris. Quel tracas, à chaque coup de sirène, d’aller s’enterrer comme des rats dans la puanteur et l’obscurité étouffantes de cette foule apeurée, impuissante, abandonnée au hasard des impacts de bombes, épargnée, enterrée vivante ou massacrée, selon les volontés obscures de dieux devenus fous.
En quarante-trois, les bombardiers anglais eurent plus de facilité à venir rôder au dessus du Reich. Désormais, ils étaient escortés de chasseurs Mustang, qui étaient équipés de réservoirs largables et avaient ainsi une autonomie suffisante pour protéger les Lancasters tout au long de leur mission. Hélas, tout le monde n’avait pas réalisé cette nouveauté et encore moins appris à vivre sous les bombes. Certains aidaient même le hasard – ou les dieux – à faire le tri des tués et des survivants. Le seize janvier, un grand raid aérien tua cinquante-six prisonniers français et en estropia quarante-cinq : cent un types, fatigués peut-être de cette agitation perpétuelle, de ce délire de fourmilière, fatigués de se sentir oubliés, remplacés d’un côté du Rhin, collabos de l’autre, fatigués d’être les pantins de toutes les propagandes, de se retrouver dépossédés de leur destin de héros, de ne même plus pouvoir jouer avec la mort, enfin, fatigués de cette vie de cons, et qui attendaient que les bombes alliées veuillent les libérer de cette folie ; cent un types fatigués, sans plus peut-être, simplement paresseux de se traîner jusqu’aux abris, et qui restèrent dans les baraques de bois, exposés au semis de la mort tombé du ciel.
Mais la guerre est la guerre, azimutée et toujours un peu surréaliste. Elle n’a jamais empêché la vie de filer son train. Ceux qui suivaient les consignes de sécurité parvenaient à se payer un peu de bon temps : Jean et ses copains prenaient des libertés avec le règlement et, cet été quarante-trois, allaient se baigner dans le Havel. « Les Français vont se baigner, alors que nos hommes sont en Russie », marmonnaient ceux qui avaient voté pour l’Oncle Adolphe…
De fait, la Russie commençait à sucer le sang de l’Allemagne et les soldats partaient de plus en plus nombreux fumer les steppes de l’Oncle Joseph. On ne pouvait plus entretenir des armées de geôliers à surveiller ces cochons – Schwein ! – de Français. L’administration, toujours futée, imagina un bon tour de passe-passe : nous avons besoin des prisonniers parce qu’ils travaillent ; si nous avons des prisonniers, il faut les garder. Si nous n’avons plus de prisonniers, nous n’avons plus besoin des geôliers…
L’automne venu, le seize octobre, Jean devint « prisonnier de guerre en congé de captivité sur place » : tous ceux qui avaient accepté un poste de travail étaient transformés en « civils » et avaient toute liberté d’aller et venir dans le Grand Berlin, en dehors des horaires de travail, bien entendu. Ceux qui avaient refusé ce statut furent enfermés dans des camps avec miradors et barbelés, faciles à garder, sans trop de geôliers…
Jean était aumônier de ses copains à la Märkiche. Il dut, pour y rester et échapper aux camps et aux barbelés, tenir un poste administratif à la direction de l’usine. Le directeur de l’entreprise, Herr Doktor Schneider, l’avait fait asseoir dans son bureau et, dans un français imprégné de l’esprit des Lumières, lui avait accordé trois quarts d’heure, le matin et le soir, sur son horaire de travail, pour assurer les Services Divins. De retour dans son siècle de dépit, l’abbé Levesque faisait fonction de comptable du service d’entretien et de réparation des machines-outils. Il préparait le programme et la fiche de travail de chacun ; en fait, il était secrétaire du contremaître, Herr Kolibaba.
Ce n’était pas une peau de vache ce Kolibaba. C’était même un brave type. Il travaillait en bonne amitié avec l’abbé Levesque ; il devait être catholique lui aussi et ça y fait pour arranger les affaires. Il pouvait se fier à un secrétaire honnête et dormir tranquille, le travail était fait, et bien fait. Par ces temps-là, c’était un peu comme une assurance contre l’Ostfront, ou le voyage en Pologne…
C’était une vraie bénédiction, ce curé, pas question de lui chercher des histoires ! Jean lui, était comme un coq en pâte, il faisait la conversation en allemand, avait repris l’étude d’Assimil et ne manquait de rien. Son peu de travail achevé, il avait le temps d’exercer sa mission de prêtre, celle qui soutenait sa vie. Le matin il disait la Messe, l’après-midi il visitait les hôpitaux, les malades du STO, les blessés des bombardements ; les enterrements aussi. Les grands raids aériens du vingt-deux au vingt-six novembre, par exemple, lui donnèrent beaucoup de travail.
Ainsi, la vie de prisonnier s’écoula toute l’année quarante-quatre, entre Herr Kolibaba, le petit bureau de la Märkichekabelwerke, les Messes, les bombardements, l’aide aux camarades, les blessés, les cadavres, le désespoir ou l’espérance, la folie du temps. Vers la mi-décembre, Jean fut convoqué à la direction du stalag Drei D, Belle Alliance Strasse, qui dirigeait une centaine de Kommando. Il dut s’en retourner dire adieu à son ami Kolibaba et à ses camarades de camp et de travail ; à Olga, Maria, Anna, Natacha et à « l’autre » aussi : le grand joueur de dés de l’administration avait réuni douze confrères prêtres, agité sa timbale et éparpillé les curés sur le tapis du Grand Berlin. Chacun repartit comme en quarante et un, bagages sur le dos et traînant la sentinelle réglementaire.
***
Dans le bureau du presbytère de Quinéville, j’ai déjà gribouillé quatre pages de ce papier jaunâtre et pelucheux, arrachées à un vieux cahier cousu, que Tonton Jean m’a données pour prendre mes notes. Tels les échansons, nous soutirons la mémoire. Jean a ouvert le robinet de la cuve : deux petits carnets, de ceux qui tiennent dans la poche, et qui dormaient ensemble, liés avec un élastique, dans la cave sombre du tiroir du bureau. L’air frais de la voix de Tonton Jean, de son commentaire, redonne vie au vin vieux qui coule, l’oxygène développe ses parfums, fait étinceler sa robe rouge, cramoisie, comme le sang ; sang du Christ, sang versé de tous les morts de ce récit, de tous les morts de la guerre. Je suis là, avec mon entonnoir, quelques gouttes m’échappent, bien sûr, mais mon tonneau se remplit peu à peu. J’apporterai ce vin à la maison. Il faudra le laisser reposer, se remonter après les coups et les ressauts du voyage. Un jour, lorsqu’il sera mûr, il faudra le mettre en bouteilles. Vous le goûterez et vous m’en direz des nouvelles…
L’abbé Levesque et moi faisons une pause. L’odeur de la cave nous a un peu fait tourner la tête… histoire de parler d’autre chose, nous manipulons le « stéréoscope de Brewster ». C’est un beau petit instrument optique, fabriqué en bois de poirier, comme les équerres des architectes. Un binoculaire est fixé au bout d’une réglette. Sur cette réglette, un chariot, qui peut aller et venir, porte une plaque photographique de verre. La plaque, rectangulaire, montre deux vues semblables, l’une à côté de l’autre. Si vous regardez dans le binoculaire, il suffit d’amener le chariot à la bonne distance des yeux pour avoir une vue en relief ! Nous admirons le monde d’avant quatorze, d’avant les grands massacres, le monde de Papa Levesque. Les garçons sont habillés en marins, les filles portent de grands chapeaux de paille ronds ; beau temps passé.
Tonton Jean a repris la lecture de son journal de guerre – et moi le crayon. Les dates se suivent, une après l’autre, comme les grains du chapelet, avec toujours les quelques phrases d’un homme qui n’avait pas trop de temps à perdre à écrire ; des phrases comme des suppliques pour que tout cela ne recommence pas… Il tourne encore une page. Depuis combien de temps ces pages n’ont-elles plus vu le jour ? Depuis combien de temps Jean n’a-t il pas relu son histoire ? Pourquoi la réveiller pour moi qui viens de si loin et qui parle une langue étrange ?
– « Mil neuf cent quarante-cinq ! »
Bon, on verra ça plus tard…
L’abbé Levesque avait donc laissé son ami Kolibaba, ses camarades, Olga, Maria, Anna, Natacha et « l’autre » à la Märkichekabelwerke ; il commença l’année quarante-cinq dans un petit camp de trente prisonniers, clos de barbelés, près du métro Zehlendorf. Jean travaillait toujours, selon ses qualifications reconnues et éprouvées, dans une grande base de l’intendance militaire allemande. Il s’occupait de gérer le matériel de bureau : crayons, règles, feuilles et compagnie… A la guerre comme à l’école, tout cela est nécessaire ! Dans ce nouvel emploi non plus, le patron ne stressait pas trop l’abbé Levesque ; Jean jouait souvent au foot avec les copains, avec les gens du quartier, avec les gardes, un jeune surtout, un gosse, affublé du vert-de-gris de l’uniforme et embringué dans la danse macabre de la guerre. Les démons de la haine s’efforçaient, mais en vain, de s’emparer de l’âme de Jean.
Mil neuf cent quarante-cinq ; beaucoup de trous dans le journal de Tonton Jean. Alertes quasi continues ; jour et nuit, à tout moment « aux abris ! » ; c’est plus qu’une armée – même allemande – n’en peut supporter : dès le mois d’avril, les militaires ont bien compris que pour eux, tout est fini, terminé. Le Reich a échoué, l’Allemagne s’écroule, la Wehrmacht fond comme la neige au mois d’avril, justement. Il ne s’agit même plus de sauver les meubles, mais d’échapper aux griffes d’une mort annoncée, de bondir, comme des sauterelles au passage de la faux de la Camarde, qui étincelle comme l’aile d’un avion. Alors, les jambes à son cou ! Du général au seconde classe ; et vers l’Ouest ! S’il faut se rendre, s’il faut recommencer une autre vie, mieux vaut se débrouiller pour choisir le bon vainqueur ; on laisse tomber l’Oncle Adolphe, c’est pas pour aller se jeter dans les bras de l’Oncle Joseph ; « Vive la Liberté ! » comme dit l’Oncle Sam ! Ceux qui voulaient mourir n’avaient qu’à se faire tuer…
Prisonniers – et population – se trouvèrent donc abandonnés là, entre balles perdues et explosions de bombes. Beaucoup payèrent de leur vie la rage des derniers défenseurs, la haine revancharde de l’Armée Rouge, la cécité de l’area bombing.
Le récit de Tonton Jean me rappelle un épisode que j’avais presque oublié, mais dont le poids dramatique m’avait marqué. J’étais encore un écolier et une vieille femme m’avait raconté ces cinq années qu’elle avait passées à attendre son mari, prisonnier en Allemagne. C’est justement lors de ce printemps quarante-cinq que le père de ses enfants, le lieutenant-colonel Lair mourut sous les bombes de ses alliés. Après cinq ans de captivité, il voyait enfin venir le temps de la liberté et la fin de l’humiliation. Sa veuve donc, me donna son casque ; chez elle, tout le monde s’en foutait comme de l’an quarante… Il porte les quatre galons argentés, peints à la main sous le blason qui montre une allégorie échevelée de la République, avec la précision « R.F », pour ceux qui ne comprennent pas bien les figures de style. Je garde ce casque à la maison, avec celui du grand-oncle Véran, orné quant à lui du cor de chasse.
Mais, pour en revenir à nos moutons – et sans chercher de plaisanterie facile – il ne resta que trois cocus pour les garder. Je dois toutefois ajouter que ceux qui ne suivent pas le troupeau, pour rester dans la métaphore pastorale, sont rarement complètement idiots : le Feldwebel qui avait déjà résisté, avec deux soldats, à la vague soudaine de la débandade, ne se laissait pas ébranler par les raisonnements et suppliques de ses prisonniers qui voulaient le faire fuir à toute force ! Jean lui expliqua qu’ils se garderaient bien tout seuls, qu’ils ne feraient pas de bêtise, qu’il ne servait à rien d’attendre là les russes, la mort ou la captivité… Digne, l’autre répondit :
– « J’ai été prisonnier des anglais en dix-sept, je le serai maintenant des russes » ; c’est tout !
Stoïcisme, fatalisme, sentiment de culpabilité collective d’une Nation face à ses crimes – ou face à son échec – recherche du châtiment, de l’expiation, ou sagesse de l’homme déjà mûr, las de la vanité des agitations humaines ? allez savoir ! Quoi qu’il en soit, Jean réussit à convaincre un des deux soldats, le plus jeune, qui se défila avant qu’il ne fût trop tard.
De fait, le vingt-cinq avril, ils virent arriver une douzaine de chars T.34 russes – chars libérateurs, cette fois-ci – avec une automitrailleuse de commandement et la troupe derrière. Immédiatement, les soviétiques firent prisonniers les deux pantins de la gloire perdue. C’était écrit ; et ici s’achève tout ce que nous savons de leur mauvais karma.
De suite, les russes ordonnèrent aux prisonniers français, qui gênaient là au milieu, de fiche le camp. Fiche le camp, d’accord, mais pour aller où ? Le travail de Jean ne s’était pas achevé avec la « libération » de son camp et il devait s’occuper du destin de ses camarades. Il fallait discuter avec le capitaine russe qui commandait la batterie. L’abbé Levesque, qui devait avoir un goût cinématographique pour les héroïnes opprimées, prit avec lui une des filles du STO ukrainien pour lui servir d’interprète. Elle était restée avec les français car elle était la petite amie d’un des copains du camp, « en tout bien tout honneur ». Entre eux ils parlaient allemand ; la langue du bourreau se trouvait être celle qui scellait l’unité, la communion des victimes, et négociait leur libération. Enfin, le capitaine soviétique – sensible à la fraîcheur de sa compatriote et, il faut bien le dire, à l’autorité de la religion – leur permit de rester aux abris, pour attendre la fin des combats. A ce moment-là, on tuait les chevaux pour avoir quelque chose à manger.
Le deux mai on apprit la capitulation de Berlin. Le huit, les prisonniers reçurent l’ordre de partir, pour du bon. Jean trouva une bicyclette pour aller aux bureaux de la municipalité demander des bons de pain, et il en obtint sans problème. Il se paya même un petit plaisir ; lui, le kriegsgefangener, il passa devant la queue de tous les Berlinois… La vengeance de Tonton Jean les laissa pantois ! Le lendemain, les prisonniers libérés achetèrent du pain, volèrent un charreton et la bande de Zehlendorf partit à son tour, avec deux ou trois cents autres prisonniers, vers l’Ouest.
Après trois jours de marche, les sympathiques Russes qui les escortaient les laissèrent pour quelques jours dans un camp qui rassemblait les gens en partance pour ce qui ne s’appelait pas encore Le Monde Libre. Ils furent ensuite conduits en camion jusqu’à Wittenberg, la ville de Martin Luther, où ils restèrent huit jours. Dimanche dix juin, après une dernière journée de marche, les Russes les livrèrent aux Américains, sur un pont, un des rares à rester praticable pour franchir le fleuve Mülde. Ils restèrent là quelques jours de plus, nourris couçi-couça, car les libérateurs n’arrivaient plus à faire face au reflux de tous ces « occidentaux » dont les soviétiques se débarrassaient aussi vite que possible…
Le dix-huit juin quarante-cinq, cinq ans jour pour jour après avoir osé retourner ses mitrailleuses contre les chars de Rommel et avoir manqué l’appel du Grand Charles, l’abbé Levesque prit le train pour Paris.
Heureusement, dans ce sens-là, les trains à bestiaux gardaient les portes ouvertes ! A Nancy, ils passèrent quarante-huit heures à faire de la paperasse et arrivés à Paris, ce fut la même chose. Après une dernière nuit de caserne, on les lâcha avec un sac sur le dos et en avant la musique ! Par chance, Jean avait de la famille à Paris. Chez sa sœur Thérèse, il retrouva Jacques, son frère cadet, pour lequel Jean avait tant d’affection, et qu’il avait laissé à Saint Lô, le jour de la mobilisation, le jour où la réquisition lui avait sucré la Monet-Goyon. Ensemble, ils purent boucler la boucle de ces cinq ans de guerre.
Jacques était là en permission. Lui, la feuille de mobilisation l’avait envoyé en Algérie. Après la défaite, son bataillon de chasseurs alpins avait refusé de rester dans l’armée maréchaliste de Darlan… Peut-être que là-bas, ils avaient écouté l’appel du Grand Charles ? Quoi qu’il en soit, ils prirent le maquis, comme on dit et, lors du débarquement allié en Afrique du Nord, rejoignirent l’armée de De Lattre. Jacques fit ainsi toutes les campagnes d’Afrique, d’Italie, de France, jusqu’au Rhin. Les événements avaient fait de lui un soldat : il était maintenant sous-lieutenant.
Les deux frères avaient suivi deux voies. L’un avait accepté la fatalité de la défaite, il avait posé sa Hotchkiss dans la salle des fêtes et suivi sans discuter le fleuve des prisonniers. Son combat avait été un combat d’humanité, de fraternité, de communion, un combat contre la haine. L’autre avait refusé la fatalité de la défaite, avait gardé ses armes, avait lutté physiquement et – certainement à l’encontre de sa conscience – avait tué. Tous deux, chacun à sa façon, avaient suivi les voies de la dignité et de l’honneur.
Mais comment pouvaient-ils bien revenir, tous deux, vivants et entiers, après avoir traversé toute la guerre de quarante, comme autrefois Giono, comme l’oncle Véran, comme Barb’Angelin et son fils ? Comment Tonton Jean avait-il pu accepter cinq ans de déportation, de galère, supporter les bombardements majeurs du XXème siècle, sans même un jugement sur ce peuple responsable de tant de dégâts ? Comment avait-il pu accepter tout ça sans révolte, sans un doute ou un blasphème, sans refuser le destin, la fatalité de la mort, le carnage, la terreur perpétuelle ? Comment avait-il pu apprendre l’allemand avec la méthode Assimil, faire la conversation avec le contremaître et travailler consciencieusement ? Peut-être que Tonton Jean est une sorte de moine bouddhiste zen ; ou simplement un vrai chrétien ?… sans doute un être Humain.
Mais pourquoi se poser tant de questions, alors que de toute façon – nous le savons bien – il n’y a pas de réponse. La seule certitude ici-bas, c’est celle de ceux qui eux, ne sont pas revenus, comme le lieutenant-colonel Lair. La seule certitude c’est celle que gueulait Super-Truchi de Ribassière, les soirs de cuite : « De toute façon, de cette vie, on s’en sortira pas vivants ! ».
Il le savait bien Herr Kolibaba, qui toutefois jusqu’à sa mort, bien des années plus tard, envoya chaque année à Tonton Jean, une carte de vœux pour le jour de l’an.
Nice, décembre 2005.
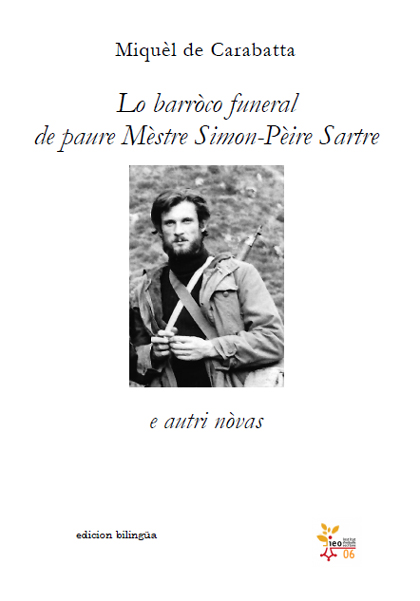
LO BARÒCO FUNERAL DE PAURE MÈSTRE SIMON-PEIRE SARTRE
« Amics favolós, dont siètz toi esto sera ? »
Janluc Sauvaigo ; Li Brigas dau past ; C.D. Banhanàs
Ai en ment la telefonada que m’a anonciat la sieu mòrt ; mas la sieu malautia l’ai emparada sabi pus coma, sabi pus d’a qu, dau temps que faíi lo molaire en arqueologia a Taltevulh, cap luèc mondial de la preïstòria e dau travalh a jaba. Totun, m’enavisi que lo sabta-diménegue seguent, en plaça de m’entornar dau bòn costat de Var, ai pilhat l’avion a Perpinhan e mi siáu empuat en París.
París… aquò qu’auria deugut èstre un castic per ieu, o mi siáu beugut coma un ros d’òu : aeropòrt, ensenhe d’informacion que un li capisse ren, fòga de gents ; grani lògias ventoï dei estacions de bus ; metrò, que l’oudor moligàs de la sieu ganassa v’assauta lo morre, coma se v’auguesson mandat un popre negre a la cara…de tot aquò, ai vist ren ; manco sentit.
Damont, li avian ja dubert la còta per ne’n traire una lúpia e levat la mitan d’un lèu. Avia dich ren en degun ; s’èra entanat, aplatat coma un sanglier ferit, en aquela ciutat que, de costuma, li anava basta per arretrovar la sieu companha, faire l’Amor e si sopar ai candelas embe de vin vièlh e de plats requists.
En tant, un pauc d’ària fresca li faguet ben ; fogueriam urós de s’arretrovar. Sòrt ò necessitat, la sieu calinhera Clara se’n partia quauqu jorns, just que ieu arribavi. Estagueriam ‘tai doi.
De lo vèire, de l’audir, molet un pauc l’estòc ben atesat que m’avia costrech lo gòi despí qu’avii emparat la bruta nòva. Pura lo malandresc avia ja ben degalhat l’omenàs e la quimiò li ajudava. Semblava encar mai gran d’aver tant consumat. L’escala dau siéu còrs, facha d’òs lòngs e fòrts, lu sieu grans braç dai mans esplandidi coma de florassas, la sieu testa ruada, envielhida, esprovista dau sieu bèri escarpinat, aquela caminaüra brancolanta e desassegurada, qu’es lo fach tant de l’escufuènha contúnia dei medecinas que de la debolessa sùbita dau còrs e de l’ànima, tot aquò li donava l’andana d’un aucelàs tràgico.
Tra nautres faiavam pas de landa. Aviavam ja barolat una vièlha amistat e tralaissat per camin lu amarums e lu tradiments que mancan pas de faire la pròva d’amics vièlhs. De conversa en contraversa, de pastrolh en garolha, de vin en branda, de confidança en petanha de rire, aviavam viugut ensems lu gaugs dei viatges, de la gaudina, de la caça, de l’ària viva e dau soleu. N’aviavam vist d’autri ; aqueu cancre èra una fachenda de mai.
Es ensin qu’es a ieu que mi demandet de li tondre lo suc. Renonciet ai quatre chufos raspinhós que sobravan de la chivusiera romàntica, faussament trascurada, que la si pienchenava dei mans, emb un moviment de la testa e dei braç qu’enmascava li pichonas. Ai obrat ; mi semblava d’èstre lo prèire d’una ceremònia antica. Lo rasor talhava en l’escuma blanca, escapolava lo pòst de la trapanacion parier coma la nau l’escuèlh, coma se siguesse lo molon d’un bambin.
Sabi pus quant siáu estat ensems emb eu aquesto còp d’aquí. Bessai doi jorns. Si posquet enfin laissar anar a mi parlar de la malandra, dei mètges, de l’espitau, dau sieu patiment. Charreriam de la sieu vida embe Clara, de la sieu Bretanha tant aimada e dau temps que i avia fach lo pescador, de Sant Pèire e Miquelon, de l’Argeria que i avia obrat e de la mieu vísita a Ànaba ; de la vida, que ! Aquò n’ajudet totai doi a oblidar un moment l’ombra de Tanta Chiqueta que trevava lu silencis e lu batres d’uèlh ; aviavam besonh d’esper. Si siam pi convints que fin finala, la fachenda s’adoberia, que calia crèire au sanament, que li recalivaduras que manquerian pas d’acapitar, serian coma de banquets d’a puar per la reconquista de la vida.
Una man de setmanas mai tardi, decidet de se’n anar – morir – en lo sieu. S’entornet blocar la bloca, au sieu breç, au principi, en aquel Amor chavanós e violent, fach d’esperança fòla e d’escufea, d’òdi e de tendressa : Jonhet lu afres de la sieu solitude a’n aquelu de sa maire.
Lo mieu enfant lo màger s’enavisa encara dau sant fosc d’un òme, granelàs, dau suc pelat, viestit d’una lònga camia blanca – e qu’estentet de bada per estar entaulat embe nautres fins a la fin dau past de miègjorn : Simon avia vist un darrier còp la mieu familha. Non posquet, coma n’eravam pactis, èstre lo pairin dau mieu enfant lo mendre.
Lo veguèri pi viu encar una fètz, que non quitava pus l’ospitau. La maion familiala, l’apartament de la sieu calinhera, lo monde, la vida, èran ja de sovenirs luènchs. Era solet en una cambra, lu braç duberts en un liech blanc, coma clavelat ai coissins, lu uèlhs cavats d’au dolor, la carn consumada fins a l’òs dau patiment, lu moviments lents e penós, la votz amurcida, retenguda en la sieu poncha dau gòi, aguda coma una saëta e que semblava de si pilhar lo ciel en dreçura. L’andana dau còrs dau mieu alter ego èra ja aquela de Jèuse au pen de la crotz.
Proveriam mai de charrar. Li donèri de nòvas de la mieu parentela, li parlèri de la caça que s’èra just duberta, de l’arbèrg a Ribassièra dont si faiavam petar li sieu botilhas de branda de Borgònha. Provèri d’abordar quauqu projèctes, mas mi semblava de legir la mieu guinha faussa que si miralhava en lo sieu viston espalancat. Mi diguet coma sa maire venia de matin e lo presdinnar l’ajudar per tot. Li issugava la cara emb un mandiu, li tenia la man, charravan per tuar lo silenci ; bessai si ploravan… Simon avia pus lo coratge de refudar de se’n tornar bambin. Mi faguet encara quauqui demandas e, après d’un silenci :
– Pòrta-mi un pauc un 6-35, que la finissi !
M’avantèri en una respòsta a rage, dau temps qu’un trem mi gelava lo còrs. Ben segur, si podia pas. O podii ren faire, non o mi podia demandar ! Tant tot un, de 6-35, n’avii ren en maion e, n’auguessi pura, non aurii poscut èstre complici de …
– Salòp ! mi respondet.
Sortèri de l’espitau au calabrun, anequelit, nauseós, la boca seca coma un bòsc. Sentii pus li mieu cambas, lo mieu estòmegue si gropava ; la mieu viliacarira mi faía scufea. La vergonha de lo laissar ensin, solet en aqueu desper, embe lo desidèri d’aquela mòrt que lo faía languir, que li esguilhava dei mans, coma li trochas que chapavam en lu valons de Ribassièra, aquela vergonhassa si mesclava a la ràbia de l’impoténcia ; e l’injustícia de la sieu respòsta mi clavelet l’ànima ai forcas dau tradiment.
Moret en lu braç de sa maire, lo sera dau quinze d’octobre dau noranta un e quora li pensi torna, mi ven en ment lo sant de la Pietat.
* * *
Mas, quauqu an en arrier, au sieu de fach, quora li èra mòrt son paire, avia repilhat la sera d’aiga dei Sartres, lu sieu vièlhs. Era pas estat una decision aisada. Calia alugar la camia laugiera de la libertat e de la joinessa fantaumiera per si tapar de la ropa dau dever, de la tradicion familiala, de la realitat. Calia torna ormejar, en aqueu país freiós, neblós, enfolopat de garbin, sainestre d’una pluèia sempiterna, e que l’avia fugit despí bèu temps per s’escaufar lo còrs e lo còr ai lumes de la Mar Nòstra e dau Saarà.
S’era caugut arrapar embe l’image dau paire, cauçar li sieu bòtas, si reventolar en lo sieu asseti, picar en la sieu cròta, s’empadronir de la sieu plaça e virar davant-darrier lo potret dau maréchal pendut au postat dau burèu ; avia caugut faire, èstre, estar, fins tant que s’ataisesse lo resson de la bòta qu’avia amaçat lo vièlh Joan-Batista, son paire.
De filòsofo, Simon venguet boscatier. Mas aquò es un afaire basta per aquelu que conoisson la vida a mitan… Si faguet doncas mèstre dau Moulin Rouge , dei Sartre despí de sècolos. Bessai que podia pas anar diferent, un còp joinessa passada…
Aqueu Molin Ros èra un ostalàs dau sècolo XVII qu’encambalava d’una vòuta lo riu que cola en per amont : la Marne. I èra ja pura una temporanha que non s’i molinava pus de gran e que faia d’a « Castèu dei Sartres ». Sobre la vòuta, au promier plan, durmia una capèla que podia assostar mai d’un centenau de personas, embe òrgues, bandièras, estàtuas e, en la sacrestia, un armari clafit de relíquias de sants de la tèrra universa. De cada costat de la vòuta dau molin e de la capela, sus de très nivèus, de filanha de corredors, d’escalinadas, de peças, de cambrons, de recantons, assostavan totjorn lu atràs de quatre cent ans d’antenats. A l’intrada, lo capèu encar pendut e lo baston dau bis-avo donavan lo relais. Un s’avarava pi en lo castèu de « La Bèla Durmela ».
I s’atrovavan, l’armari d’un arquimista, emplit de topins de pos de toi lu colors, lu manescrichs dei composicions de mantu capelans – lu abats Sartre – umanistas e musicants qu’avian fach la glòria e la poténcia de la familha, de tombarèus de libres e de pergamins arnats, una man de relòris frusts qu’avian acabat despí bèu temps de sonar li oras d’una època denembrada, l’aisamenta, li posadas, la rauba, lu aises de vint mainages, tota raça de mubles a bodre, d’antifònis a ofa, d’entrics a babalà, de crochefiç, de sants, de gravaüras, de tablèus, d’istrument de mùsica desmaisselats, de còfres emplits de memòria e serrats d’a la denembrança ; fins au klakson e ai fanaus d’aram d’un taxi de la Marne trasformat pi en camion e que lo sieu rastèu acabava la guèrra dau quatòrze a la sosta airioa d’una lògia de la serra.
Au sobran, l’armadura dau cubert de lausas semblava l’arca de Nové, engravada en li tèrras e revirada coma un estofa-lume sus d’un monde amurcit e tralaissat ai cosses e ai taranhinas. N’amont, un si seria cresut d’èstre en glèia, que lo sieu trep ressonava sus lo sòl de taulas rústegui, coma sus d’un tambau : tant lu plans sotrans èran clafits coma d’oires, tant aquela botassa d’un cubert èra monacalament vuèia. I èra basta un taulier de bilhard estranhament perdut aquí e, s’acapisse, respir dei « ànimas purganti », lo bofet crepat dei òrgues de la capèla…
Una part soleta dau plan terren de l’ostal estaguet en lo monde dei vivents, quora la familha tralaisset a pauc a pauc lo Molin Vièlh, a la fin dau sècolo XIX, per s’estabilir en la Maion Nòva qu’avia fach bastir just davant, de l’autre costat de la lea : de fach, per comoditat, lo burèu dau mestre estaguet en l’Ostal Vièlh, tana aclapada sota lo bauç fossili de la bastissa, aparat d’a l’escurcina sacra e muta de la capela, de costat dau sang d’aqueu molin que raiava sempre, sota la vòuta vesina vesina que retronava d’un remon de gorg.
Aquí, venia mai a ben per anar e venir de la sera, chauchar en la pauta de la cort, en la graissa dei engranatges, dei eissàs, dei ceguinhòla, per s’entornar a la sosta sensa manièra, après dei caminadas en forest embe lu boscatier, lu gardas bòsc ò lu venditors de copas. S’i podia far venir, sensa estòria ni paur de brutar, lu camalos, mulatiers, carretiers, conductors, mecanicians, bòchas, obrier, mesteirans, toi un pau tements, la berreta en man. S’i pilhavan d’instruccions ò una bòna chincha en familha e, fin finala, s’entornavan emb un abuton sus l’espatla per i emparar a surbir l’amarent e escupir lo doç. S’i podia finda charrar l’ànima quieta embe cadun, destapar una botilha tant embe lu amics ò li pràtigas qu’embe lu chapa-choc ò lu cacans de la circonscripcion.
Èra una tana d’òmes, ben reparada de la curiositat e dei lavabús dei fremas – qu’aquò èra lo monde net e poliçat de la Maion Nòva. Es doncas d’aquela socara que si donava la partença per li partidas de caça, lu pasts a l’òste ò li tamponas au fum. Es en aquela filanha de très peças bassi que manti generacions d’aigràs augurèron pi d’èstre gradits e qu’emparèron lo sieu gaube de viure de Sartres.
La Maion Nòva d’en fàcia odorava ben lo segond Empèri finissent, ò lo principi de la terça República : un cubo de très nivèus que l’i s’intrava en puant quatre banquets de màrmor blanc acabat d’un planet dau paviment en escaquier ; i si podia reçaupre lo monde en lo regarjant de dessobre. Un cubert de lausas negri, fach a sofieta, encapelava tot aquò. La bastissa èra pauvada sus d’una raça d’ísola : lo tròç de jardinet escars que l’environava anava picar en l’aiga de très costats.
I èra doncas La Marne que filava sota la vòuta dau Molin Vièlh, mas tanben un beal de l’aigatge, tot encaladat de gròssi pèiras e tant larg coma lo riu que li donava d’a bèure. Faía coma un coe ficat en l’aiga embe doai enclüa de cabrionas de rore, mougudi d’a vit e ceguinhòla de fonta.
Lo promier còp que Simon m’a menat au sieu, de la mieu vida avii jamai vist una cauva pariera, acostumat qu’èri ai pichins beals dau país niçard que si pòu manco aigar doai regas de faiòus au còp… Ai emparat tanben cen qu’èra un negaís. En aqueu país aigassós, calia tenir d’a ment lo nivèu de la Marne quora non quitava de plòure de très setmanas ; alora, si mandava lo sobre-pus en lo beal en jugant embe li encluas. Quora tot aquò sobreversava, i èra ja bèu temps que la cròta èra a muèlh. Es aquò qu’aqueli vièlhi botilhas de brandas segeladi de cèira rossa – que Simon li faía petar a son paire – èran bruti d’un pos fin fin : la beta dei plenas dau riu.
Un pauc mai en là, mas gaire luenh, i èra lo beal-gran. Aquela mai ! èra pus aut que lo nivèu de la Marna, ajocat sus d’una riba erboa, emb una encluassa e una maioneta per lo garda, coma se’n vetz en lu vièlhs libres de geografia. De tant en tant si veía passar una penicha. Tracolava en lo truèlh, ò au contrari pareissia, coma una luna que si leva. D’aqueu temps, lo marinier si faía un tròç de pastrolh embe la frema de la D.D.E..
Sus de cada riba d’aquela aiga pàia e verdastra, s’alongavan lu camins bateliers e de filanhas d’arbolàs. Es aquí que sa maire de Simon anet pi en bicicleta, per anegar lu rabatins que trovet estremats e denembrats en li cantaretas e aplataòiras de maion, brut regal de toti li armadas qu’avian batut barona en lo país. Si pensava ensin de n’amurcir la braisa per totjorn. Augurava, bessai, que lo « gloff ! » e lo gorguet que s’esprefondissian l’aise, s’estirassesson ensems emb elu la remembrança, la mauparada ; e que lu ròdols que filavan sus de l’aiga escasseguesson la malia, parier coma faían fúger li « cabras de nòstre Sinhor ».
Un pauc pus de vers amont, i èra lo pòrt qu’avia embarcat lu cargaments de fusta façonada e provedit l’usina en carbon, dau temps de l’espandiment e de la chabença a rage de la belle époque.
L’usina – la Sèrra Sartre – embe la sieu cheminèia de bricas rossi que li faía d’a bandièra industriala, d’a ponch d’amira, si veía de luenh. Aqueu totèm avia trach lo fum de l’estuva que tractava li taulas, dau temps qu’en França si polissia de parquets e si fustejava de « bòscs d’aubres ». Aquela estuva èra tant grana coma una maioneta, murada de brica, embe d’armaduras e de pòrtas de fonta ribladi ; mentava li gravaduras dei romans de Jules Vernes. Era aclapada en un variu de lògias e de cuberts creissuts a bodre, arrambats a’n un costat de l’Ostal Vièlh.
Lo camin de ferre, que passava un pauc mai en là, avia mandat un braç que faía lo servici de la serra. La religava pi ai lògias de depòsiti e d’issugament esparpaiadi sus de la proprietat e faía tirar fins au pòrt dau beal gran. Tot aquò èra man a man a l’avast despí de la guèrra. La gramènia e lu romegàs curbian lu ralhs rolhós ; lo vent jugava a faire volar lu cops que lambrochavan sus lu cuberts e venian eschuepar – coma d’un temps li bombas – a l’environ dau taxí de la Marna.
Avian pi bastit una serra moderna que regarjava aqueu caramentran desganguilhat embe la mótria dei sieu tòlas lusenti e l’assegurança de l’arquitectura racionala dei caissas de municion. Tra aquelu doi testimònis de la marcha dau progrés, lu trincabalas venian descargar de molonàs de jaina qu’asperavan la mordanha de la serra en un gran relarguier bachassós. Aquela cort èra trafegada de tractors, de cargaires que provedissian lo mòstre ; de Clarcks levavan li gàbias de fusta e li portavan a s’issugar ; de Manitos engavaissavan lu trenta-vuèch tònas que durbian a l’internacionau lo destin dau chaine de la Haute-Marne. Tot aqueu bolum esposcava a giscles l’aiga que relonava sempre aquí, e reventolava de contúnia un chapòt endèmico. Quora lu camions l’i s’enfongavan fins a l’issart, faían venir de tombarèus de jairas ; mas lo palum l’i s’engolava e, cada doi ans, calia recomençar. Degun a jamai capit dont anava finir tota la peiramenta deversada aquí d’a mantu generacions de Sartres.
Ai en ment lo sant de Simon sus d’aquela ièra, un jorn que cubava de jainas de faure embe lo sieu entric a colissa e un decametre. Chapegavam en aqueu pautum ; m’avia prestat un parèu d’aqueli bòta de caochoc que son un arnesc necessari en lo septentrion, e que se’n tenia una filanha, de talhas diversi, en lo corredor dau Molin, per adobar li pràtigas e lu avenients esprovedits.
M’èri bessai fermat a Langres en puant – ò en calant – d’en París, dau temps qu’alestissiavam una mòstra au Musèu de l’Òme. Aüra que i pensi torna, mi pareisse finda que i èri anat per un sabta-dimènegue, estent que travalhavi en París justament. Totun, Simon m’avia entraïnat a prepaus de la mieu vida professionala. Li semblava que la mieu matana d’artista avia pron estirassat e qu’èra temps per ieu de pauvar la mandianha ; qu’èra bel e bòn de córrer lu chantiers d’escavadura e lu taliers de molatge, de gaudir lo frescor dei baumas, de si gòdre de la conversa dei sapients e dei estudiants… pagat emb una manada d’olivas e acaurat coma un esportin. Calia pensar aüra a rabalhar de pítols e estabilir la familha. Ieu que tenii lo cap dau decametre li respondii : « Sièis cinquanta… vuèch noranta… » e mi guinhavi li espatlas. Eu, marcava li chifras sus dau sieu libreton, mesurava un diametre, marcava torna, talhava un cavilhon qu’escompassava, mas sempre, venia mai picar ai sieu rasons. Madurèto ja, mas gijòla de parpalhòla, capissuenha tardieua, non èri encar prompt a botar lo pas que eu l’avia ja fach. La sieu paraula semenava pura, laissava una estampa en la mieu testa de bòsc qu’escotava ren ni degun.
Per la finir pura emb aqueu Molin Ros, nen sobra l’anciana ciutat obriera que costejava lo camin que menava a la nacionala. Èran de pichini maions bessoni de doi nivèus, emb una intrada au mitan de la faciada. Darrier, un gerp abosquit de tòscs e d’arbolets anava picar en la Marna. S’endevinava qu’aqueu tròç de tèrra èra estat partit, un orton per cada familha, dau temps que la capela dau Molin Ros radunava en una santa comunion lu mèstres e lu emplegats, lo jorn dau repaus domenecal ; aquela capela que lo poblet de la sera i tenia la sieu bandiera de procession per lu jorns de festa e ensin, participava – en pròpi – ai pompas religioï.
Ensin, man e ment de la manòbra èran creats, menats d’ai Sartres, familha de judici que cada generacion provedissia au manco un prèire e un empresaire au manteniment d’un monde langresc ben escandalhat. Un non si despaïsava dau Molin Ros ; s’i naissia, s’i batejava, s’i faía la doctrina, s’i ganhava lo pan e ensinda, anava tirant fin au soterrament !
De fach, l’omnipoténcia vèra dei Sartres estaía luenh en de là dei realitats sociali dau temps. La sieu misericòrdia non trucava li bòrnas dau sècolo e l’eternitat aparava lo Molin : Au sobran de la Còla que superava lo teniment, en riba drecha dau riu e dau beal gran, lo Camp-Sant, escondut d’un plantier de serentra, enrevirava la vida que si debanava contúnia n’avau, embe lo fiu de la Marna. Un pualhon menava drech de la valada au Planestrel Gran e s’anava perdre en lo garach, embe li regas que filavan devers li Vògias. Un pauc denant d’esbocar sus lu camps, si virava a drecha en un caminet que passava a plana e anava au cementèri.
Un portau de ferre e de flòtas de sapàs centenaris avisavan l’avenient, ralentissian lo sieu pas e clinavan la sieu tèsta. Alora, un caminava fins a la tomba dei Sartres, costejant lu barris dau Camp-Sant, li mans croquetadi en l’esquina, sus d’una terrada de garnas e de pinhas que cresinavan sota lu pens embe la graveta dau camin. Virant de caire a man seneca, quauqu banquets de calcari blanc l’aussavan en una léa blanca, d’un desenau de metre circa, bordada de muranhons de pèira picada e que s’acabava sus de la faciada cadra dau monument. L’arquitectura èra sòbria ; embe la maestat despulhida e pron clàssica d’aquelu que sabon despí longtemps manejar lo ver poder e qu’an pairat pensar au sens e a l’utilitat dei rites funeraris. De placas de bronze muradi en la pèira faían tèsta au visitor e lu noms gravats embe lu sieu milermes faían remontar de filanhas de Sartres au temps que Berta filava. Arrambats a la penta de la Còla, la prèissa e lu costats de la tomba èran aclapats e, de cada caire, simetricament, la penta doça d’una riba gasonada faía d’achès a la tràpola, ordonada en la part sobrana de l’edifici e que si durbia en levant una lausassa.
Parier coma dau temps de la vida e dei patiments, un repauvava, cadun segond la sieu condicion ; lu defonts dau Molin Ros que tralaissavan li maionetas de la ciutat, se’n puavan au retir en li tombas mesquini, agrumiceladi de cada costat de la léa, alairadi ai pens d’aquelu qu’estaían per l’eternitats mèstres e aparaires de la genòia dau luèc. Sia lo mite dau pelegan, sia l’image dei passerons de nídol, en tant, la metafora ornitológica botava en ment a la vista d’aquela solombrina maestosa, assostant lu sieu fedels, lu si tenent radunats a l’entorn d’ela per lu empedir de torna cascar en aqueu monde feroge…
De generacions d’obriers dau Molin èran soterradi biblicament en un cròs garbat en aquela tèrra que lu avia norridi. Quauqu paures Cristos tanben, qu’avian acabat aquí li sieu viroluènhas, i avian trovat sepult e dignitat. Una balandralha bassa de bòsc march, ò un reng de lausas assautadi de mofa e de feuses pichinets environavan li tombas, coma se quauque pastorèu auguesse jugat a bastir de pichini vastièras. La crotz de ferre forjat portava soventi fetz un ensenhe, cadre ò en forma de còr, esmaltit d’un blanc passit e que la pèu crebassada mostrava d’escrichs negres, mièg cancelats.
Toi aquelu, que non s’èran portat l’acupatge en paraís, costejavan omblament lo crepa-còr dei tombas de bambins ò de pichoi, encara tant numeroï n’aqueu bòn temps de progrès industriau. Aqueli pichini cantaretas m’an sempre mentat – coma una messa en abís – lu juècs grèus e ufanós dei pichoi, quora si van soterrar un passeron ò una rateta, regaunhant la pompa manha en una premonicion simplària dei afres de la mòrt. Qu a jamai ressentit la frapassion que suscitan lu sentiments de revouta, d’injustícia, davant de l’expression de tant de chacrin, reducha a’n un tant pichin espaci de trista poesia?
Lu mòrts lu mai vièlhs avian pura laissat d’aisetat ai joves ; li sieu crotz èran radunadi de costat, aponteladi ai aberges infessits d’èures que marcavan li treménias dau Camp-Sant. Finda lu Sartres dau principi s’èran levats dau semenat per s’anar jassar mai dinhament en la tomba totèmica, quora l’avian bastida ; li sieu stelas, de bèla pèira blanca, èran pi estadi dispòsti respetuosament, a l’antica, sus lu muranhons, de cada part de la lea centrala.
Li bofanhas d’ària, sublant en li brancas dei saps, semblavan de nen revirar lu pensiers dei folatons que trafegavan sempre en lo sieu, e animavan un pauc aqueuvièlh cementeri romàntico mantengut, a la sosta dei aubres, en l’entrabrun frescolin e ímol d’una mairitz. Fin finala, au sobran de la Còla, reparat pura d’au vent dau Planestrel, lu trapassats si podian sempre donar una ulhada sus lo monde qu’èra augut lo sieu, esporjut qu’èran, parier coma en glèia lu putti ajocats sus dei cornisson. Lu vius, elu, s’entornant dei sieu vísitas, pairavan far tirar en l’aut fust de larze que partissia lo cimentèri e lu camps, en li tiras dei plantiers de serentra ò lu romegàs dei desboscadas, per cobear quauqu bolets e aluchar lo cabròu qu’asperava la dubertura.
* * *
S’acapisse qu’aqueu monde fach a relòri, atesat un còp e basta, podia parèisser apagat e rassegurant ; si podia finda averar afrós e embarrat. Simon-Pèire Sartre, per cen qu’èra d’eu, avia decidit despí bèu temps de non s’encadenar a’n aquela galera. Quora s’èra pi empadronit dei guidas de l’empresa, avia afitat de tira un apartament en una comuna forastièra. Avia cridat, per cautela, que non sudureria l’idea de se’n anar femar li mauvas en la compania macabra d’antenats qu’asperavan sempre « lo seguent », en aqueu monument prepotent e mofit que mentava la bota dei Danaïdas. Preferissia conceure un repaus marinenc, embe vista sus de l’infinit, lo desconoissut, l’aventura, a Batz, en Bretanha, dont s’èra pi embarcat per Sant Pèire ; a Batz, vesin dau Croizic, embe lu sovenirs de vacança de la sieu enfantuenha.
Mas aqueu romantisme funebre non avia pura d’autra tècola que d’embrenar lo sieu monde ! A trenta quatre ans, un a d’autre d’a faire que de s’entrigar dau sieu taüt ; d’autant que l’òbra non mancava per redriçar la Serra Sartre qu’èra estada per se’n anar en dogas. Totun, es ben sus La Còla en pròpi que s’atroveriam radunats per lo sieu funeral…
La mauparada avia gaire estirassat : De prima avii fach aqueu viatge en París e d’autom, m’alestissii a l’última vísita. Maugrat qu’auguessi asperat la nòva d’aquela mòrt qu’èra, d’aquí en avant, lo darrier e solet esper dau mieu amic, èri estrech d’un magon pèuge. Sa maire m’avia sonat per mi faire una demanda pron gravoa, qu’atesava encara la mieu petòira : Prononciar l’oracion funebra de Simon-Pèire Sartre m’acapitava coma un espròva iniciatica. Donava lo sieu sens acabat a la revelacion qu’èran augudi per ieu li naissenças dei mieu enfants, i metia lu ponchs ai sentenças de la vida que començavan de s’escriure en la mieu gijòla. De fach, Tanta Chiqueta avia atacat a m’escoratar dau sieu zèlo implacable e non avii encara mentat que la mieu andana destartavelada semenava, despí, de margaridetas en li sieu nharas. La ceremònia que m’asperava mi donava lo mieu promier ròtle vèro en lu rites que domestegan la mòrt – e fogueron, i a cent mila ans d’aquò, lo sinhau dau promier pensier pron uman.
En tant, non avii tot aquela filosofìa en ment, entortolhat en aquesta fachenda emprevista d’oracion, que lu còdes me’n èran desconoissuts e qu’èri per ne’n descurbir la patètica absurditats – ò de ne’n traire la coeréncia d’una destinada – segond cen que un i vorrà trovar. Mi vèï mai, en aqueu tren de nuèch que i èri ja acostumat e que lo devii pilhar, pus tardi, encara manti fes. Mi veï mai, escribachant sus d’un bloc-nòtas, mau assetat sus d’una cocheta, provant d’arrecampar doï ideas, cascalhat – ò breçolat – dai repombs dau vagon que donavan a la mieu tèsta d’escandalhadas lancinanti, coma en una litania, coma siguessi vengut, un momenton, shamàn en cerca dei paraulas que porrian faire d’a ligame embe l’autre monde.
Aicí-bas pura, Loïsa, sa maire de Simon, m’asperava a l’estacion, ai sièis oras e subla de l’orari oficiau dau Nissa-Reims. Degun de nautres doi avia gaire durmit. Fogueriam solevats de laissar la solituda de la nuèch e lo garbin fosquinós d’aqueu matin d’octobre per si regalar quauqui paraulas rasseguranti, ben escaufats en la bòfa de la veitura que s’entornava au Molin Ros. En la coïna de la Maion Nova, lo cafè tubava, li rostidas odoravan en lo batre dau relòri. Lo bòn merendon radobet lu rets de la vida, escasseguet la babaròta, e l’angois d’aquela charaïssa que m’asperava s’apaguet un pauc. Finda Loïsa semblava de si repilhar l’alen, en compania d’un que non si repepilhava li solormas de la familha, que non s’embarava en lu sieu silencis, lu sieu bandits ; un forastier au Molin Ros e pura amic pròch de Simon, un òme jovenet, fresc e credenciós encara.
Aprofiteriam d’aqueumatin pais e dei moments de quietuda que nen sobravan encara, per anar vèire Simon qu’asperava, solet en la capela de l’Ostal Vièlh. Era arrelongat en lo sieu taüt dubèrt e, coma si ditz, semblava de si faire un penec. Si veía sus la sieu cara que Tanta Chiqueta l’avia desliurat dau patiment. La rengracièri d’autant que ieu, avii refudat de l’ajudar. Avia mes, per lo viatge, lo pichin mandiu gropat au còl, qu’aquò èra la siéu costuma. Tanben, aqueu teissut jaune aplatava un pauc la poncha dau gòi qu’ensinda non semblava tant de la si pilhar embe loBòn Dieu ; en una capela, marcava mai ben. Per lo rèsta, èra viestit coma per lo cada jorn, sensa landa. Simon non si pilhava tant tot aquò sus lo sèri, seria indulgent embe la mieu oracion…
A pauc a pauc arribèron la familha procha, la gent de l’usina, de monde pi que lo conoissii ren. Loïsa faía tèsta en tot e en toi, saludava, remarciava, organizava embe lo curat, embe lipompas funèbri. Tenia bota : Aquelu que venian assistre a la fin dei Sartres, que venian croassear sobre lo darrier cadabre, aquelu qu’avian traücat embe lo destin per menar l’assedi dau Molin Ros, aquelu qu’asperavan que si cascalhesse la toalha per si pitar li brigas dau past, tot aquela genòia non s’esperlequeria dei làgrimas de la forastiera que s’atrovava, d’aquí en avant, mestressa d’una nau que s’anava esprefondant en lu gorgs amarents.
Quora toquet a ieu – vedeta americana de la ceremònia – diguèri lo mieu compliment embe gaube e, lo capissi aüra, una bèla mótria. Mai d’un, en aquela acampada, deuguet està mòc d’audir aqueu jove pelandron, trach de qu saup dont, engimbrat encara d’un accent plasent, segur, mas un pauc desconvenient en aqueli penoï circontàncias, d’audir doncas un baudo que degun escasi lo conoissia, autorizat d’a la familha a si pilhar, aquí, la paraula, au nom dei Sartres. Deuguèron estar autre que necs, aquelu bòi langrescs, de deure escotar, sensa manco una bòba, aqueu mièg manacho li cuntar d’estrabòts d’arberg en montanha, de filosofìa, de Saarà, d’Amor… e sabi manco pus ieu de cen que li ai ben poscut charrar, que tant, lu mieu papeirons, es Loïsa que lu si ten ! D’unu pura, un pauc mai lecs, i auràn pi conoissut quauqu’estranhessas en lo gust barròco de Simon. Lu Sartres, elu, lo conoissian l’antifòni. Loïsa, en fin, mi confesset mai tardi que non si posquet empedir de laissar un pauc destelhar lo luquet, quora m’audet parlar d’aquelu passerons que lo sieu enfant mirava, escochava a la caça embe tant de fòga, emb aqueu gaug dau predator, líbero, potent, vagant sus lo sieu territòri.
Totun, a la fin de la messa, cadun si surbet embe solàs una golada de l’ària fresca dau defòra, tant lu gavais èran acaurats d’a l’esmoguda d’aquela ceremònia còntra natura. M’enavisi que, dau temp que lu beca-mòrt li avitavan lo cubercèl, lo curat e ieu charreriam un momenet dau paure Simon-Pèire. L’ataüt foguet pi cargat, sota l’agach d’una fòga muta, en lo forgon qu’asperava davant de l’ostal. Lo curat s’embarquet en la veitura qu’escompasset lo pònt dau beal gran e estentet en lo pualhon, fin au sobran de la Còla. Nautres, s’assegueriam a pen, chin-chirin, e la paraula nen revenguet embe lu moviments dau còrs e l’ambient campestre.
Lo prèire n’asperava damont, au mitan de la léa, maestós en la sieu caïbla brodada que flotejava en lo vent embe li brancassas dei sapes. Simon eu, èra ja au sobran de la tomba, pauvat sus de doi cavalets ; lu baudos dau viestit gris avian ja tot alestit. L’acampada si radunet, a pichin gropa, cadun lo sieu ritmo. Qu si rebotonava lo mantèu, qu s’alugava dei man lu chivús emberits, e cadun si pilhet plaça en mièg-ròdol a l’entorn dau monument. Lu pròches montèron sus li ribas laterali ; la familha e ieu tot ençamont, de cada costat de la truna espalancada, que la lausa de seradura èra trincada de caire. Lu pastrolhs s’amurcèron. Alora, lo capelan benedisset l’ataüt e diguet li darrieri preguieras, acompanhats dau còro dei arbolàs que cantavan en l’aura. N’eravam arribats en aqueu moment pron penós que la mòrt s’anava engolar Simon dau bòn e per totjorn. Li maisselas s’atesèron, quauqui làgrimas retengudi botèron sota d’uèlh tròp borf. Degun auguet pus vergonha de nasear, de si tapar la boca de la man, quora lu quatre bàudos agantèron li manèlhas dau taüt e lo presentèron sus la dubertura de la tràpola.
Es aquí qu’acapitet la promiera bala ; lo fach foguet reconoissut sus lo còp coma l’última menchonada de Simon-Pèire lo trufarèu : lo folop volia pas intrar. Simon èra tròp GRAN !
Faguèron fòrça per lo far passar, mas se’n valèron ren. Lu beca-mòrts tenguèron pi conseu sota gorjon, clinat devers lo sieu cap que, de gaire colorit qu’èra de natura, venia blanc coma una bugada. Dau temps que pauvavan torna l’ataüt sus lu cavalet, un tra elu se’n anet querre quauqua ren en lo sieu forgon. Cadun èra nec, sec, incrèdulo. Loïsa, drecha coma una estàtua, semblava d’èstre luènh, autron. Aqueu que la s’èra esbinhada revenguet a rabaton emb un sorac e entraïnet de talhar – testa pen – li moluras que quinhavan. Lo baudo fustejava de còr e, apontelat dau ginolh còntra la caissa, si tirava un det de lenga. Si podia ben qu’aquel ambient d’atelier de mesteiran siguesse la toca subrerealista que Simon li agradava de ne’n picotar la sieu vida. Per la majorança de l’acampada pura, marcava mau e s’audet bisbilhar tant que lu becalins non auguèron entrainat la sieu segonda pròva.
La fustaria escorchada, la chorma d’arleris tornet pi a la siéu tècola, arnescada de còrdas e d’aises divers, embe l’abriva dei travalhadors que la si conoisson. I mancava gaire… mas l’ataüt estaguet quinhat en la dubertura, sensa voler pus intrar e manco sortir. Un, que faía tant de s’encaïnar, comencet a o si pilhar a cauç per lo faire calar en lo pertús. Nautres, eravam toi petrificats, encantats, partits tra l’envuèia e l’impoténcia d’amolar una bòna patèla a’n aqueu despiechós, tra l’envuèia d’una gròssa petanha de rire e aquela d’una fora de làgrimas.
– Non vòu !
Lo bram de la maire a interrot lu fachs de l’autre sacrilègo. La tension s’es amolada. I siam quauqu’uns a poder bofar, a laissar espelir un pichin soguinhe en una agachaüra, un batre d’uèlh. Mas que faire ? Es torna mai Loïsa que fa tèsta a la mauparada, que mestreja, que baileja lu òmes e la ceremònia, emb aquela ràbia, aquela testardaria a non si laissar reversar d’ai simecs que la man seneca dau destin li manda a barcelada despí qu’es intrada en la parentèla dei Sartres.
– Non vòu ! qu’a cridat. Simon non vòu.
E ieu liègi en lo sieu pensier. Aquí, just darrier li tombas mesquini, i es un pòst quiet, sota lu sapes. Simon jasserà aquí, en la tèrra maire, tra lu boscatiers, lu aubres, li raïç, l’aiga, la ròca, la terrada, l’erba fòla… solet e en compania, tot en un còp. Loïsa nen raduna sus la brua de la tràpola negra e muta ; si concertam en familha. Lu obriers fan lo ròdol a l’entorn de nautres, a distança respetuosa, sempre engimbrats dei sieu outís sobrerealistes ; asperan la seguida, sempre lests. N’avau, l’assisténcia si manten en la dignitat, comenta la fachenda a sota votz e aspera, finda ela, la seguida.
– Volia pas rejónher la pinhata e si laissar ficar lo cubercèl sobre ! que nen ditz Madalena sa sòrre de Simon.
De fach, non sabèm se nen juega la sieu darrièra menchonada ò s’es l’ùltima revòuta còntra una destinada escricha, un darrier repomb de libertat per escapar a la tradicion, au pés e a l’estacament dei raïç. Bessai que si peta dau rire en lo sieu taüt. Magara que s’estenhe de la ràbia de s’atrovar costrech de repicar ai vièlhi bilas e chicotadas de familha…Tornarmai e per totjorn, s’arrelongar embe tot aquelu mòrts, a s’audir la messa dei abats Sartre ò lu Kindertotenlieder ; ò la bota dau P. 38 de Joan-Batista acaurat sus la darrièra sillaba de cor-pa-bi-li-tat. Mas, fin finala, fòrsi que se’n bate coma un niçard, que siam nautres que contuniam a bolear de vanitats de vius.
En tant, nautres, aviavam fach cen qu’aviavam d’a faire. La decision èra pilhada, Simon seria soterrat fòra dau monument, dintre tèrra, tra lu sapes. Era pas estat possible de respectar lo sieu desidèri de cimentèri marinenc en Bretanha, qu’éra cómol coma un oire. En là, anavan ren levar un dau país per i ficar un borguinhon en plaça ! Emb aquò, coma se i siguesse estat un baròli embe lu antenats, lo darrier mestre de la serra, après d’una darriera messa en la capela, estaria pi sus la Còla dau Molin Ros. I estaria, mas en defòra dau nídol, de « la pinhata ». I estaria. A la sieu mòda.
Mòc e mut despí dau sieu promier revèrs, lu beca-mòrt ti plantan sus lo còp un brandi dau Diaul. S’entornan embe de pics, de palas, bracejan, fan calar la jaca, si revertegan li mànegas. Embe la jaca, an laissat de caire lo sieu morre de tòla costumier. An ja marcat lo vasiu en la pichina esclarcida dei sapes. Estarà un pauc en biscòrn, au contrari dei autri tombas que son alugadi d’escaire a rapòrt a la lea…Siam patis coma aquò. Lu òmes son a l’òbra, en lo terrum, lo sudor, la vida e si vetz qu’aquò li conven ; a ieu tanben.
Nautres, d’ençamont avèm pura vist un maron d’inquietuda mòure la fòga. De boca badan, d’agachs si jonhon, interrogators, si bisbilhan de sentenças desasseguradi. Cadun si vorria encaminar, s’entornar ai sieu afaires : Non si pòu passar la jornada a asperar qu’auguesson garbat lo cròs ! Es tornarmai la maire que s’entriga de bailejar, en un reflús ordonat e digne, cen qu’auria poscut virar en un viliac desbandament. Tòca li mans, recèup li condolianças e li excusas, rassegura aquelu qu’escrupulejan.
Estau embe sa sòrre e son fraire de Simon que n’aprofichan per s’estar un pauc a despart. La paraula n’es revenguda. Charram e provam una promièra interpretacion de la fachenda, si tenent d’a ment lo cavar dau cròs. Avèm laissat lo mòrt quiet, n’amont, tra li tombas desconoissudi, en lo vent que gassilha li flors dei massons e dei coronas, tralaissats en peça-còl « en asperant lu òrdres ». Li faissas de carta pista que pòrtan d’epitafas dai bèli letras, si breçòlan coma lu filactèros dei frescas dei capelas dau País niçard. Tra tot aquò, lo taüt es un pauc gambaèl, pauvat sus dei sieu cavalets que lambròchan, vesins de « la pinhata » qu’es estada dubèrta, coma un bastion abandonat ; cada en tant, lu locataris si pòdon ben gaudre d’un pauc d’esclarcitat e d’ària fresca. Aqueu tablèu sembla tot au còp credenciós, campestre, embe de scenetas esparpalhadi d’aquí d’alhà, mas tanben una idea sobrenaturau. Dirian que siam toi alugats, mòrts e vius, en una fresca dau Canavèsio e que lu messatgiers de l’autre monde nen venon espanear lo bèri dei siéu alas… Rampinats dai sieu arpas d’aigla a l’òrle de la tràpola, de Diauls, negres coma de ratapinhatas e si guinhassant d’una bruta contentessa, brandolhan li ànimas damnadi a l’aste dei sieu forcas. Au dessobre, tamisan lu Anges d’a la valadura esplandida. Arrecampan en lu sieu braç espalancats li ànimas dei justs que s’espòrjon coma de bambins devers sa maire…
Aüra la fòga s’es escolada dau camp Sant devers avau de la Còla, en la valada. Embe nautres son estadi quauqui personas quisti. Lo vent s’es torna empadronit dei brancas dei sapàs. Non s’aude pus qu’eu, e lo tint dei pics sus la ròca… Aurai pas augut lo temps de mi pantaiar gaire. De fach, quora an augut garbat doi parms de tèrra, lu beca-mòrt an picat sus lo dur ! Aüra son apontelats d’una man sus lo mànegue e, de l’autra, si gratan lo suc, impotents. E cau torna discutre. Non podèm revenir en arrier, mai cambiar lo pòst de la tomba dau paure Simon ; caurà ben que si destrigon per faire lo cròs aquí. Lo cap becalin nen jura que si, just que li laissem lo temps de radunar lo material necessari. Segur qu’es ren embe pics e palas que porràn rompre la veta de pèira jaunastra qu’an messa au jorn e qu’esflora sota la Còla. En tant, caurà ben anar manjar. Tot aqueu trebolèri n’avia ren levat l’apetit, au contrari. Se’n caleriam a pen fins au Molin e laisseriam Simon sus lu sieu cavalets embe lo vent, lu filactèros e lu becalins afachendats per li far companha.
Quora s’entorneriam sus la Còla, lu terrassiers avian recampat una pichina pala mecànica. Zonzoneava coma una mosca tra lu sapes e lo sieu gran braç de manchin esparava sus la ròca en un brandi rutat e desgaubiat. La ròca maire si laissava catigolar, grafinhar, mas lo pertús non si cavava de mai ! Esto còp, i èra pus degun, fòra lu obriers, lo cap becalin e nautres que començavam a si socitar. Simon podia ben asperar encara un momenton sensa si pilhar un refreiament ; mas, au mès d’octobre la nuèch se’n cala bòna ora e, a’n aqueu moment, un podia ja dubitar que siguesse sepelit au sera d’aquela jornada estrambalada. Avèm doncas repilhat la parlaïssa tècnica. Per rompre la ròca, i anava un compressor e un martèu-picaire ; mas vai fitar de material un dissabta en aquesta ora, tu, se siás bòn ! Son pura revenguts, qu’èra ja tardi, embe cen qu’avian poscut trovar e si son avantats a l’òbra embe la volontat de la finir emb una fachenda qu’avia ja pron estirassat.
Totun, sia lo sòrt, sia Simon – menchonier ò embilat – èra escrich qu’aqueu jorn si soterreria minga Sartre. Ò que lo compressors èra tròp deble, ò que lo martèu èra tròp potent, tant èran pas fachs per èstre acoblats. Emb aquò, la poncha d’acier rebombava sus la ròca coma una pelòta e cascava li nièras dau malurós que provava de la mestrejar.
Avètz capit que, quora si son pi arrecampats embe la bòna cobla, èra ja nuech despí d’una temporanha. Nautres, aviavam augut temps a madurar l’idea de sepelir Mestre Simon-Pèire Sartre pus tardi. N’asseguret lo cap que tot seria lest per l’endeman de matin, que caverian tota la nuèch se calia. Dau rèsta lo s’èran ja tot carculat e avian instalat una bateria de projectors. Lo cimentèri èra aüra candeirat coma lo presèpi per la nuèch de Calenas e de rais de lume jugavan en li brancas dei sapes coma de guirlandas. Estranhament, lo remon dau grope electrogèno, lu juècs d’ombra e de lume tra li crotz e li tombas, lo trafic dei obriers, dei veïculos e dau material, mentavan mai l’ambient d’un festin de vilatge o d’una fèsta forana que li marridi guinhadas e li messas en scèna escalabroï d’Halloween.
Eravam doncas ben convints que la ceremònia si debaneria ren denant de l’endeman de matin. En tant, anavam pas laissar lo defont a la serena coma ‘na lebre, ramenc, en aqueu taüt escufinhós, fustejat d’a la sera damont-davau. Calia que se’n tornesse dignament durmir un darrier còp en maion e si faguesse encar un torn dau teniment. Mas lo forgon dei mòrts avia levat banc en lo presdisnar, estent que lo viatge qu’avia menat Simon sus la Còla anava d’èstre l’ùltimo. L’infirmièra qu’avia curat Simon, e qu’èra revenguda ai nòvas après de la sieu jornada de travalh, nen proponet aimablament l’ajuda de la sieu veitura mièg-break. Manobreriam doncas aqueu forgon mortuari de sòrt, baisseriam l’asseti de darrier, espalanqueriam lo còfre e aneriam en delegacion sostraire lo Mèstre a la sieu conversa embe lu Anges, lu filactèros e lu antenats que lo sieu bastion èra totjorn dubèrt a la curiositat dei nuècholas. Lo taüt s’atrovet doncas cargat en la veitura, coma si fa embe lo frigò quora un fa Sant Miquèu : la tèsta èra dintre, un pauc mai bassa que lu pens qu’escompassavan au defòra, enaussat sus dau suèlh dau cofre. Simon se’n tornet doncas en maion, breçolat d’ai repompèus de la lea, lu pens au fresc, embe Jeanine qu’auria pilhat cura d’eu fins a l’ora darrièra – e en de là. S’assegueriam en l’escur fins ai lumes debles dau Molin Ros, regarjant lu fàros a la valada que durbian lo camin, coma un caça-nèu, en la negrura de la nuèch. Èra temps de s’entornar ; lo tarabast dau compressor, lo tir de mitralhusa dau martèu escaceguèron embe bruscor angelons, Diauls e nuècholas. L’encant s’espeçava.
Un còp toi radunats n’avau, s’entrigueriam d’estremar lo taüt per la nuèch. Lo podiavam pas decentament ficar en l’intrada ò lo salon de la Maion Nòva, tra lu vai e ven e lu oudors de coïna. Venia mai a ben de lo ramengar en lo sieu burèu de Simon, au plan terren de l’ostalàs. Per aquò, i èra que d’a parcar la veitura davant de la fenestra e de lo far passar d’a drech, que tant seria mai aisat que d’anar rutar còntra lu postats e li pòrtas dei corredors. Augueriam pas vergonha de si faire d’a rire quora s’atroveriam rampinats ai manèlhas de la caissa, doi de fòra, doi de dintre a si regajar, embe lo taüt qu’escandalhava entra nautres, pauvat sus de l’abaïn. Après d’aver escartat lu entrics e lu papeirons que l’embarassavan, alugueriam pi Simon sus lo sieu burèu. Lo laisseriam pauvar aquí per la nuèch, en lo sieu monde costumier, tra lu sieu afaires de travalh, lu sieu libres, lu sieu arnescs de caça. D’aquì en avant, lo Molin Vièlh èra l’ostal dei mòrts.
Es ensin qu’es en la Maion Nòva que s’entauleriam a l’entorn d’un bòn platàs fumejant de lentilhas a la ventresca e au garet de pòrc. En cròta, anèri picar en lo Santenay que cada an, la familha ne’n crompava una bota e la s’embotilhava. Aviavam fam, set, besonh de provar de sensacions físiqui, de si rire, de charrar fòrt, d’èstre radunats e pròch pròch, de s’arrapar a la vida, de si faire un d’aquelu pasts coma lu aimava eu.
Sus d’aqueu ponch, siam pas d’accòrdi embe Loïsa que non s’enavisa d’aqueu menú e declara que non auria jamai poscut alestir una tau manjuca lo sera dau funeral. Li lentilhas a la ventresca e au garet de pòrc son pura vengudi lo mieu past de benvenguda quora mi rendi a Langre… Sigue coma sigue, siáu ieu qu’escrivi lo racònte e i meti ben cen que mi ven bèla d’escriure !
Totun, lo past acabat, siam sortits s’enresilhar un pauc dei òbras de la Còla. Lo cròs anava calant, seria lest per l’endeman de matin. Emb aquò, si siam corcats anequelits, tremolant de l’esmoguda ò dau rire, cascalhats de sangluts, guinhonats d’aquela regaunhada dau destin.
De matin, si raduneriam per lo cafè ; eravam apaisats. Lo forgon dei pompas funèbri asperava davant de la fenestra dau burèu ; Simon-Pèire Sartre se’n tornet pi sus la siéu Còla, coma si dèu. N’amont, tot èra lest, pais, quiet, clarejat d’un pichin rai de solèu e Simon se’n calet en lo cròs coma un bambin en lo brèç. Eravam set. Ana-Sofìa, la pichina nèça, qu’avia cinc ans, Magalí, Vladimir, Madalena, Loïsa, Manuèu de la serra e ieu. L’enfantona, la promièra, mandet un massolin de flors sus lo taüt e nautres pi fagueriam parier. En s’entornant, la pichona diguet :
– Non aurà lu sieu regals per Calenas ?
Miquèu de Carabatta
Nissa, decembre dau doi mila très.
Nòtas Barròco Funeral
1 Sant : metonimia per image. Ven de « image sant ».
2 Trach d’un ex voto a Ribassièra.
3 Si conoisse lo chapacan. L’i es tanben un autre mestier que l’Estat entraten, per agantar lu chocatons per carrièra e s’entrigar de la repression de l’embriaguènha pública. Li dion lu chapachocs.
4 Si porria dire « bambòcha au bric ».
5 A Ribassièra, aigràs si ditz dei pichoi, quora se’n sòrton de l’enfantuènha, que son pas encar lèsts a maridar, mas que si vetz que viran ja « a l’aigre » !
6 Es ensin que Barba Angelin li diïa a’n aquela raça d’aranhas que corron sus de l’aiga.
7 Si ditz tanben lu teules.
8 Mi ven en ment que, en defòra de Ribassièra, ai jamai audit aquela paraula. Lo larze es aquò que, autron, li dion lo mele. Un còp, per cas, ai endevinat sus de larch, en lo diccionari d’englés. Per ieu, dèu venir dau latin larix.
9 Aquí, l’i siam mai. Cau dire, en la seguida de l’afaire dau larze, qu’a Ribassièra, avèm de Boros, volent a dire de paraulas estranhi, que finda nautres ne’n devinam l’estranhessa e, que sabèm ni cen que fan ni de dont venon. Lo boro pòu èstre tanben una paraula antica, picada en dessús e que se’n pua d’un recanton de memòria a l’asard d’una conversa. Si ditz encara d’un que parla mau, qu’estropeja lo nòstre parlar : « Tu, aborisses lo ribassenc ! ». Emb aquò, la lenga es ren besonh de la saupre escriure per que boulegue de pensiers ò que fague dire de paraulas…
10 Per ben dire, cobear, n’i a que li dion culhir.
LES EXTRAVAGANTES FUNERAILLES DU REGRETTE SIMON-PIERRE SARTRE
« Amics favolós, dont siètz toi esto sera ? »
Janluc Sauvaigo ; Li Brigas dau past ; C.D. Banhanàs
J’ai à l’esprit le coup de téléphone qui m’a annoncé sa mort ; mais sa maladie, je l’ai apprise je ne sais plus comment, je ne sais plus par qui, à l’époque où j’étais mouleur en archéologie à Tautavel, capitale mondiale de la préhistoire et du travail gratis. Je me souviens toutefois que le week-end suivant, au lieu de retourner du bon côté du Var, j’ai pris l’avion à Perpignan et suis monté à Paris.
Paris… ce qui aurait dû être un souci pour moi, est passé comme une lettre à la poste : aéroport, panneaux d’information auxquels on ne comprend rien, foule ; grands hangars venteux des stations de bus ; métro, dont la gueule à l’odeur molle vous saute à la figure comme si on vous jetait un poulpe noir au visage … de tout cela je n’ai rien vu ; pas même senti.
Là-haut, ils lui avaient ouvert la nuque pour en extraire une tumeur et lui avaient enlevé la moitié d’un poumon. Il n’avait rien dit à personne ; il s’était terré, caché comme un sanglier blessé, dans cette ville où d’habitude, il n’allait que pour retrouver sa compagne, faire l’Amour et dîner aux chandelles, de vin vieux et de plats délicats.
Quoi qu’il en soit, un peu « d’air frais » lui fit du bien ; nous fûmes heureux de nous retrouver. Hasard ou nécessité, son amie Claire partait quelques jours alors que j’arrivais. Nous restâmes tous deux.
Le voir, l’entendre, relâcha un peu l’étau bien serré qui m’avait comprimé le gosier depuis que j’avais appris la mauvaise nouvelle. Toutefois, la maladie avait déjà bien abîmé cette carcasse d’homme et la chimio y contribuait. Il semblait encore plus grand d’avoir autant maigri. L’armature de son corps, faite d’os longs et forts, ses grands bras aux mains épanouies comme de larges fleurs, sa tête ridée, vieillie, dépourvue de sa chevelure ébouriffée, cette démarche branlante et mal assurée qui est le fait, autant d’une continuelle nausée de médicaments que de la faiblesse subite du corps et de l’âme, tout cela lui donnait l’allure d’un grand oiseau tragique.
Entre nous, on ne faisait pas d’histoires. Nous avions déjà roulé une vieille amitié et abandonné en chemin les aigreurs et les trahisons qui ne manquent pas d’éprouver de vieux amis. De conversation en controverse, de discussion en dispute, de vin en eau de vie, de confidence en éclat de rire, nous avions vécu ensemble les joies des voyages, de la forêt, de la chasse, de l’air vif et du soleil. On en avait vu d’autres ; ce cancer était une affaire de plus.
Ainsi, c’est à moi qu’il demanda de lui raser la tête. Il renonça aux quelques touffes revêches qui subsistaient de sa chevelure romantique, faussement négligée, qu’il coiffait de ses mains, avec un mouvement de la tête et des bras qui fascinait les filles. J’ai œuvré ; il me semblait être le prêtre d’une cérémonie antique. Le rasoir tranchait dans l’écume blanche, évitait l’endroit de la trépanation, comme un navire le récif, comme s’il s’était agi de la fontanelle d’un bébé.
Je ne sais plus combien de temps je suis resté avec lui cette fois-là. Peut-être deux jours. Il put enfin se laisser aller à me parler de la maladie, des médecins, de l’hôpital, de sa souffrance. Nous parlâmes de sa vie avec Claire, de la Bretagne qu’il aimait tant et de l’époque où il y avait été pêcheur, de Saint Pierre et Miquelon, de l’Algérie où il avait travaillé et de ma visite à Annaba ; enfin, de la vie ! Cela nous aida tous deux à oublier un moment l’ombre de la Camarde qui hantait les silences et les battements d’yeux ; nous avions besoin d’espoir. Nous nous sommes convaincus qu’en définitive, l’affaire s’arrangerait, qu’il fallait croire à la guérison, que les rechutes qui ne manqueraient pas de survenir, seraient les degrés à gravir pour la reconquête de la vie.
Quelques semaines plus tard, il décida d’aller – mourir – chez lui. Il retourna boucler la boucle, en son berceau, au commencement, dans cet Amour tempétueux et violent, fait d’espérance folle et de dégoût, de haine et de tendresse : il joignit les angoisses de sa solitude à celles de sa mère.
Mon fils aîné se souvient encore de l’image trouble d’un homme, immense, à la tête rasée, vêtu d’une grande chemise blanche – et qui s’efforça en vain de rester attablé avec nous jusqu’à la fin du repas de midi : Simon avait vu une dernière fois ma famille. Il ne put, comme nous en étions convenus, être le parrain de mon fils cadet.
Je le revis vivant encore une fois, alors qu’il ne quittait plus l’hôpital. La maison familiale, l’appartement de son amie, le monde, la vie, étaient déjà des souvenirs lointains. Il était seul dans une chambre, les bras ouverts dans un lit blanc, comme cloué aux coussins, les yeux creusés par la douleur, la chair consumée jusqu’à l’os par la souffrance, les mouvements lents et pénibles, la voix éteinte, retenue dans sa pomme d’Adam aiguë comme une flèche et qui semblait mettre le ciel en joue. L’allure du corps de mon alter ego était déjà celle de Jésus au pied de la croix.
Nous essayâmes de parler de nouveau. Je lui donnai des nouvelles de ma famille, je lui parlai de la chasse qui venait d’ouvrir, de la grange à Ribassière où on s’envoyait ses bouteilles de marc de Bourgogne. J’essayai d’aborder quelques projets, mais il me semblait voir ma fausseté se refléter dans sa pupille dilatée. Il me dit comment sa mère venait le matin et l’après-midi l’aider à tout. Elle lui essuyait le visage avec un mouchoir, lui tenait la main, ils parlaient pour tuer le silence ; peut-être pleuraient-ils… Simon n’avait plus le courage de refuser de redevenir un petit enfant. Il me posa encore quelques questions et, après un silence :
– Apporte-moi un 6-35, que j’en finisse !
Je me lançai dans une réponse improvisée, alors qu’un frisson me glaçait le corps. Bien sûr, c’était impossible. Je ne pouvais pas faire ça ; il ne pouvait pas me le demander ! De toute façon, je n’avais pas de 6-35 à la maison et même si j’en avais eu, je n’aurais pas pu être complice de…
– Salaud ! répondit-il.
Je sortis de l’hôpital à la tombée de la nuit, épuisé, écœuré, la bouche sèche comme du bois. Je ne sentais plus mes jambes, mon estomac se nouait ; ma lâcheté me dégoûtait. La honte de le laisser ainsi, seul dans ce désespoir, avec le désir de cette mort qui le faisait attendre, qui lui glissait entre les mains comme les truites que nous attrapions dans les ruisseaux de Ribassière, toute cette honte se mêlait à la rage de l’impuissance ; et l’injustice de sa réponse me cloua l’âme au pilori de la trahison.
Il mourut dans les bras de sa mère, au soir du quinze octobre quatre-vingt-onze et lorsque j’y repense, me vient à l’esprit l’image de la pietà.
* * *
Mais quelques années plus tôt, chez lui justement, quand son père était mort, il avait repris la scierie des Sartre, ses ancêtres. Cela n’avait pas été une décision facile. Il fallait remiser la chemise légère de la liberté et de la jeunesse insouciante pour se couvrir du manteau du devoir, de la tradition familiale, de la « réalité ». Il fallait de nouveau jeter l’ancre dans ce pays froid, nuageux, enveloppé de brume, détrempé d’une pluie sempiternelle, et qu’il avait fui depuis longtemps pour se réchauffer le corps et le cœur aux lumières de Notre Mer et du Sahara.
Il avait fallu se colleter avec « l’image du père », enfiler ses bottes, se vautrer dans son fauteuil, taper dans sa cave, s’emparer de sa place et retourner devant-derrière le portrait du maréchal* pendu à la cloison du bureau ; il avait fallu faire, être, rester, jusqu’à ce que se taise l’écho de la détonation qui avait tué le vieux Jean-Baptiste, son père.
De philosophe, Simon devint bûcheron. Mais cela n’est une affaire que pour ceux qui connaissent la vie à moitié… Il se rendit donc patron du Moulin Rouge, propriété des Sartre depuis des siècles. Sans doute ne pouvait-il en être autrement, une fois jeunesse passée…
Ce Moulin Rouge était une grande bâtisse du XVIIème qui enjambait d’une voûte la rivière qui coulait là-haut : La Marne. Il y avait toutefois bien longtemps qu’on n’y moulait plus de grain et qu’il servait de « Château des Sartre ». Au dessus de la voûte, au premier étage, dormait une chapelle pouvant accueillir une bonne centaine de personnes, avec orgue, bannières, statues et, dans la sacristie, une armoire remplie de reliques de Saints de la terre entière. De chaque côté de la voûte du moulin et de la chapelle, sur trois niveaux, des enfilades de couloirs, d’escaliers, de pièces, de chambres, de recoins, abritaient toujours le fourbi de quatre cents ans d’ancêtres. A l’entrée, le chapeau encore pendu et le bâton de l’arrière grand-père donnaient le ton. On s’avançait ensuite dans le château de la Belle au bois dormant.
On y trouvait l’armoire d’un alchimiste, remplie de pots de poudres de toutes les couleurs, les manuscrits des compositions de maints ecclésiastiques – les abbés Sartre – humanistes et musiciens qui avaient fait la gloire et la puissance de la famille, des tombereaux de livres et de parchemins mités, une quantité de pendules hors d’usage qui avaient fini depuis longtemps de sonner les heures d’une époque oubliée, la vaisselle, les couverts, le linge de vingt ménages, toutes sortes de meubles en désordre, des vieilleries en veux-tu en voilà, tout un attirail abandonné, des crucifix, des images pieuses, des gravures, des tableaux, des instruments de musique démantibulés, des coffres remplis de mémoire et fermés par l’oubli ; jusqu’au klakson et aux lanternes de cuivre d’un taxi de La Marne, transformé plus tard en camion et dont le châssis finissait la guerre de quatorze à l’abri aéré d’un hangar de la scierie.
Au dessus, la charpente du toit d’ardoises ressemblait à l’arche de Noé, échouée dans les terres et retournée comme un éteignoir sur un monde consumé et abandonné aux esprits follets et aux toiles d’araignées. En haut on aurait cru être dans une église, tant le pas résonnait sur le sol de planches grossières, comme sur un tambour. Autant les étages inférieurs étaient remplis comme des outres, autant cette grande barrique de toiture était monacalement vide. Il n’y avait qu’une table de billard étrangement perdue là et, bien sûr, souffle des « âmes du purgatoire », le soufflet crevé des orgues de la chapelle…
Seule une partie du bâtiment resta dans le monde des vivants, quand la famille délaissa peu à peu le Vieux Moulin, à la fin du XIXème, pour s’établir dans la Maison Neuve qu’elle avait fait bâtir juste devant, de l’autre côté de l’allée : en fait, par commodité, le bureau du patron resta dans la Maison Vieille, tanière écrasée sous le rocher fossile de la bâtisse, protégée par la pénombre sacrée et muette de la chapelle, à côté du sang de ce moulin qui coulait toujours, sous la voûte toute proche qui résonnait d’un roulement de gouffre.
Là, on était plus à l’aise pour aller et venir de la scierie, patauger dans la boue de la cour, dans la graisse des engrenages, des axes, des manivelles, pour retourner à l’abri sans faire de manière, après les marches en forêt avec les bûcherons, les gardes forestiers ou les vendeurs de coupes de bois. On pouvait y faire venir simplement et sans crainte de salir, les portefaix, muletiers, charretiers, conducteurs, mécaniciens, manœuvres, ouvriers, artisans, tous un peu timides, le béret à la main. Ils y prenaient leurs instructions, ou une bonne engueulade « en famille » et, en définitive, repartaient avec une tape sur l’épaule pour leur apprendre à avaler amer et à cracher doux. On pouvait aussi y causer, l’âme en paix, avec tout le monde, déboucher une bouteille aussi bien avec les amis ou les clients qu’avec les cognes ou les huiles de la circonscription.
C’était un antre d’hommes, bien protégé de la curiosité et des remontrances des femmes – ce qui était le monde propre et policé de la Maison Neuve. C’est donc de cette retraite que l’on donnait le départ pour les parties de chasse, les repas à l’auberge ou les virées au bordel. C’est dans cette enfilade de trois pièces basses que bien des générations d’adolescents espérèrent être admis et qu’ils apprirent leur art de vivre à la Sartre.
La Maison Neuve d’en face fleurait bon le second Empire finissant, ou le début de la troisième – République : un cube de trois niveaux dans lequel on entrait en montant quatre marches de marbre blanc se terminant par un palier en échiquier ; on pouvait y recevoir le monde en le regardant de dessus. Une toiture d’ardoises noires, mansardée, chapeautait le tout. La bâtisse était posée sur une sorte de méandre : le bout de jardin étroit qui l’entourait donnait dans l’eau sur trois côtés.
Il y avait donc La Marne qui filait sous la voûte du Vieux Moulin, mais aussi un canal d’arrosage, entièrement pavé de grosses pierres et aussi large que la rivière qui l’abreuvait. Il faisait comme un coude planté dans l’eau avec deux écluses de gros chevrons de chêne, mues par des vis et manivelles de fonte.
La première fois que Simon m’a amené chez lui, je n’avais jamais vu de ma vie une chose pareille, habitué que j’étais aux petits canaux du pays niçois à l’aide desquels on ne peut même pas arroser deux raies de haricots à la fois…j’ai aussi appris ce qu’était une inondation. Dans ce pays gorgé d’eau, il fallait surveiller le niveau de La Marne quand il pleuvait sans cesse pendant trois semaines ; on envoyait alors la surverse dans le canal en jouant avec les écluses. Quand tout cela débordait, il y avait déjà belle lurette que la cave trempait. C’est pour cette raison que les vieilles bouteilles d’eau de vie cachetées à la cire rouge – que Simon subtilisait à son père – étaient sales d’une poussière très fine : la vase des crues de la rivière.
Un peu au-delà, mais pas très loin, était le grand canal. Ça alors ! il était plus haut que le niveau de La Marne, perché sur un talus gazonné, avec une grande écluse et une maisonnette, pour le gardien, comme on en voit dans les vieux livres de géographie. De temps en temps, on voyait passer une péniche. Elle disparaissait dans le bassin, ou au contraire, apparaissait, comme une lune qui se lève. Pendant ce temps, le batelier faisait un brin de causette avec la femme de la D.D.E..
Sur chaque rive de cette eau calme et verdâtre, s’étiraient les chemins de halage et des rangées de grands arbres. C’est là que la mère de Simon alla, plus tard, en bicyclette, noyer les revolvers qu’elle retrouva cachés et oubliés dans les casiers des tiroirs et les planques de la maison, cadeaux empoisonnés de toutes les armées qui avaient roulé dans le pays. Ainsi, elle pensait en éteindre la braise pour toujours. Peut-être espérait-elle que le « glouff ! » et le petit tourbillon qui engloutissaient l’ustensile, entraîneraient avec eux le souvenir, la malédiction ; et que les ronds qui filaient sur l’eau chasseraient le maléfice comme ils faisaient fuir les araignées d’eau.
Un peu plus haut était le port qui avait embarqué les chargements de bois façonné et avait alimenté l’usine en charbon, du temps de l’expansion et du flambage effréné de la belle époque.
L’usine – la Scierie Sartre – avec sa cheminée de briques rouges qui lui servait de bannière industrielle, de point de mire, se voyait de loin. Ce totem avait extrait la fumée de l’étuve qui traitait les planches, à l’époque où en France on astiquait des parquets et travaillait du « bois d’arbre ». Cette étuve était aussi grande qu’une maisonnette, maçonnée en briques, avec des armatures et des portes de fonte rivetées et rappelait les gravures des romans de Jules Vernes. Elle était écrasée sous un fatras de hangars et de toitures poussés dans l’anarchie et appuyés à un côté de la Vieille Maison.
Le chemin de fer, qui passait un peu plus loin, avait lancé un bras qui desservait la scierie. Il la reliait ensuite aux hangars de stockage et de séchage disséminés sur la propriété et continuait jusqu’au port du grand canal. Tout cela était quasiment abandonné depuis la guerre. Le chiendent et les ronces couvraient les rails rouillés ; le vent jouait à faire voler des toits les tuiles branlantes qui venaient exploser – comme autrefois les bombes – autour du taxi de la Marne.
On avait bâti plus tard une scierie moderne qui regardait ce carnaval déglingué avec la morgue de ses tôles luisantes et l’assurance de l’architecture rationnelle des caisses de munitions. Entre ces deux témoins de la marche du progrès, les triqueballes venaient décharger des monceaux de grumes qui attendaient la morsure de la scie dans un grand espace boueux. Cette cour était parcourue de tracteurs, de chargeurs qui approvisionnaient le monstre ; des Clarck enlevaient les palettes de bois débité et les portaient au séchage ; des Manitou gavaient les trente-huit tonnes qui ouvraient à l’international le destin du chêne de la Haute-Marne. Tout ce remue-ménage éclaboussait à grandes giclées l’eau qui stagnait toujours là et brassait en continu un bourbier endémique. Quand les camions s’y enfonçaient jusqu’à l’essieu, on faisait venir des bennes de caillasse ; mais le marais les engloutissait et, tous les deux ans, il fallait recommencer. Personne n’a jamais compris où allait finir toute cette pierraille déversée là par des générations de Sartre.
J’ai à l’esprit l’image de Simon sur cette aire, un jour où il cubait des grumes de hêtre avec son bidule à coulisse et un décamètre. On pataugeait dans cette fange. Il m’avait prêté une paire de ces bottes de caoutchouc qui sont un équipement nécessaire dans le septentrion, et dont il gardait toute une file, de tailles diverses, dans le couloir du moulin, pour dépanner les clients et les visiteurs dépourvus.
Je m’étais sans doute arrêté à Langres en montant – ou en descendant – de Paris, du temps où nous préparions une exposition au Musée de l’Homme. Maintenant que j’y repense, il me semble même que j’y étais allé pour un week-end, puisque je travaillais à Paris justement. Quoi qu’il en soit, Simon m’avait entrepris au sujet de ma vie professionnelle. Il considérait que mon caprice d’artiste avait assez duré et qu’il était temps pour moi de poser le baluchon ; qu’il était bien beau de courir les chantiers de fouille et les ateliers de moulage, de jouir de la fraîcheur des grottes, de se régaler de la conversation des savants et des étudiants… payé une poignée d’olives et pressuré comme une étendelle (1). Il fallait maintenant penser à faire rentrer des sous et établir la famille. Moi qui tenais le bout du décamètre, je lui répondais : « six cinquante… huit quatre-vingt-dix… » et je haussais les épaules. Lui marquait les chiffres sur son carnet, mesurait un diamètre, notait de nouveau, coupait un moignon de branche qui dépassait, mais toujours, revenait à ses raisons. Presque mûr déjà, mais, cervelle de linotte, comprenette tardive, je n’étais pas encore prêt à sauter le pas qu’il avait déjà fait. Sa parole semait pourtant, laissait une empreinte dans ma tête de bois qui n’écoutait rien ni personne.
Mais pour en finir avec ce Moulin Rouge, il nous reste l’ancienne cité ouvrière, le long de la route qui menait à la nationale. C’étaient de petites maisons jumelles de deux niveaux, avec une entrée au milieu de la façade. Derrière, un terrain vague envahi de buissons et d’arbustes allait jusqu’à la Marne. On devinait que ce morceau de terrain avait été divisé, un petit potager pour chaque famille, du temps où la chapelle du Moulin Rouge rassemblait dans une sainte communion les patrons et les employés, le jour du repos dominical ; cette chapelle où le petit peuple de la scierie remisait ses bannières de procession pour les jours de fête et ainsi, participait – en tant que tel – aux pompes religieuses.
Ainsi, les bras et les esprits de la main d’œuvre étaient éduqués, conduits par les Sartre, famille de bon sens, dont chaque génération pourvoyait d’au moins un prêtre et un entrepreneur au maintien d’un monde langrois bien équilibré. On ne quittait pas le Moulin Rouge ; on y naissait, on y était baptisé, on y suivait le catéchisme, on y gagnait son pain et comme ça, jusqu’à l’enterrement !
En effet, la véritable omnipotence des Sartre résidait bien au-delà des réalités sociales du temps. Leur miséricorde ne venait pas buter aux bornes du siècle et l’éternité protégeait le Moulin : En haut du Coteau qui surplombait le domaine, sur la rive droite de la rivière et du grand canal, le cimetière, caché par une plantation d’épicéas, surveillait la vie qui continuait à se dérouler, en bas, avec le fil de la Marne. Un raidillon menait droit de la vallée au Grand Plateau et allait se perdre dans les labours, avec les sillons qui filaient vers les Vosges. Un peu avant de déboucher sur les champs, on tournait à droite dans un petit chemin qui passait à plat et allait au cimetière.
Un portail de fer et des bouquets de sapins centenaires prévenaient le visiteur, ralentissaient son pas et inclinaient sa tête. Alors, on marchait jusqu’à la tombe des Sartre en longeant les murs du cimetière, les mains croisées derrière le dos, sur une jonchée d’aiguilles et de cônes qui crissaient sous les pieds avec le gravier du chemin. En tournant d’équerre à main gauche, quelques marches de calcaire blanc montaient vers une allée blanche, d’une dizaines de mètres environ, bordée de murets de pierres de taille et qui s’arrêtait sur la façade carrée du monument. L’architecture en était sobre ; avec la majesté dépouillée et très classique de ceux qui savent depuis longtemps manier le vrai pouvoir et qui ont eu le temps de penser au sens et à l’utilité des rites funéraires. Des plaques de bronze scellées dans la pierre faisaient face au visiteur et les noms gravés avec leurs dates faisaient remonter des lignées de Sartre au temps où Berthe filait. Appuyés à la pente du Coteau, l’arrière et les côtés de la tombe étaient contre terre et, de part et d’autre, symétriquement, la pente douce d’un talus gazonné donnait accès à la trappe, agencée dans la partie supérieure de l’édifice et qui s’ouvrait en relevant une grosse dalle.
Comme du temps de la vie et des souffrances, on reposait chacun selon sa condition ; les défunts du Moulin Rouge qui abandonnaient les maisonnettes de la cité, montaient se retirer dans les tombes modestes, pelotonnées de chaque côté de l’allée, étendues aux pieds de ceux qui restaient pour l’éternité maîtres et protecteurs de l’engeance du lieu. Qu’il s’agisse du mythe du pélican ou de l’image des oiseaux de nid, la métaphore ornithologique sautait à l’esprit, à la vue de cette silhouette majestueuse, abritant ses fidèles, les tenant rassemblés autour d’elle pour les empêcher de retomber dans ce monde cruel…
Des générations d’ouvriers du Moulin étaient enterrées bibliquement dans un trou creusé dans cette terre qui les avait nourries. Quelques pauvres hères aussi, qui avaient achevé ici leurs tribulations, y avaient trouvé sépulture et dignité. Une barrière basse de bois pourri, ou une rangée de dalles assaillies de mousse et de petites fougères entouraient les tombes, comme si quelque pastoureau avait joué à construire de petits enclos. La croix de fer forgé portait souvent une plaque, carrée ou en forme de cœur, émaillée d’un blanc vieilli et dont la peau craquelée montrait des écrits noirs, à demi effacés.
Tous ceux qui « ne s’étaient pas emporté les bagages au paradis », côtoyaient humblement le crève-cœur des tombes de bébés ou d’enfants, encore si nombreuses en ces temps de progrès industriel. Ces petites jardinières m’ont toujours rappelé – comme une mise en abîme – les jeux graves et solennels des petits, quand ils vont enterrer un oiseau ou une souris, imitant la grande pompe en une prémonition naïve des affres de la mort. Qui n’a jamais ressenti l’émotion que suscitent les sentiments de révolte, d’injustice, devant l’expression de tant de chagrin, réduite en un si petit espace de triste poésie ?
Les morts les plus anciens avaient cependant laissé la place aux jeunes ; leurs croix étaient rassemblées de côté, appuyées aux murs de pierres sèches envahis de lierre qui marquaient les limites du cimetière. Même les Sartre du début s’étaient poussés du milieu pour aller reposer plus dignement dans la tombe totémique, quand on l’avait bâtie. Leurs stèles, de belle pierre blanche, avaient ensuite été disposées respectueusement, à l’antique, sur les murets, de chaque côté de l’allée centrale.
Les coups de vent, sifflant dans les branches des sapins, semblaient nous traduire les pensées des esprits qui circulaient, toujours chez eux, et animaient un peu ce vieux cimetière romantique maintenu, à l’abri des arbres, dans la pénombre fraîche et humide d’une forêt. En définitive, en haut du Coteau et cependant protégés du vent du Plateau, les trépassés pouvaient toujours jeter un œil sur le monde qui avait été le leur, penchés en avant, comme à l’église les putti perchés sur les corniches. Les vivants, eux, de retour de leurs visites, continuaient souvent dans la haute futaie de mélèzes qui séparait le cimetière et les champs, dans les drèves des plantations d’épicéa ou les ronciers des clairières, pour récolter quelques champignons et guetter le chevreuil qui attendait l’ouverture.
* * *
Evidemment, ce monde réglé comme une horloge, remonté une fois pour toutes, pouvait paraître paisible et rassurant ; il pouvait aussi s’avérer scabreux et fermé. Simon-Pierre Sartre, quant à lui, avait décidé depuis longtemps de ne pas s’enchaîner à cette galère. Quand il avait pris les rênes de l’entreprise, il avait de suite loué un appartement dans une commune extérieure. Il avait proclamé, à titre de précaution, qu’il ne supporterait pas l’idée de s’en aller fumer les mauves en la compagnie macabre d’ancêtres qui attendaient toujours « le suivant », dans ce monument prétentieux et moisi qui rappelait le tonneau des Danaïdes. Il préférait concevoir un repos marin, avec vue sur l’infini, l’inconnu, l’aventure, à Batz, en Bretagne, d’où il s’était embarqué pour Saint Pierre ; à Batz, près du Croizic, avec les souvenirs de vacances de son enfance.
Mais ce romantisme funèbre n’avait d’autre but que d’emmerder son monde ! à trente-quatre ans, on a autre chose à faire que de s’occuper de son cercueil ; d’autant plus que le travail ne manquait pas pour redresser la scierie Sartre qui avait été sur le point de partir en quenouille. C’est pourtant bien sur ce même Coteau que nous nous trouvâmes réunis pour ses funérailles…
Le désastre n’avait pas traîné en longueur : Au printemps j’avais fait le voyage à Paris et à l’automne, je me préparais à l’ultime visite. Bien que j’aie attendu la nouvelle de cette mort qui était désormais le dernier et seul espoir de mon ami, j’étais étreint d’une lourde peine. Sa mère m’avait appelé pour me demander quelque chose de grave, qui resserrait encore mon appréhension : Prononcer l’oraison funèbre de Simon-Pierre Sartre m’arrivait comme une épreuve initiatique. Cela mettait les points aux phrases de la vie qui commençaient à s’écrire dans ma jugeote. En effet, la Camarde avait entrepris de me poursuivre de son zèle implacable et je n’avais pas encore réalisé que mon allure écervelée semait, depuis déjà longtemps, des pâquerettes dans ses narines. La cérémonie qui m’attendait me donnait mon premier vrai rôle dans les rites qui apprivoisent la mort – et furent, il y a cent mille ans de cela, le signe de la première pensée véritablement humaine.
En attendant, je n’avais pas toute cette philosophie en tête, empêtré dans cette entreprise imprévue d’oraison, dont les codes m’étaient inconnus et dont j’étais sur le point de découvrir la pathétique absurdité – ou de tirer la cohérence d’une destinée – selon ce qu’on voudra y trouver. Je me revois dans ce train de nuit auquel j’étais déjà accoutumé et que je devais prendre, plus tard, encore maintes fois. Je me revois, gribouillant sur un bloc-notes, mal assis sur une couchette, essayant de réunir trois idées, secoué – ou bercé – par les tressautements du wagon qui donnaient à ma tête des balancements lancinants, comme dans une litanie, comme si j’étais devenu, un court moment, le chaman à la recherche des paroles qui feraient le lien avec l’autre monde.
Ici-bas cependant, Louise, la mère de Simon, m’attendait à la gare aux six heures et quelques de l’horaire officiel du Nice-Reims. Aucun de nous deux n’avait beaucoup dormi. Nous fûmes soulagés de laisser la solitude de la nuit et le brouillard humide de ce matin d’octobre pour nous offrir quelques paroles rassurantes, bien réchauffés dans la bulle de la voiture qui retournait au Moulin Rouge. Dans la cuisine de la Maison Neuve, le café fumait, les tartines grillées parfumaient le battement de l’horloge. Le bon petit déjeuner ravauda les filets de la vie, chassa le cafard, et l’angoisse de ce discours qui m’attendait s’apaisa un peu. Même Louise semblait reprendre haleine, en compagnie de quelqu’un qui ne se rabâchait pas les cantilènes de la famille, qui ne s’enfermait pas dans ses silences, ses interdits ; un étranger au Moulin Rouge et toutefois proche de Simon, un homme jeune, encore frais et naïf.
Nous profitâmes de ce matin calme et des moments de quiétude qui nous restaient encore, pour aller voir Simon qui attendait, seul dans la chapelle de la Vieille Maison. Il était allongé dans son cercueil ouvert et, comme on dit, semblait faire un petit somme. On voyait à son visage que la Camarde l’avait délivré de la souffrance. Je la remerciai d’autant plus que moi, j’avais refusé de l’aider. Il avait mis pour le voyage le petit foulard noué au cou, comme il en avait l’habitude. En outre, ce tissu jaune masquait la pomme d’Adam qui ainsi ne semblait pas tant s’en prendre au Bon Dieu ; dans la chapelle, ça faisait meilleur effet. Pour le reste, il était habillé comme tous les jours, sans histoire. Simon ne prenait pas tout cela trop au sérieux, il serait indulgent avec mon oraison…
Peu à peu arrivèrent la famille proche, les gens de l’usine, du monde que je ne connaissais pas. Louise faisait face à tout et à tous, saluait, remerciait, organisait avec le curé, avec les pompes funèbres. Elle tenait le coup : ceux qui venaient assister à la fin des Sartre, qui venaient faire les corbeaux sur le dernier cadavre, ceux qui avaient intrigué avec le destin pour mener le siège du Moulin Rouge, ceux qui attendaient qu’on secoue la nappe pour picorer les miettes du repas, toute cette engeance ne se régalerait pas des larmes de l’étrangère qui se trouvait, désormais, maîtresse d’un navire qui sombrait dans les gouffres amers.
Quand ce fut mon tour – vedette américaine de la cérémonie – je dis mon compliment avec élégance et, je le comprends maintenant, un beau culot. Plus d’un, dans cette assemblée, dut rester coi d’entendre ce jeune garnement, sorti d’on ne sait où, affublé de plus d’un accent plaisant, certes, mais un peu inconvenant dans ces pénibles circonstances, d’entendre donc un type que personne ou presque ne connaissait, autorisé par la famille à prendre ici la parole, au nom des Sartre. Ils durent rester plus que secs, ces bons langrois, de devoir écouter, sans même une moue, cet espèce de rastaquouère leur raconter des inepties de granges en montagne, de philosophie, de Sahara, d’Amour… et je ne sais plus moi-même ce que j’ai bien pu leur raconter, car de toute façon, c’est Louise qui a gardé mes papiers ! Certains toutefois, un peu plus fins, y auront reconnu quelque facétie dans le goût baroque de Simon. Les Sartre eux, connaissaient la musique. Louise, enfin, m’avoua plus tard qu’elle ne put s’empêcher de laisser un peu goutter le robinet, quand elle m’entendit parler des oiseaux que son fils observait, poursuivait à la chasse avec tant de passion, avec ce bonheur du prédateur, libre, fort, parcourant son territoire.
En tout cas, à la fin de la messe, chacun avala avec soulagement une goulée de l’air frais du dehors, tant les gorges étaient serrées par l’émotion de cette cérémonie contre nature. Je me souviens que, pendant que les croque-morts vissaient son couvercle, le curé et moi parlâmes un moment du regretté Simon-Pierre. Le cercueil fut ensuite chargé, sous le regard d’une foule muette, dans le fourgon qui attendait devant la bâtisse. Le curé embarqua dans le véhicule qui franchit le pont du grand canal et peina dans le raidillon jusqu’au sommet du Coteau. Nous, nous suivîmes à pied, clopin-clopant et la parole nous revint avec les mouvements du corps et l’ambiance champêtre.
Le prêtre nous attendait là-haut, au milieu de l’allée, majestueux dans sa chasuble brodée qui flottait dans le vent, avec les branches des sapins. Simon, lui, était déjà sur le dessus de la tombe, posé sur deux tréteaux. Les types au costume gris avaient tout préparé. L’assistance se rassembla, par petits groupes, chacun à son rythme. Certains reboutonnaient leurs manteaux, d’autres coiffaient de leurs mains leurs cheveux ébouriffés et tous prirent place en demi-cercle autour du monument. Les proches montèrent sur les talus latéraux ; la famille et moi tout en haut, de part et d’autre de la caverne béante dont on avait ripé de côté la dalle de fermeture. Les discussions s’éteignirent. Alors, le curé bénit le cercueil et dit les dernières prières, accompagné par le chœur des grands arbres qui chantaient dans le vent. Nous en étions arrivés à ce moment si pénible où la mort allait engloutir Simon, pour de bon et à jamais. Les mâchoires se crispèrent, quelques larmes retenues jaillirent sous des yeux trop gonflés. Quand les quatre types attrapèrent les poignées du cercueil et le présentèrent sur l’ouverture de la trappe, personne n’eut plus honte de renifler, de se fermer la bouche de la main.
C’est alors qu’advint la première connerie. Le fait fut immédiatement reconnu comme la dernière plaisanterie de Simon-Pierre le farceur : le paquet ne voulait pas entrer. Simon était trop GRAND !
Ils forcèrent pour le faire passer mais n’y parvinrent pas. Les croque-morts tinrent alors conseil, à voix basse, penchés vers leur chef qui, déjà peu coloré de nature, devenait blanc comme un linge. Pendant qu’ils reposaient le cercueil sur les chevalets, l’un d’entre eux alla chercher quelque chose dans son fourgon. Tout le monde était coi, sec, incrédule. Louise, droite comme une statue, semblait être loin, ailleurs. Celui qui s’était défilé revint en vitesse avec une scie et entreprit de couper – en haut et en bas – les moulures qui coinçaient. Le type sciait de bon cœur et, appuyant son genou contre la caisse, tirait un doigt de langue. Il était possible que cette ambiance d’atelier d’artisan ait été la touche surréaliste dont Simon aimait tacheter sa vie. Pour la majorité de l’assemblée cependant, cela faisait mauvais effet et on entendit murmurer, tant que les croque-morts n’eurent pas tenté leur second essai.
La menuiserie raccourcie, l’équipe de bras cassés retourna donc à sa tâche, équipée de cordes et d’outils divers, avec l’entrain des travailleurs qui s’y connaissent. Il ne manquait pas grand-chose… mais le cercueil resta coincé dans l’ouverture, sans vouloir plus entrer ni sortir. Un des croque-morts, qui commençait à s’énerver, se mit à le prendre à coups de pieds pour le faire descendre dans le trou. Nous, nous étions tous pétrifiés, ébahis, partagés entre l’envie et l’impuissance de tirer une bonne gifle à ce grossier personnage, entre l’envie d’un bon éclat de rire et celle d’une crise de larmes.
– Il ne veut pas ! Le cri de la mère a interrompu les agissements de l’autre sacrilège. La tension s’est apaisée. Nous sommes quelques-uns à pouvoir souffler, à laisser fleurir un petit sourire dans un regard, un battement d’yeux. Mais que faire ? C’est de nouveau Louise qui fait face à l’adversité, qui maîtrise, qui dirige les hommes et la cérémonie, avec cette rage, cette obstination à ne pas se laisser renverser par les coups que la main gauche du destin lui envoie à toute volée depuis qu’elle est entrée dans la parenté des Sartre.
– Il ne veut pas ! a-t-elle crié. Simon ne veut pas.
Et moi, je lis dans ses pensées. Là, juste derrière les petites tombes, il y a un coin calme, sous les sapins. Simon reposera ici, dans la terre mère, parmi les bûcherons, les arbres, les racines, l’eau, la roche, l’humus, l’herbe folle… seul et en compagnie, tout à la fois. Louise nous réunit, sur le bord de la trappe noire et muette ; on se concerte en famille. Les ouvriers font le cercle autour de nous, à distance respectueuse, toujours affublés de leurs outils surréalistes ; ils attendent la suite, « toujours prêts ». En bas, l’assistance se tient dans la dignité, commente l’affaire à voix basse et attend, elle aussi, la suite.
– Il ne voulait pas rejoindre la marmite et se laisser mettre le couvercle par dessus ! nous dit Madeleine, la sœur de Simon.
De fait, nous ne savons pas s’il nous joue sa dernière farce ou si c’est l’ultime révolte contre un destin écrit, un dernier sursaut de liberté pour échapper à la tradition, au poids et à l’attachement des racines. Peut-être éclate-t-il de rire dans son cercueil. Peut-être s’étouffe-t-il de colère de se trouver contraint de retourner aux vieilles biles et disputes de famille… de nouveau et pour toujours, s’allonger avec tous ces morts, à écouter la Messe des abbés Sartre ou les kindertotenlieder ; ou la détonation du P. 38 de Jean-Baptiste insister sur la dernière syllabe de cul-pa-bi-li-té. Mais en fin de compte, peut-être qu’il s’en fout comme un niçois, que c’est nous qui continuons à remuer des vanités de vivants.
Quoi qu’il en soit, en ce qui nous concerne, nous avions fait ce que nous devions. La décision était prise, Simon serait enterré hors du monument, dans la terre, parmi les sapins. Il n’avait pas été possible de respecter son désir de cimetière marin en Bretagne, qui était plein comme une outre. Là-bas, ils n’allaient pas enlever quelqu’un du pays pour mettre un bourguignon à sa place ! Ainsi, comme s’il y avait eu une entente avec les ancêtres, le dernier patron de la scierie, après une dernière messe dans la chapelle, resterait bien sur le Coteau du Moulin Rouge. Il y resterait, mais hors du nid, de la « marmite ». Il y resterait. A sa façon.
Penauds et muets depuis leur premier échec, les croque-morts s’agitent de suite comme de beaux diables. Ils reviennent avec des pioches, des pelles, ils gesticulent, tombent la veste, se retroussent les manches. Avec la veste, ils ont mis de côté leur habituelle figure de carême. Ils ont déjà tracé la bande de terrain dans la petite clairière entre les sapins. Elle restera un peu en biais, contrairement aux autres tombes qui sont rangées à l’équerre par rapport à l’allée… Nous sommes d’accord comme ça. Les hommes sont au travail, dans la terre, la sueur, la vie et on voit que cela leur convient ; à moi aussi.
Nous, de là-haut, nous avons pourtant vu une vague d’inquiétude remuer la foule. Des bouches s’ouvrent, des regards se rejoignent, interrogateurs, on murmure des phrases incertaines. Tout le monde voudrait partir, retourner à ses affaires : on ne peut pas passer la journée à attendre qu’ils aient creusé le trou ! C’est de nouveau la mère qui s’occupe de diriger, dans un reflux ordonné et digne, ce qui aurait pu tourner en une vile débandade. Elle serre les mains, reçoit les condoléances et les excuses, elle rassure ceux qui ont des scrupules.
Je reste avec la sœur et le frère de Simon qui en profitent pour demeurer un peu à l’écart. La parole nous est revenue. Nous parlons et tentons une première interprétation de l’aventure, tout en surveillant le creusement de la fosse. Nous avons laissé le mort tranquille, là-haut, parmi les tombes anonymes, dans le vent qui agite les fleurs des bouquets et des couronnes, abandonnés au hasard « en attendant les ordres ». Les bandeaux de papier qui portent des épitaphes aux belles lettres, se balancent comme les phylactères des fresques des chapelles du Pays Niçois. Au milieu de tout ça, le cercueil est un peu de guingois, posé sur ses tréteaux branlants, près de la « marmite » qui est restée ouverte, comme un fortin abandonné ; de temps en temps, les locataires peuvent bien profiter d’un peu de lumière et d’air frais. Le tableau semble à la fois naïf, champêtre, avec de petites scènes éparpillées de ci, de là, mais en même temps quelque peu surnaturel. On dirait que nous sommes tous disposés, morts et vivants, dans une fresque de Canavesio et que les messagers de l’autre monde viennent frôler nos cheveux de leurs ailes… Cramponnés de leurs serres d’aigles au rebord de la trappe, des diables, noirs comme des chauves-souris et ricanant d’un mauvais plaisir, brandissent les âmes damnées embrochées sur leurs fourches. Au-dessus, planent les anges à la voilure épanouie. Ils accueillent à bras ouverts les âmes des justes, tendues comme des nourrissons vers leur mère…
Maintenant, la foule s’est écoulée du cimetière vers le bas du Coteau, dans la vallée. Avec nous sont restées quelques rares personnes. Le vent s’est de nouveau emparé des branches des grands sapins. On n’entend plus que lui, et le tintement des pioches sur la roche… je n’aurai pas eu le temps de rêvasser longtemps. En effet, dès qu’ils ont eu creusé deux empans dans la terre, les croque-morts sont tombés sur le dur ! Ils sont maintenant appuyés d’une main sur le manche et, de l’autre, se grattent la tête, impuissants. Il faut de nouveau discuter. On ne peut pas revenir en arrière, de nouveau changer la place de la tombe du pauvre Simon ; il faudra bien qu’ils se débrouillent pour faire la fosse là. Le chef croque-mort nous le jure, il faut juste que nous lui laissions le temps de réunir le matériel nécessaire. Pour sûr que ce n’est pas avec des pioches et des pelles qu’ils pourront briser la veine de pierre jaunâtre qu’ils ont mise à jour et qui affleure sous le Coteau. En tout cas, il faudra bien aller manger. Toutes ces émotions ne nous avaient pas coupé l’appétit, bien au contraire. Nous descendîmes à pied jusqu’au Moulin et laissâmes Simon sur ses tréteaux, avec le vent, les phylactères et les croque-morts au travail pour lui tenir compagnie.
Quand nous retournâmes sur le Coteau, les terrassiers avaient amené une petite pelle mécanique. Elle ronronnait comme une mouche dans les sapins et son grand bras de manchot dérapait sur la roche en un branle heurté et malhabile. La roche mère se laissait chatouiller, égratigner, mais le trou ne s’en creusait pas plus pour autant ! Cette fois, il n’y avait plus personne, à part les ouvriers, le chef croque-morts et nous qui commencions à nous faire du souci. Simon pouvait bien attendre encore un moment sans prendre froid ; mais, au mois d’octobre, la nuit tombe de bonne heure et, en cet instant, on pouvait déjà douter qu’il soit enseveli au soir de cette journée invraisemblable. Nous avons donc repris la discussion technique. Pour briser la roche, il fallait un compresseur et un marteau piqueur. Mais va louer du matériel un samedi à une heure pareille ! Ils sont pourtant revenus, alors qu’il était déjà tard, avec ce qu’ils avaient pu trouver et se sont lancés au travail avec la volonté d’expédier une histoire qui avait trop duré.
Pourtant, fait du hasard ou fait de Simon – farceur ou fâché – il était écrit qu’on n’enterrerait pas de Sartre ce jour-là. Soit que le compresseur était trop faible, soit que le marteau était trop puissant, toujours est-il qu’ils n’étaient pas faits pour être couplés. Ainsi, la pointe d’acier rebondissait sur la roche comme une balle et secouait les puces du pauvre bougre qui tentait de la maîtriser.
Vous avez bien compris que, lorsqu’ils sont revenus avec le bon couple, il faisait nuit depuis longtemps. En ce qui nous concerne, nous avions eu le temps de mûrir l’idée d’ensevelir Simon-Pierre Sartre ultérieurement. Le chef nous assura que tout serait prêt pour le lendemain matin, qu’ils creuseraient toute la nuit s’il le fallait. D’ailleurs, ils avaient déjà tout préparé et ils avaient installé une batterie de projecteurs. Le cimetière était maintenant illuminé comme la crèche pour la nuit de Noël et des rayons de lumière jouaient dans les branches des sapins comme des guirlandes. Etrangement, le bruit du groupe électrogène, les jeux d’ombre et de lumière entre les croix et les tombes, le trafic des ouvriers, des véhicules et du matériel, rappelaient plus l’ambiance d’un festin de village ou d’une fête foraine que les mauvaises plaisanteries et les mises en scène scabreuses d’halloween.
Nous étions donc bien convaincus que la cérémonie n’aurait pas lieu avant le lendemain matin. Pour autant, nous n’allions pas laisser le défunt au serein comme un lièvre, dehors, dans ce cercueil minable, raboté par la scie en haut et en bas. Il fallait qu’il retourne dignement dormir une dernière fois à la maison et fasse encore un tour du domaine. Mais le corbillard s’en était retourné dans l’après-midi, étant donné que le voyage qui avait amené Simon sur le Coteau devait être le dernier. L’infirmière qui avait soigné Simon et qui était revenue aux nouvelles après sa journée de travail, nous proposa aimablement l’aide de sa voiture à peu près break. Nous manœuvrâmes donc ce corbillard improvisé, abaissâmes le siège arrière, ouvrîmes le coffre en grand et allâmes en délégation soustraire le patron à sa conversation avec les anges, les phylactères et les ancêtres dont le bastion était toujours ouvert à la curiosité des chouettes. Le cercueil se trouva donc chargé dans la voiture, comme on fait avec le frigo quand on déménage : la tête était dedans, un peu plus basse que les pieds qui dépassaient à l’extérieur, relevés par le seuil du coffre. Simon retourna donc à la maison, bercé par les ressauts de l’allée, les pieds au frais, avec Jeannine qui aurait pris soin de lui jusqu’à la dernière heure – et au-delà. Nous suivîmes dans l’obscurité vers les lumières faibles du Moulin Rouge, regardant les phares à la descente qui ouvraient le chemin, comme un chasse-neige, dans la noirceur de la nuit. Il était temps de repartir ; le vacarme du compresseur, le tir de mitrailleuse du marteau chassèrent avec brutalité angelots, diables et chouettes. L’enchantement tombait en morceaux.
Une fois tous rassemblés en bas, nous nous occupâmes de rentrer le cercueil pour la nuit. Nous ne pouvions pas décemment le fourrer dans l’entrée ou le salon de la Maison Neuve, au milieu des va-et-vient et des odeurs de cuisine. Il était plus pratique de le remiser dans le propre bureau de Simon, au rez-de-chaussée de la grande bâtisse. Pour cela, il suffisait de garer la voiture devant la fenêtre et d’y faire passer directement le cercueil, ce qui serait toujours plus facile que d’aller cogner dans les cloisons et les portes des couloirs. Nous n’eûmes pas honte de rigoler lorsque nous nous trouvâmes cramponnés aux poignées de la caisse, deux à l’intérieur et deux à l’extérieur à se regarder, avec le cercueil qui se balançait entre nous, posé sur l’appui de fenêtre. Après avoir écarté les affaires et les papiers qui l’encombraient, nous plaçâmes donc Simon sur son bureau. Nous le laissâmes reposer là pour la nuit, dans son univers familier, parmi ses affaires de travail, ses livres, ses équipements de chasse. Désormais, le Vieux Moulin était la maison des morts.
C’est ainsi que nous nous attablâmes, dans la Maison Neuve, autour d’un bon plat de jarret et petit salé aux lentilles. Dans la cave, j’allai taper dans le Santenay dont, chaque année, la famille achetait une barrique qu’elle mettait en bouteilles. Nous avions faim, soif, besoin d’éprouver des sensations physiques, de rire, de parler fort, d’être ensemble, très proches, de s’accrocher à la vie, de se faire un de ces repas comme lui les aimait.
Sur ce point, nous ne sommes pas d’accord avec Louise qui ne se souvient pas de ce menu et déclare qu’elle n’aurait jamais pu préparer une telle ripaille le soir des funérailles. Le jarret et petit salé aux lentilles est cependant devenu mon repas de bienvenue quand je me rends à Langres…quoi qu’il en soit, c’est moi qui raconte l’histoire et j’y mets bien ce qui me vient d’écrire !
Enfin, le repas achevé, nous sommes sortis voir les travaux du Coteau. La fosse se creusait, elle serait prête pour le lendemain matin. Alors, nous nous sommes couchés épuisés, tremblant d’émotion ou de rire, secoués de sanglots, tracassés par cette pantomime du destin.
Le matin, nous nous réunîmes pour le café ; nous étions apaisés. Le fourgon des pompes funèbres attendait devant la fenêtre du bureau ; Simon-Pierre Sartre retourna donc sur son Coteau, comme il se doit. En haut, tout était prêt, paisible, tranquille, éclairé d’un petit rayon de soleil et Simon descendit dans la fosse comme un nourrisson dans son berceau. Nous étions sept. Anne-Sophie, la petite nièce, qui avait cinq ans, Magali, Vladimir, Madeleine, Louise, Emmanuel de la scierie et moi. La fillette, la première, lança un fin bouquet de fleurs sur le cercueil et nous fîmes ensuite de même. De retour, l’enfant dit :
– Il n’aura pas ses cadeaux pour Noël ?
Nice, décembre deux mille trois.
* Les mots en italiques sont en français dans le texte.
1 – Etendelle : claie en osier garnie de grosse toile de crin, qu’on place entre les sacs où l’on enferme les matières oléagineuses destinées à être soumises à la presse.
Nouveau Larousse illustré, dictionnaire universel encyclopédique, Paris, 1907.


